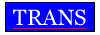 |
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften |
17. Nr. |
Januar 2010 |
|
| Sektion 3.4. |
Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsleiterin | Section Chair: Ursula Moser (Universität Innsbruck)
Dokumentation | Documentation | Documentation |
La poétique du trauma chez Leïla Sebbar
Subha Xavier (University of Miami) [BIO]
Email: xavier@mail.as.miami.edu
Leïla Sebbar, romancière dont l’œuvre littéraire prolixe ne cesse de retourner en Algérie pays d’enfance, est une écrivaine migrante de descendance mixte. Née en 1951 d’une mère française et d’un père algérien à Hennaya près de Tlemcen, elle y a passé sa jeunesse avant de déménager en France pour poursuivre ses études et échapper la précarité de la situation politique algérienne. Bien qu’elle ait passé dix-sept ans en Algérie, Sebbar prétend ne pas avoir appris l’arabe et ne pas connaître la langue de son père. Dans son roman publié en 2003 et ayant pour titre le constat Je ne parle pas la langue de mon père, elle raconte son enfance à travers son incompréhension de l’arabe, la langue parlée par son père, son aïeule et ses tantes paternelles, ainsi que les domestiques de la maison Sebbar. Cette langue, qui lui fait défaut, est porteuse du trauma de la guerre d’Algérie comme des secrets que son père ne lui a jamais dévoilés alors qu’il était en vie. Écrit cinq ans après la mort de son père, le roman constitue un hommage poétique à la mémoire de cet homme duquel elle n’a pas su se rapprocher par la complicité de la langue. Ainsi, le texte français de Sebbar est perforé d’allusions à la langue absente qui prive la narratrice de bilinguisme, la rivant dans un monolinguisme aliénant. Or c’est dans la souffrance évoquée par l’arabe absent que l’écriture de Sebbar débouche sur sa poétique du trauma et la vision politico-féministe qui l’accompagne.
Chaque chapitre du roman s’ouvre sur une phrase qui reproduit approximativement le titre de l’œuvre avec quelques variations importantes. La narratrice occupe tour à tour le rôle de sujet ou d’objet de la phrase, modifiant ainsi sa part de responsabilité dans le destin linguistique auquel elle a été vouée: « Je ne parle pas la langue de mon père », « Mon père ne m’a pas appris la langue de sa mère », « Je n’ai pas parlé la langue d’Aïsha et de Fatima », etc. Par le biais de la répétition, chacune de ces phrases renvoie à la béance que constitue la langue arabe au sein d’un texte purement français qui cherche toutefois à retracer un parcours algérien. Le retour au pays de l’enfance doit ainsi se faire dans la langue de l’oppresseur, médium linguistique non sans faute lorsqu’il s’agit de traiter de l’Algérie. C’est donc la culpabilité d’écrire le pays anciennement colonisé dans la langue du colon qui nourrit la véritable hantise de l’écrivaine. Cette hantise revient dans une quantité remarquable de nouvelles et d’essais chez Sebbar dont, pour n’en citer que quelques-uns, Si je parle la langue de ma mère (1978), La langue de l’exil (1985), Lettres parisiennes, Autopsie de l’exil (1986), Femme entre terre et langue (1987), Si je ne parle pas la langue de mon père (1988), Voies de pères, voix de filles (1988), Le corps de mon père dans la langue de ma mère (1991), Les mères du peuple de mon père, dans la langue de ma mère (1998), Le silence de la langue de mon père, l'arabe, l'Algérie à plus d'une langue (2001), L’ombre de la langue (2005), L’étrangère aimée, ma langue vivante (2006).
Dans Je ne parle pas la langue de mon père, le temps des verbes dans chacune des phrases d’ouverture de chapitre vacille entre le présent et le passé, jusqu’au dernier chapitre, que la narratrice entame avec le futur simple : « Je ne parlerai pas la langue de mon père ». Ce refus catégorique, qui clôt le roman, met fin aux reproches que véhiculent certains des autres débuts de chapitre, mais contribue tout autant à nous perturber par l’obstination et la ténacité qui y résident. Au regret et à la nostalgie des premiers chapitres vient s’ajouter la finalité linguistique de la conclusion où la narratrice se fixe définitivement dans un monolinguisme troublant.
Habiba Deming interprète toute l’œuvre de Sebbar à la lueur de cette déclaration têtue qui contrefait, selon elle, le geste colonial. Deming dévoile chez Sebbar un repli volontaire par rapport à la langue arabe en parcourant ses œuvres ultérieures ainsi que le roman qui est objet de la présente analyse. En effet dans Lettres parisienne. Autopsie de l’exil, Sebbar avoue avoir passé sept ans à étudier l’arabe classique.(1) Pour Deming, il est impossible que l’écrivaine n’ait acquis aucune connaissance de l’arabe après avoir vécu dix-sept ans en milieu algérien mi-rural. Dans Je ne parle pas la langue de mon père, la narratrice avoue même avoir été entourée de la langue à l’école française qui défendait aux élèves arabes l’usage de leur langue maternelle. L’école française où les parents de Sebbar étaient tous deux instituteurs, et la maison d’école qui abritait la famille, étaient les seuls espaces restreints au français. L’arabe était donc inévitablement présent : « …tout autour de l’école c’était l’arabe…Les murs n’étaient pas si épais… ».(2) L’arabe vernaculaire parlé au quotidien par les écoliers, comme par la famille étendue de la narratrice dont les femmes étaient pour la plupart analphabètes, ne semble avoir nullement imprégné l’enfant au point d’être intégré par elle, du moins selon l’aveux de Sebbar. D’où la critique de Deming : « En dépit de cette longue cohabitation linguistique, elle a toujours insisté qu’elle ne comprenait ni ne parlait la langue de son père ».(3) De là Deming se demande si Sebbar n’a pas adopté la langue de ses camarades de classe, de ses compagnons de jeu, de sa grand-mère, de ses tantes et surtout de son père, par un choix délibéré, ou si elle a désappris cette langue par un processus de refoulement linguistique. Sa résistance enfantine, transformée par son œuvre littéraire en véritable obsession, est suspecte pour Deming qui devine plutôt chez Sebbar une condition pyschopathologique de « censure semi-consciente »(4). Pris dans le contexte colonial, Deming lie le refoulement de l’arabe à un fantasme colonial d’épuration: « Enfant, elle ne voulait pas apprendre l’arabe, langue associée aux colonisés et qui aurait contaminé son univers linguistiquement pur.»(5)
Si Deming attribue l’oubli de la langue paternelle chez Sebbar à un désir de s’aligner avec le pouvoir colonial, j’interprète le roman comme une tentative de revisiter le trauma d’enfance qui a relégué l’arabe au domaine de l’inconscient. L’originalité de l’analyse de Deming, notons-le, est la manière dont elle s’écarte des lectures postcoloniales du roman sebbarien qui tendent à idéaliser l’identité hybride de l’écrivaine pour privilégier sa perspective littéraire issue, dit-on, de l’entre-deux. Il est vrai que la hantise linguistique de Sebbar est inquiétante lorsque l’on considère la quantité surprenante de ses œuvres publiées, toutes en français et toutes sur l’Algérie. Son refus d’apprendre ou de réapprendre l’arabe est difficilement réconciliable avec le contenu de ses écrits, à moins d’interroger la raison de son refoulement. Il est clair que l’arabe demeure étroitement lié chez elle à un passé douloureux. D’ailleurs, Sebbar le confirme dans ses propres mots : « Naïvement je crois qu’apprendre l’arabe maintenant aurait le même effet qu’une analyse… M’allonger sur un divan et suivre des cours d’arabe, cela reviendrait au même. »(6) En d’autres termes, l’arabe lui réserve des vérités auxquelles ses lecteurs, et peut-être elle-même, n’auront jamais accès. Le français rôde autour, tâtonne, mais n’y parvient qu’illusoirement.
Son manque de compréhension de l’arabe l’aliène du vécu de son père et de la guerre, et elle y pressent des vérités qui ne lui seront jamais révélées dans sa langue maternelle:
Bientôt ce serait l’heure des hommes, je les entendrais à peine, des murmures. Mon père m’appelle : Ne reste pas là sur le balcon. — Pourquoi ?— C’est dangereux ! — Dangereux ? — Tu m’écoutes ? ne reste pas là. Il commence à faire nuit. — À cause de la nuit ? —Tu sais pourquoi, alors ne pose pas toujours des questions, je ne veux pas te voir là, c’est tout.(7)
Les murmures des amis de son père, qui discutent sans doute de la guerre en arabe, sont intraduisibles en français et quoique la petite Leïla demande des explications, son père les lui refuse. La réplique exaspérée du père — « Tu sais pourquoi » — suggère peut-être que sa fille comprend l’arabe mais feint de ne pas le connaître. La fille semble revendiquer la prééminence du français, en exigeant une traduction. Cette situation est répétée plus tard lorsqu’une fois adulte, la narratrice ne retourne en Algérie que pour se sentir étrangère dans son pays natal parce que l’Algérie indépendante lui refuse maintenant la traduction, et ce officiellement:
Lorsque j’y reviendrai, je ne le saurai pas et je ne retiendrai pas les mots de la langue étrangère. Je marcherai en aveugle, ne sachant lire le sens des lettres arabes que ne redouble pas la langue coloniale, effacée par la langue officielle.(8)
Cette exclusion linguistique que ressent la narratrice serait facilement remédiable pour Deming par l’apprentissage, quoique tardif, de la langue paternelle. Cependant, j’y vois un enjeu traumatique complexe qui n’est guérissable que par le procédé littéraire de la répétition que ce roman, parmi d’autres, met en jeu.
Dans son ouvrage célèbre Unclaimed Experience : Trauma, Narrative and History, Cathy Caruth poursuit l’étude de la « blessure » (trauma en grec, wound en anglais) entamée par Sigmund Freud dans Au-delà du principe de plaisir (1920). Freud était le premier penseur à transformer la définition du mot « trauma » d’une lésion physique à une blessure au sens psychologique, ainsi que l’explique Caruth:
But what seems to be suggested by Freud […] is that the wound of the mind—the breach in the mind’s experience of time, self, and the world—is not, like the wound of the body, a simple and healable event, but rather an event that […] is experienced too soon, too unexpectedly, to be fully known, and is therefore not available to consciousness until it imposes itself again, repeatedly in the nightmares and repetitive actions of the survivor.(9)
Le trope de la répétition est essentiel à la prise de conscience de l’événement par le sujet traumatisé. Il s’ensuit que c’est par la narration et l’usage répétitif du langage que la source du trauma est reconnue et assimilée.
Cette répétition touche d’une part les événements d’Algérie vécus à travers l’assassinat de Mouloud Feraoun, l’ami instituteur et écrivain du père de Sebbar, de même que par l’incarcération de son père à Orléansville. D’autre part, une scène d’enfance, où de jeunes garçons algériens lui criaient quotidiennement des injures sur la route de l’école, la hante sous forme de trauma. Dans les deux cas, son ignorance de la langue native l’empêche de comprendre et de réagir, mais non de ressentir l’effroi accompagnant ces incidents :
Ils nous guettaient, je le savais, et je crois que le tremblement intérieur qui se mêle à l’effroi était le signe de cette attente quotidienne des mêmes mots, appris par coeur, les seuls que je n’ai pas oubliés… (10)
Les insultes attendues tous les jours, et pourtant incomprises, sont porteuses de violence que la narratrice revit même à l’âge adulte : « [C]es mots familiers et étranges, je les entends encore, violents, comme des pierres jetées, visant l’œil ou la tempe… ».(11) Cette violence verbale ponctue sa narration comme des resurgissements subconscients et incontrôlables qui témoignent de la nécessité de donner suite à son trauma d’enfance par le biais du langage. Cependant, les mots lancés par les jeunes garçons ne sont donnés ni dans leur traduction phonétique ni dans l’arabe original. Ils ne sont mentionnés que de manière indirecte en français et revêtus d’un sens imaginé: « [J]e suis sûre que l’insulte est sexuelle. »(12) Elle revient avec une obsession analogue au vécu de son père à qui elle demande des détails de la guerre au téléphone :
Je voudrais savoir… Tu dis qu’il faut oublier mais tu ne veux pas dire quoi…Mais Papa, ce que tu sais toi, tu es peut-être le seul… Et si tu ne racontes rien… Tu crois que tout le monde le sait… les livres ne disent rien et toi non plus.(13)
Le père refuse de répondre et Sebbar se voit de nouveau aliénée par cette langue porteuse de trauma. Elle imagine que son père dédaigne de lui divulguer ses secrets parce qu’il préférerait le faire dans sa langue natale plutôt que dans celle du colon. L’écart linguistique entre père et fille, exacerbé par les injures des assaillants d’enfance, devient insurmontable d’autant plus que la mort du père met fin à toute possibilité de l’abroger.
Le monolinguisme de Sebbar est teinté de regret, de mélancolie et de culpabilité et l’arabe fait irruption dans son texte par son absence flagrante. La langue occupe par conséquent une fonction doublement symbolique chez Sebbar puisque le français tente de combler la place vacante laissée par l’arabe, mais cette absence renvoie à son tour à l’impossibilité inhérente à tout projet langagier. En effet, le français fait défaut face à l’arabe et l’arabe fait à son tour défaut devant l’événement vécu. L’échec est ici double puisque l’insuffisance du français devant l’arabe reflète le déficit langagier plus général dont l’arabe est tout autant victime. L’absence qui hante le texte de Sebbar exprime une angoisse linguistique face au trauma qu’elle n’arrive pas à assimiler par le langage, mais qui n’est remédiable enfin que par le langage.
Le moyen que privilégie Sebbar pour la réconciliation impossible avec la langue étrangère, est celui enfin d’une féminisation du langage qui range son père et ses agresseurs algériens d’un côté et les femmes algériennes de l’autre. En d’autres mots, elle retrouve la douceur de la langue paternelle, après la violence subie en bas âge, chez les figures féminines de son enfance. À la dureté de la langue telle qu’elle l’avait entendue toute petite, « des voix sonores, violentes »,(14) « les mots de gorge, les sons roulés »,(15) elle oppose la docilité de celle de son père dans la maison de sa grand-mère : « La langue de mon père, dans la maison de sa mère, n’est pas la langue des garçons qui nous guettent… »,(16) « Le frère rit, un beau rire de gorge, le beau rire de sa langue, joyeux et généreux. »(17) Elle imagine des conversations entre Fatima, une des bonnes algériennes de la famille Sebbar, et ses fils, ou entre Aïsha, la sœur de Fatima, et son neveu. Elle rapporte des dialogues fictifs entre son père et le fils de Fatima, et d’autres entre son père et sa tante. Dans ces entretiens imaginés, il est question de la guerre civile, des disparitions, des insurrections, et de la mort. En même temps, ces conversations trahissent une complicité partagée par ces locuteurs dans la langue arabe. À l’exclusion froide ressentie par la narratrice, ces rapports imaginés opposent une intimité chaleureuse. Le texte français s’emploie à nous peindre une familiarité arabe à laquelle la narratrice a assisté en témoin sans jamais en avoir été complice.
Dans le dernier chapitre du roman, Sebbar refuse catégoriquement d’apprendre l’arabe comme nous l’avons vu plus haut. Cependant, cette déclaration est suivie de la raison d’être qui anime son projet romanesque :
Je veux l’entendre [la langue arabe], au hasard de mes pérégrinations. Entendre la voix de l’étranger bien-aimé, la voix de la terre et du corps de mon père que j’écris dans la langue de ma mère.(18)
Sebbar cherche à écrire ce qu’elle a entendu, écrire ce qu’elle n’a pas compris, dans un effort de capter l’hétéroglossie que son existence coloniale en Algérie a renié des années durant. Le refoulement provoqué par l’illusion de supériorité française, la guerre civile et les invectives des jeunes garçons, n’est pas inversé, comme le voudrait Habiba Deming, mais bien reconnu et accepté. Sans dépasser son monolinguisme, Sebbar met la langue française au service de ce qui lui échappe et l’obsède. Son texte médite les limites de la langue coloniale et expose la fragilité d’une langue en proie à une hétéroglossie latente.
Dans ses textes qui retournent sans trêve au pays de sa naissance, Sebbar raconte l’Algérie et son expérience d’immigration à un public essentiellement français. Inhérent à cet acte d’écriture se révèle un devoir éthique auquel Sebbar répond en racontant le trauma de la guerre et de son vécu en Algérie. Dans son étude du trauma, Caruth évoque justement la notion de responsabilité telle que développée par Lacan, selon lequel celui qui survit à une tragédie se voit attribué l’obligation éthique d’en parler.(19) D’où l’insistance de la part de la fille à faire parler son père pour en renseigner le public français. L’écriture dans la langue maternelle est de ce fait nécessaire, car c’est en tant que Française d’héritage mixte qu’elle raconte l’Algérie, son peuple et sa langue. Et ce point de vue privilégié tente de contrecarrer une occultation historique de la guerre d’Algérie en France, phénomène socio-politique que Jane Hiddleston souligne justement dans un article sur la littérature immigrante en France.(20) Ce n’est peut-être pas en apprenant l’arabe que Sebbar pourvoirait à sa responsabilité, telle qu’elle l’envisage, auprès des siens. Elle compare d’ailleurs sa favorisation de la langue maternelle à celle imaginée chez son père qui garde, dans la langue française, un silence troublant sur la guerre, les origines, les traditions.
Écrit d’abord pour ses compatriotes français, ce roman assume dans sa poétique du trauma une fonction éthico-politique dans un pays qui a historiquement occulté les détails de la guerre d’Algérie et continue de le faire à ce jour. Ne passons pas sous silence, à notre tour, le projet de loi voté le 25 février 2005 à l’Assemblée Nationale exigeant l’enseignement d’une histoire coloniale officielle qui reconnaît le « rôle positif » de la France en Afrique du Nord. Bien que Jacques Chirac ait supprimé l’article un an plus tard à cause du débat suscité par le projet de loi, il n’en a que demandé la simple réécriture. (Dans les mois qui ont suivi l’abrogation de l’article, la discussion politique en France s’est glissée vers la question moins contentieuse de l’esclavage.) Jane Hiddleston, dans son analyse de la mémoire et de l’amnésie culturelles pendant la guerre d’Algérie, note : « [F]acts were distorted, myths were abundant and people in France did not have access to anything approaching a complete or unbiased view. »(21) Cette aphasie culturelle s’est poursuivie en France bien après l’indépendance algérienne, la guerre d’Algérie ayant été exclue des programmes scolaires jusqu’à la fin des années quatre-vingt. C’est contre un tel mutisme national que s’érige l’œuvre de Sebbar qui profite de son expérience d’immigration pour y insuffler une mission politique à la quête de l’utopie de l’hybride.
Le silence de la langue arabe dans le ménage de la famille Sebbar et le refus du père, qui évite de parler de l’histoire et de la culture algériennes en français, sont repris dans l’acte d’écriture sebbarien qui privilégie, lui aussi, une autre langue pour revisiter le site de son trauma. En d’autres mots, Sebbar imite le geste de son père qui, selon elle, refuse de parler de la guerre algérienne dans la langue de l’oppresseur. Pareillement, l’écrivaine ne veut pas raconter son trauma d’enfance dans la langue de ses agresseurs :
[…] mon père n’aura jamais su que le silence de sa langue, dans la maison de la Française, se muait en mots de l’enfer, la porte franchie, et que ses filles seraient asphyxiées, étourdies par la violence répétée du verbe arabe…(22)
Ceci explique le retour à la langue maternelle chez les deux personnages pour accomplir la fonction thérapeutique de la répétition et assimiler enfin ce qui était trop soudain et trop douloureux pour être pleinement vécu et assimilé à l’époque. Par son titre anaphorique en tête de chapitre, Sebbar répond à ses jeunes assaillants devant lesquels elle a autrefois maintenu un silence absolu. En même temps, elle confronte la blessure de la langue, le trauma de la langue paternelle qui la poursuit depuis son enfance. Parcours personnel qui se confond par moments au devoir politique, le roman continue un travail d’introspection psychanalytique où le seul secours demeure toutefois la langue et son objet littéraire.
▲
Remarques:
1 Leïla Sebbar, Lettres parisiennes. Autopsie de l’exil, Paris, Bernard Barrault, 1986, 148.
2 Leïla Sebbar, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, 2003, 42.
3 Habiba Deming, « Espaces coloniaux et identités linguistiques au Maghreb », in : Jeanne Garane (ed.), Discursive Geographies : Writing Space and Place in French, Amsterdam, Rodopi Press, 2005,188.
9 Cathy Caruth, Unclaimed Experience : Trauma, Narrative and History, Baltimore, John Hopkins University Press, 1996, 4.
20 Jane Hiddleston, « Cultural War and Amnesia : The Algerian War and ‘Second Generation’ Immigration Literature in France », in: Journal of Romance Studies 3.1 (2003), 61.
3.4. Literaturen der Migration: Konfrontation und Perturbation als kreativer Impuls
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
For quotation purposes:
Subha Xavier: La poétique du trauma chez Leïla Sebbar -
In: TRANS.
Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 17/2008.
WWW: http://www.inst.at/trans/17Nr/3-4/3-4_xavier .htm
Webmeister: Gerald Mach last change: 2010-01-25