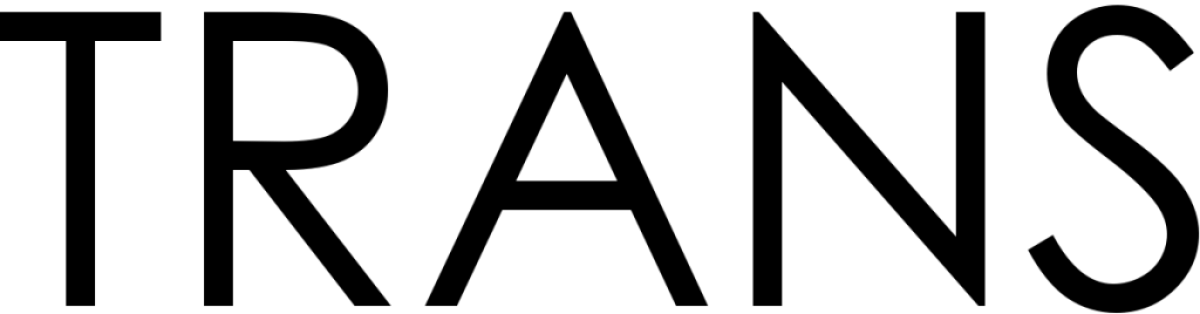Dr. BESSAI Rachid
Université A. Mira de Bejaia, Algérie
Résumé
L’objectif de cette recherche est d’étudier l’enjeu des rapports complexes entre l’université, le savoir et le développement socioéconomique, qui a fait l’objet de plusieurs débats internationaux entre les chercheurs, qui mettent l’enseignement supérieur au sommet des stratégies du développement dans les pays émergents comme l’Algérie. Une telle problématique nous invitons aujourd’hui à traiter ce sujet pour répondre aux questions suscitées par l’objectif de cette intervention, en focalisant d’abord, sur le principe de fonctionnement et/ou de dysfonctionnement de l’université comme étant un système de production d’un point de vu économique, et parfois de reproduction dans un sens sociologique. Ensuite, on mettra l’accent sur le rôle de l’université dans le processus de construction sociale, mais également dans le développement socioéconomique, et les nouveaux enjeux auxquels elle doit faire face.
Mots-clés : Développement – Enseignement supérieur – Croissance économique – Recherche scientifique.
Abstract
The objective of this research is to study the issue of the complex rapport that exists between university, knowledge and socio-economic development, which has been a subject of international debate among researchers that put higher education at the top of developmental strategies in emerging countries such as Algeria. A problematic as such invites us today to deal with this subject to answer the questions raised by the goal of this intervention, focusing first on the principle of operation and/or malfunction of the University as being a system of production from an the economic standpoint, and sometimes of reproduction from the sociological sense. Then, we put emphasis on the role of University in the process of social construction, but also in the socio-economic development and the new challenges it faces.
Keywords: Development – Higher education – economic growth – scientific research.
Introduction
L’enjeu des rapports complexes entre l’université, le savoir et le développement a fait l’objet de longues discussions entre les chercheurs qui continuent d’alimenter nombre de séminaires, de colloques et de conférences à travers le monde, d’autant plus que la croissance économique et le processus de développement traversent horizontalement l’institution universitaire afin de comprendre la dynamique de fonctionnement du système d’enseignement supérieur et mieux cerner les enjeux qu’il pose aux universités. Une telle problématique nous invitons aujourd’hui à traiter ce sujet, qui nous semble toujours d’actualité, car l’enseignement supérieur voit apparaître de nouveaux acteurs qui l’obligent à modifier sa propre trajectoire et de l’orienter vers de nouveaux systèmes pour contribuer au développement de la société. Dans le cas de l’Algérie, on dispose actuellement de nombreuses analyses visant à évaluer la réalité du système universitaire et ses rapports avec le développement socio-économique.
L’enjeu de cette relation demeure une question d’actualité qui suscite un débat entre plusieurs spécialistes qui considèrent l’université comme vecteur du développement de notre pays, face à un monde de plus en plus globalisé. Nombreuses sont les questions suscitées par l’objectif de cette intervention, voici quelques unes: Quels sont les véritables enjeux auxquels l’université algérienne doit faire face? Peut-on attribuer à l’université la fonction de construction sociale? Et quel est le rôle de l’enseignement supérieur dans le développement socio-économique de notre pays?
1. Le système universitaire entre production et reproduction
Si l’on considère l’université comme un système de production, il apparait indispensable qu’elle fonctionne selon un principe économique : le rendement maximal avec une dépense minimale d’énergie et une utilisation importante des moyens de production (LORENZI, J-H & PAYAN J-J. 2003 : p74). Cela dit, que l’énergie est représentée par les connaissances que les enseignants transmettent aux étudiants afin d’avoir un bon rendement qui va permettre à l’université d’être efficace et de produire des cadres nécessaires au développement économique du pays, or il est indispensable de souligner que l’université n’est pas seulement formatrice d’hommes; elle doit être également productrice d’idées, c’est-à-dire créatrice de situation conceptuelles nouvelles qui contribuent au développement.
La recherche n’est donc pas une activité secondaire de l’université, mais bien au contraire, elle constitue l’activité de prise en compte des problèmes. Elle marque la pérennité de l’intégration, cette dernière marque le dynamisme de l’université constamment alimentée par des perspectives nouvelles. Néanmoins, les objectifs de l’université ne sont pas souvent laissés à son libre choix, autrement dit, son produit exprime moins ses préoccupations propres, mais plutôt les préoccupations de la société. Sa production n’a de valeur que dans la mesure où elle est socialement acceptée, car elle a été réalisée dans le souci de répondre aux besoins complexes de la société (RENAUT, A. 2002 : 134). Cette relation complexe entre l’université comme système et le principe d’économie valable pour chaque société, nous appelons à analyser ce rapport d’une façon objective. D’après quelques analyses faites par certains acteurs sur le principe du fonctionnement du système universitaire ; on n’a constaté par conséquent que, contrairement à des systèmes fermés, il ne répond pas parfaitement au principe de la conservation de l’énergie, où par opposition à des systèmes ouverts, il n’obéit pas totalement au principe d’entropie. Par ailleurs, il faut noter que la somme des connaissances de l’ensemble du corps enseignants, notamment en matière de formation pédagogique est insuffisante. Bref, pour que l’enseignement supérieur répond à son objectif de formation et continue naturellement à fonctionner; il apparaît indispensable de maintenir l’équilibre entre le potentiel intellectuel global du corps enseignant et celui des étudiants.
Or le corps enseignant est composé d’individus sujets à tous les aléas de la destinée humaine, à la dégradation de leurs énergies par vieillissement ou par dégradation de leurs connaissances. Si l’on n’y prend garde rapidement, le système aboutit à un état d’entropie qui le paralyse totalement. La production donc, pourrait continuer certes, mais ce serait une production sans aucune valeur sociale ou technique, et c’est le cas de notre université actuellement. Il faut donc, éviter cette dégradation à travers une production renouvelée et constamment renaissante d’objet adaptés à une qualité fixe ou variable en fonction des besoins. Toute production qui ne correspond pas à la finalité attendu d’elle ne serait être considérée comme production, mais comme simple résultats d’une dépense d’énergie. Elle n’aurait aucune valeur par elle-même (BRETON, G. & LAMBERT, M. 2003 : 121).
Ainsi, on peut dire, que la reproduction garantit la production, mais dans le système universitaire si le corps enseignant -source de l’énergie formatrice- ne se reproduit pas, il ne saurait produire des cadres valables et dont la formation correspond à l’état actuel des besoins nationaux, mais également ouvre déjà la voie vers l’avenir ; ces cadres devant avoir la capacité de se reproduire pour produire. Il est certain que l’enseignant est au centre de la production universitaire, il doit acquérir des connaissances plus larges et plus approfondies afin de répondre aux exigences de la formation dans le secteur de l’enseignement supérieur.
Dans notre pays, l’université n’est pas productive dans un sens économique, mais plutôt aussi reproductive, cette idée remonte jusqu’à 1971 ou l’université Algérienne a connue des réformes radicales. « Ce qui importe ce n’est pas de produire, mais de reproduire », cette phrase illustre clairement le constat actuel de l’université Algérienne à travers l’image « l’enseignant enseigné », l’enseignant est toujours un autodidacte de métier, s’il s’arrête d’apprendre, rapidement il constatera son incapacité à enseigné.
La formation que reçoit l’enseignant doit donc lui permettre l’extension et l’approfondissement de ses connaissances, mais également l’acquisition d’une capacité autonome de formation continue (DURU-BELLAT, M. & VAN ZANTEN, A. 2009 : 88). Cette capacité d’autoformation nécessite un renouvellement de connaissances, car on sait tous, que les connaissances ont un caractère très dynamique, elles ne sont pas données et assimilées que si elles ont été acquises de manière active. Cela n’est envisageable que par la voie de la recherche qui permet à l’enseignant d’abord de maîtriser les connaissances acquises, ensuite d’avoir une capacité de production continue. Toutefois, la recherche doit être la base du métier d’enseignant et non une activité qui se rajoute aux fonctions d’enseignant. Un autre problème auquel l’université est confrontée aujourd’hui, c’est le problème des chercheurs fonctionnaires (VAN ZANTEN, A. & DURU-BELLAT, M. 1999 : 127).
La majorité des universitaires sont des fonctionnaires de l’état (grades enseignants) à l’exception de quelques chercheurs qui travaillent aux centres de recherche. Contrairement à notre situation, dans certains pays anglo-saxons, les chercheurs ne sont pas forcément des fonctionnaires permanents, mais ils sont recrutés sous contrat comme des post-doctorants au sein des labos de recherche, qui occupent souvent des fonctions de chercheur pendant une durée déterminée. Par contre dans le cas de l’Algérie, l’université est loin de ce modèle, puisque la majorité des doctorants se retrouvent à l’université comme enseignants permanents ou vacataires.
La présence dans les laboratoires de recherche de post-doctorants qui n’ont pas nécessairement vocation à être ultérieurement recrutés dans la fonction publique en tant que chercheurs est un des facteurs clés de la compétitivité de la recherche d’un pays. On peut donc distinguer réellement entre les fonctionnaires qui sont destinés à la recherche et ceux qui sont destinés à l’enseignement, il est temps de revoir ce statut (enseignant-chercheur). Par ailleurs, il faut souligner que le problème ne se résous nullement en la nécessité de remédier le manque d’enseignants algériens dont souffre notre université.
Il ne s’agit nullement de mettre en place une machine à délivrer des diplômes permettant l’accès à différents corps de fonctionnaires, dont la tache est d’enseigner, mais la réaction la plus immédiate consisterait à une bonne formation des enseignants universitaires et d’écarter surtout l’idée qu’il faut rapidement combler les besoins de l’université en matière d’encadrement ou de former les enseignants pour se reproduire (MAIRI, L. 1994 : 69). Donc le grand débat sera un enjeu de perspective et de dynamisation permanente de l’université. On ne forme pas simplement des enseignants universitaires, mais aussi des chercheurs, car on bâtit l’université à travers une dynamique de recherche. L’université n’est pas uniquement, des mûrs et du matériel, mais aussi un bien de savoir ouvert sur le progrès et l’avenir.
2. Construction d’une société : un défi majeur pour l’université
Le rôle de l’université dans la construction des sociétés est plus déterminant aujourd’hui. En effet l’enseignement supérieur est essentiel à la création de la capacité intellectuelle, dont dépendent la production et l’utilisation du savoir et à la mise en œuvre des pratiques d’apprentissage tout au long de la vie nécessaires à l’actualisation des connaissances et des compétences individuelles (PAYAN, J-J.1998 : 105). Le savoir occupe actuellement une place importante et même grandissante dans le processus de construction des sociétés, certains le qualifier comme étant le moteur principal de la croissance économique et sociale de la société. L’accumulation et l’utilisation du savoir sont devenues des facteurs majeurs dans le processus de développement économique et sont de plus en plus à la base de l’avantage compétitif d’un pays dans l’économie mondiale. En dépit de l’avènement de ces nouveaux enjeux auxquelles l’université doit faire face, la plupart des pays en développement et en transition continuent à se battre avec les difficultés découlant de solutions inappropriées aux problèmes lancinants que connaissent leurs systèmes d’enseignement.
Parmi les défis non résolus demeurent la nécessité d’étendre le bénéfice de l’enseignement supérieur de manière durable, les problèmes de qualité et de pertinence de l’enseignement et la rigidité des structures administratives et des pratiques de gestion. Pour que l’université contribue efficacement au développement économique et social de n’importe quelle société, nous sommes convaincus qu’elle doit s’investir dans le capital humain d’abord à travers une formation de qualité, par ce que finalement, l’enseignement de qualité est devenu un enjeu international. Plusieurs pays orientent leurs politiques de l’enseignement supérieur vers un objectif bien déterminé, à savoir l’amélioration de la croissance économique et la réduction de la pauvreté, surtout dans les pays sous développés (PERELLON, J-F. 2003 : 89). C’est dans cette optique, que la Banque mondiale a apporté un soutien actif aux efforts de réforme de l’enseignement supérieur dans certains pays en développement.
Sur ce sujet plusieurs chercheurs s’interrogeaient sur l’importance de l’enseignement supérieur pour le développement économique et social et comment peut-il contribuer à l’amélioration de la capacité d’un pays ou d’une société à s’intégrer dans une économie mondiale de plus en plus axée sur le l’économie de la connaissance. A cet égard, Michael Gibbons affirme que, le monde global ne peut plus se satisfaire d’un mode de production qui repose uniquement sur une approche disciplinaire, mais bien au contraire, cela nécessite une approche multidisciplinaire.
Les universités ont selon lui toute leur part et toute leur place dans ce contexte, pour autant qu’elles s’impliquent davantage dans ce nouveau processus de production de connaissances. Sur la base de ces éléments, certains pays en voie de développement ont adopté des stratégies qui leurs permettent de modeler leurs systèmes d’enseignement supérieur pour faire face efficacement à la conjugaison de nouveaux et anciens enjeux dans un contexte où les forces du marché prennent une importance croissante pour l’enseignement supérieur. En revanche, ici, le rôle de l’Etat semble très important, en effet, son devoir est de mettre en place un cadre propice encourageant les établissements de l’enseignement supérieur à être plus novateurs et plus sensibles aux besoins d’une économie globale et compétitives du savoir et aussi plus adaptés aux conditions changeantes du marché du travail du capital humain de haut niveau.
Afin de réussir ce projet, il est nécessaire pour l’université de mener des stratégies de croissance fondées sur le savoir afin de former une main-d’œuvre qualifiée est adaptable de scientifiques de haut niveau, de professionnels, de techniciens, de futurs cadres et fonctionnaires de l’administration publique ainsi que de chefs d’entreprises. Cela bien évidement est positif pour le secteur économique et le développement de la société en général (KLEIBER, C. 1998 : 102).
Les universités apportent leur aptitude à intégrer et à créer des groupes au sein de ces trois dimensions. Une croissance durable de l’économie ne peut être réalisée sans la contribution d’un système d’enseignement supérieur innovant basé sur le développement des capacités. L’université dans ce sens, contribue d’une manière efficace au développement de la société à travers un enseignement de qualité qui peut offrir de meilleures opportunités d’emploi aux étudiants défavorisés, réduisant ainsi les inégalités, les normes, les valeurs et les connaissances que les universités transmettent aux étudiants constituent le capital social nécessaire à la constitution de sociétés civiles saines et de cultures socialement solidaires. Les investissements dans l’enseignement supérieur génèrent d’importants avantages induits qui s’avèrent déterminants pour le développement économique et social fondé sur le savoir.
La construction de la société du développement en fin de compte est une responsabilité pour l’université dans la mesure où, elle doit fonctionner selon une logique qui favorise la solidarité nationale en promouvant une cohésion sociale plus forte et participation ouverte. Par ailleurs, les sociétés diversifiées reposent sur la recherche et les analyses menées par les sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, l’amélioration de l’enseignement supérieur est nécessaire pour permettre un progrès durable pour la société.
L’économie, donc ne peut se transformer et connaître une croissance durable sans un système d’enseignement supérieur innovant permettant d’optimiser l’emploi des ressources d’investissement fournies par les organismes subventionnaires (CHEVALIER, J-M & PASTRE, O. 2002 : 33). En s’inspirant de l’expérience des pays industrialisés qui ont mis l’accent sur le rôle de l’éducation comme soutient à la croissance économique et à la cohésion sociale, il semble que le pourcentage d’investissement en éducation et les dépenses consacrées à l’enseignement supérieur représenteraient en générale 15 à 20% des dépenses totales en faveur de l’enseignement public. Cela veut dire que, l’enjeu est important dans la mesure où l’université est devant un défi majeur ; celui de la construction de la société.
L’investissement dans l’université est l’un des piliers important des stratégies de développement qui amplifie le mouvement de constitution d’économie et des sociétés démocratiques fondées sur le savoir. La banque mondiale, dans ce sens peut jouer un rôle central dans ce processus en facilitant le dialogue sur les politiques et le partage du savoir, en s’appuyant les réformes sur des prêts aux projets de création d’un cadre propice au développement de l’enseignement supérieur (9-p13).
3. Le développement économique : quel rôle pour l’université?
Du point de vue économique, l’université est devant un monde qui se caractérise par la globalisation, et l’économie reste le facteur ou bien l’indice le plus puissant dans le processus de développement des pays. En général le rôle de l’enseignement supérieur dans le développement est très important dans la mesure où l’université contribue d’une façon efficace au développement, en fournissant aux économies nationales les ressources humaines nécessaires. Suivant cette logique, certains pays en voie de développement ont adoptés une stratégie consistant à concevoir leur système universitaire de façon à aider à réduire l’écart en matière de connaissances et de technologies afin de faire progressé leurs économies.
Selon le rapport de l’ONU à propos du développement durable, l’éducation peut jouer un rôle considérable en matière de développement, surtout pour les pays en voie de développement. Cela s’explique par le fait que, l’éducation devienne une priorité pour ces pays (KLEIBER, C. 1998 : 106). La Banque mondiale de son coté pose l’enseignement supérieur au cœur de ses priorités. Elle prend en outre le soin de démontrer la corrélation entre l’enseignement supérieur, désormais qualifié de vital, et le développement économique des pays émergents.
Dans l’économie en voie de globalisation, l’enseignement supérieur a été inscrit à l’ordre du jour par l’OMC et devenu un marché où l’on compte par milliards de dollars, étant donné que la quantité d’éducation augmente rapidement. Dans le passé, l’enseignement supérieur a participé au développement en fournissant aux économies nationales les ressources humaines nécessaires, mais il a été critiqué pour ne pas avoir traité directement des questions de réduction de la pauvreté (PAYAN, J-J.1998 : 109). Mais aujourd’hui plusieurs pays croient au rôle indirect que pourrait jouer l’enseignement supérieur dans le développement et la réduction de la pauvreté tout en s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de la banque mondiale, qui a présenté trois arguments clés :
-
L’université peut contribuer à la croissance économique en fournissant les ressources humaines dont a besoin une économie ayant pour moteur « le savoir », en générant des connaissances.
-
L’université est en mesure d’élargir l’accès à l’éducation, de ce fait, d’améliorer les compétences requises pour une économie impulsée par le savoir.
-
Enfin, l’université pourrait jouer un rôle de soutien à l’enseignement de base en dotant ces sous-secteurs de personnel qualifié.
Face à ces enjeux, il est nécessaire de repenser le rôle de l’université dans le développement, car dans le temps actuel, l’enseignement supérieur s’oriente vers le soutien d’une économie à forte densité de savoir au niveau mondial. Alors certains pays même les moins développés accordent une grande importance à cette question. L’Afrique de sud, par exemple à procédé à un renouveau de son système universitaire à l’aide des nouvelles politiques de réforme sont élaborées au niveau institutionnel, de nouveaux dirigeants ont engagé des processus visant à revitaliser leurs institutions et à mettre au point de nouveaux plans stratégiques de développement. Si on parle du coté de la concurrence, l’université est face à un défi majeur, celui de promouvoir la coopération dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
De ce fait, les pays du nord dit développés, avec leur avantage compétitif font concurrence aux pays du sud pour absorber les meilleurs chercheurs de ces pays, la majorité ils se retrouvent devant l’exode des compétences. A cette égard, certains chercheurs qui travail sur cette question estiment que l’Afrique à perdu au profit de l’occident prés de 100 mille personnes ayant des compétences spécialisées. La perte annuelle pour le continent Africain est estimée à 23000 professionnels universitaires (SCHWARTZ, L. 1983 : 210). L’Algérie de son coté est parmi les pays qui sont touchés par ce phénomène, qui constitue l’un des principaux obstacles au développement.
Les pays de sud risque donc, encore une marginalisation si leurs systèmes universitaires ne participent pas aux activités de production des connaissances qui les rendraient utiles et plus réceptives aux besoins de la société. Pour promouvoir la coopération dans un environnement concurrentiel, il faut tenir compte des réponses actuelles des institutions aux changements mondiaux et aux menaces perçues comme venant de l’intensification de la concurrence. Les universités du sud ont réagi de manière différente aux défis auxquels elles sont confrontées du fait de la globalisation. Deux défis se manifestent concernant ce point : le premier est d’entrer dans les réseaux de coopération, et le second est de produire des connaissances ou de les utilisées aux fins du développement.
Concernant ce dernier point, les universités des pays sous développés doivent consacrés une part de plus en plus grande de leur temps pour la recherche. Elles doivent aussi participer aux nouveaux arrangements mise en place par les pays développés en matière de production de connaissances et d’innovation. En l’absence de coopération visant à associer les universités à cette politique, l’écart entre les nations riches et les nations pauvres risque de ne pas se réduire. Si la richesse mondiale a progressé, la paupérisation de l’Afrique s’est aggravée. Il convient donc, de donner aux pays qui reçoivent l’aide la responsabilité de la mettre en œuvre selon leurs propres priorités. Les universités du sud, bien qu’elles soient dans une situation critique par manque de moyens, peuvent contribuer à ce changement.
Le partenariat entre universités pourrait contribuer au renforcement des compétences en matière de production et d’utilisation des connaissances aux étudiants et de contribution au développement de ressources humaines très qualifiées qui pourraient à leur tour contribuer au développement. Il faudrait donc que les universités du sud prennent l’initiative de se renforcer pour pouvoir répondre aux besoins d’une nouvelle économie mondiale.
4. Université, entreprise et croissance économique : relation complexe
Des travaux plus récents des économistes, ont démontrés que la croissance économique dépend de ce qu’ils appelaient « l’économie de la connaissance », cette croissance exige de plus en plus une intégration rapide des connaissances de leur application dans le système productif (PETITAT, A. 1982 : 14). Cette intégration appelle une coordination entre les efforts de recherche et développement privé et public, le développement de la diffusion des connaissances par l’université et une proximité entre l’industrie, l’université et la recherche.
Alors l’université, qui occupe une place centrale dans la production de connaissances, doit devenir l’acteur pivot de ce triangle, c’est-à-dire, elle doit se rapprocher de l’industrie et entreprenne des travaux de recherche en partenariat avec des entreprises. Les universités ne sont plus les acteurs uniques de la production de connaissances et des innovations, mais une de leurs missions principales est la promotion des recherches.
Dans la logique de l’économie de la connaissance, les universités doivent s’ouvrir vers l’extérieure (vers les entreprises), pour trouver des formes originales qui valorisent leurs efforts de recherche et de contribuer avec efficacité au développement économique de leur environnement. Les Américains sont les premiers à appliquer ce model appelé le triangle magique (université, recherche, industrie), ils ont réussi à mettre en place ce model de développement économique. Le secret du succès de ce model, réside dans le partenariat entre l’industrie et l’université.
Le modèle Américain nous éclaire d’une façon sur ce qui constitue un retard Algérien : de notre système d’enseignement supérieur, et en particulier de nos universités. En Algérie, les éléments du triangle sont largement isolés les un des autres, et cela constitue des freins les plus importants à la croissance économique. Or que le succès repose sur un principe simple : le développement de l’esprit d’entreprise au sein des universités (BENACHENHOU, M. 1980 : 22). Il faut que ces dernières participent aux entreprises en finançant par exemple des étudiants pour effectuer des stages pratiques, ces entreprises à leur tour investissent dans des projets de recherche, en coopération avec ces mêmes universités. Une telle initiative nous permettre d’avoir une croissance économique considérable. Dans ce triangle magique, tous les acteurs sont gagnants : Les laboratoires de recherche attirent de nombreux étudiants et chercheurs de qualité. Le secteur économique bénéficie le plus rapidement possible des innovations. Les universités s’enrichissent part les revenus des brevets et licence et part les retours sur investissements.
Mais les pays moins développés à l’image de l’Algérie, sont loin de cette logique, car on constate que le partenariat entre l’université et l’entreprise est très faible et souvent la recherche universitaire reste isolée des réalités et préoccupations économiques, et dans ce cas, les étudiants sont découragés d’entreprendre des études doctorales. Cependant, il faut signaler par ailleurs, que les moyens dont dispose la recherche universitaire Algérienne sont très faibles. Pour que l’université soit au cœur de la croissance économique, il est nécessaire de lui donner plus de moyens et une volonté politique de mener des réformes à long terme, bien étudiées et selon les besoins de la société (MAIRI, L. 1994 : 70). Dans l’analyse de la définition de ces besoins, trois tendances essentielles doivent être prise en compte :
1/Les besoins grandissants de formation professionnelle, il s’agit d’un secteur en plein croissance qui est d’autant plus nécessaire qu’il accompagne la technologie pour acquérir un savoir professionnel tirer de l’expérience.
2/L’ouverture internationale, c’est une priorité effective de formations supérieures afin de susciter des programmes d’échanges qui permettent aux étudiants d’accéder aux meilleurs enseignements, mais d’élargir leurs réseaux relationnels à l’échelle mondiale.
3/ Le développement des partenariats avec les entreprises pour permettre aux universités de bénéficier d’un terrain d’expérience pour ces chercheurs et de profiter des innovations technologiques.
Conclusion
Après avoir analysé ce que la relation complexe (université, savoir, et développement) à dévoiler comme enjeux parfois paradoxaux, il nous semble important de résumer brièvement ce que nous espérons voir dans le nouveau visage de nos universités. Pour que l’université contribue au développement de la société, elle doit être : ouverte sur le monde, en développant un esprit de partenariat avec d’autres universités afin d’arriver à une politique internationale sur l’enseignement supérieur. Elle doit être également dynamique, pratique, ambitieuse et riche en moyens financiers et matériels.
Toutes ces caractéristiques doivent être les principes qui guideront la réforme urgente de notre université, car il faudra beaucoup de courage et de travail pour réduire la fracture sociale en remettant en ordre de marche d’ascenseur social. Nous n’avons pas besoin de réformes cosmétiques, mais bien au contraire des changements en profondeur, menés avec constance et ténacité et qui peut permettre à l’université de régler l’un des problèmes les plus compliqués, les plus handicapants de son histoire : l’inadaptation générale de son système d’enseignement supérieur aux besoins de la société et de l’économie.
Références bibliographiques
-
BENACHENHOU, M. (1980). Vers l’université Algérienne, édition OPU, Alger.
-
BRETON, G. & LAMBERT, M. (2003). Globalisation et universités, édition Unesco, université Laval, Paris.
-
CHEVALIER, J-M. & PASTRE, O. (2002). Où va l’économie mondiale, édition Jacob, Paris.
-
DURU-BELLAT, M. & VAN ZANTEN, A. (2009). Sociologie du système éducatif, édition PUF, Paris.
-
KLEIBER, C. (1998). Vers une société fondée sur l’éducation, édition GSR, Suisse.
-
LORENZI, J-H. & PAYAN, J-J. (2003). L’université maltraitée, édition Plon, Paris.
-
MAIRI, L. (1994). Faut-il fermer l’université? Edition ENAL, Alger.
-
MALLET, D. & BALME, P. & RICHARD, P. (2002). Réglementation et management des universités, édition Berger-Levrault, Paris.
-
NATHALI, M. (2007). Les nouvelles politiques éducatives, édition PUF, Paris.
-
PAYAN, J-J. (1998). Le chantier universitaire, pour bâtir l’avenir, édition Beaucheste, Paris.
-
PERELLON, J-F. (2003). La qualité dans l’enseignement supérieur, édition PUR, Suisse.
-
PETITAT, A. (1982). Production de l’école, production de la société, édition Droz, Genève.
-
RENAUT, A. (2002). Que faire des universités ? Edition Bayard, Paris.
-
SCHWARTZ, L. (1983). Pour sauver l’université, édition Seuil, Paris.
-
VAN ZANTEN, A. & DURU-BELLAT, M. (1999). Sociologie de l’école, édition, Armand Colin, Paris.