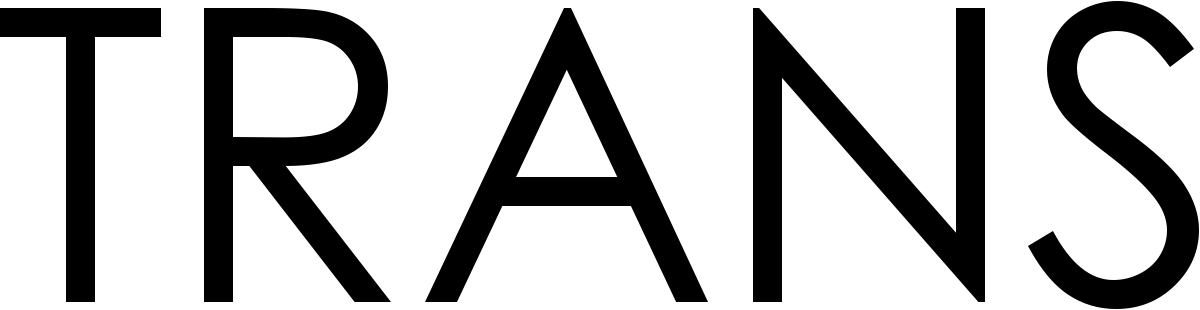PAMPHILE BIYOGHÉ
Ecole Normale Supérieure de Libreville, Gabon
Résumé
Notre contribution s’inscrit dans le champ thématique « le monde en Afrique et l’Afrique dans le monde », en vue d’examiner la gouvernance politique et la gouvernance territoriale des dirigeants d’Afrique subsaharienne. Car, on avance bien des raisons pour expliquer le mal politique de l’Afrique, et pourtant, les causes du drame sont encore fort mal examinées par de nombreux universitaires, politiques et chercheurs africains et non africains. De ce fait, notre article tentera d’analyser, de façon significative et pertinente, les raisons politico-stratégico-militaires de la dégénérescence continentale. Mieux, il s’agira pour nous de cerner les causes du drame politique du berceau de l’humanité, afin de proposer des voies de sortie, suivant le paradigme d’intelligibilité polémologique -qui pose à nouveaux frais le statut du militaire pour sortir de l’impasse et de la myopie politiques. C’est une sévère confrontation sur les convergences et divergences de situation et d’analyses dans certains pays d’où les enjeux politiques et économiques mobilisent l’attention de la communauté internationale. De « l’idéologie ethnique » aux drames des armées mercenaires et auxiliaires, en passant par des armées infractionnistes, notre contribution s’efforcera in fine de saisir le rapport substantiel du politique et du militaire non seulement pour donner la clé de compréhension définitive du désarroi politique tropical, mais encore et surtout pour exhumer la nécessité d’instituer des armées républicaines et loyalistes, au double sens d’armées dévouées à la cause nationale et au respect de la loi. C’est tout le sens d’une exigence de reconfiguration de la « culture » politico-militaire des dirigeants africains, tant il est vrai que « la séparation de l’arme et de la toge, ainsi que la subordination de celle-ci à celle-là, constitue deux aspects décisifs distinguant l’Etat développé de l’Etat sous-développé. Dans le premier, la tension naturelle civile-militaire est stabilisée et le contrôle des armes par le politique institutionnalisé. Dans l’Etat sous-développé, en revanche, la frontière civile-militaire est poreuse et conflictuelle et la domination du militaire par le pouvoir peu effective » (Michel Louis Martin, 1990 : 3).
Mots clés : Afrique subsaharienne, armées auxiliaires, armées mercenaires, armées républicaines et loyalistes, art de la guerre, drame continental.
Introduction
Y a-t-il une alternative aux conflits armés qui déchirent l’Afrique subsaharienne?
Cette question, centrale et décisive en l’espèce, est à poser à neuf. Et pour cause : dans un ouvrage collectif, au titre évocateur, Peut-on être vivant en Afrique ?, Philippe Engelhard s’interroge à juste titre sur le destin continental: « Existe-t-il-une fatalité africaine ? » (Engelhard, P., 2000 : 12).
En effet, si l’on en croit Monique Chemillier-Gendreau, « l’interrogation dérange. Elle peut même apparaître, avant réflexion, comme inconvenante. A coup sûr, elle recèle une charge de violence. […] Et s’interroger sur la possibilité d’être vivant en Afrique est, à n’en pas douter, une question urgente. » (Chemillier-Gendreau, M., 2000 : 7). Et Blaise Pascal Talla de faire observer à grand dépit : « 30 : c’est le triste nombre des foyers de conflits ardents, latents ou en cours d’extinction sur le continent africain aujourd’hui. La carte des conflits nous montre un continent ravagé du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Alors, la guerre est-elle une fatalité pour l’Afrique ? […] Je peux affirmer avec force que non. Cette terre, berceau de l’humanité, mérite un meilleur sort. » (Blaise-Pascal Talla, 2008 : 3).
Accordons tout cela, mais pour ajouter que l’Afrique subsaharienne reste encore et indéniablement le plus grand perdant de l’histoire (politique, économique, religieuse, technologique, etc.). D’ailleurs, nous devons à la vérité de rappeler qu’aucun continent n’a subi et ne subit d’aussi lourdes pertes que l’Afrique. Depuis la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.) à Addis-Abeba (Ethiopie) le 25 mai 1963, le berceau de l’humanité reste paradoxalement marqué par une profonde et terrible traversée génocidaire, allant de l’Afrique du Nord à l’Afrique Australe, en passant par l’Afrique centrale, l’Afrique orientale et la région des Hautes terres. L’obscurantisme politique des gouvernants laisse croire que ce continent et la démocratie seraient ontologiquement dissociés, et leur liaison serait un rapport de négation réciproque, à telle enseigne que l’Afrique subsaharienne n’a jamais ressenti la chaleur d’une sécurité politique. La hantise perpétuelle de perdre la vie est le quotidien des masses populaires africaines au Cameroun, au Mali, au Nigéria, en République centrafricaine, en République Démocratique du Congo, en Somalie, au Soudan, au Tchad, etc.
En effet, les crises politiques, aux conséquences incontrôlables et imprévisibles, se succèdent, sans que les gouvernants prennent le temps de les analyser et de les solutionner. Des différends régionaux aux différends communautaires, frontaliers et éthiques, la faillite de la raison paraît indiscutable, tant de nombreux dirigeants politiques africains, à l’exception de feu Madiba Tata Nelson Mandela, sont -à bien juger- des liquidateurs incontestés et incontestables du droit, sous la double forme du droit constitutionnel et des droits de l’homme. Et si cela ne risquait pas d’être jugé méchamment, le terme biblique de déchéance a droit de cité, avec le principe de la lutte armée qui y trouve son écho le plus sonore. D’ailleurs, l’observateur critique peut localiser la constatation suivante : le continent, particulièrement l’Afrique subsaharienne, n’a jamais connu autant de conflits depuis qu’il s’est doté d’une nouvelle organisation, l’Union Africaine (U.A.). De nombreux chercheurs laissent entendre que plus de 30 conflits armés ont éclaté en Afrique entre 1963 et 2000, affectant près de 70% de la population du continent, avec près d’une cinquantaine de guerres civiles.
Aujourd’hui, avec les crises malienne, centrafricaine et nigériane, nous vivons une extraordinaire accélération des évènements et, en même temps, les changements observés ailleurs restent à beaucoup d’égards suspensifs, en raison des proportions génocidaires des violences et de la montée de l’extrémisme. L’érosion de la conscience politique est presque totale, avec une dévaluation des aspirations démocratiques. Alors que l’Union Africaine, portée à grand bruit sur les fonts baptismaux en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), a été célébrée comme une opportunité historique pour penser à nouveaux frais au plan théorique et pratique le panafricanisme – l’idéologie phare de Kwame Nkrumah (Africa must unite / l’Afrique doit s’unir)-, douze ans après sa création, le bilan est au mieux mitigé, au pire négatif. Pas plus que l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.), l’Union Africaine (U.A.) n’apporte vraisemblablement rien à l’Afrique si ce n’est la destruction du consciencisme à visage panafricaniste. Avec l’Union Africaine, le berceau de l’humanité reste -bien plus que par le passé- le continent des platitudes politiques, parce que traversé par des décennies de guerres et de sang ; un continent où la quête de la paix et de la sécurité reste le défi majeur, avec des Etats politiquement sclérosés et aux économies moribondes. Les espoirs perdus et trahis sont devenus plus explosifs que l’absence d’espoir, du fait de la soumission du continent aux idéologies liberticides telles que le fondamentalisme religieux, l’intégrisme, le népotisme, le despotisme et bien plus encore.
Le génocide rwandais, la guerre entre frères-ennemis Ethiopie-Erythrée, les drames angolais, burundais, congolais, centrafricain, guinéen, ivoirien, namibien, sierraleonais et soudanais sont autant de crises qui déshumanisent le continent africain. D’où la question essentielle : y a-t-il une alternative raisonnable aux conflits armés qui secouent l’Afrique subsaharienne ?
Le vent de l’Est n’a pas conduit l’Afrique vers la paix et le développement, et ce malgré l’élan de démocratisation considéré -bon gré mal gré- comme une des conséquences de la guerre froide. Et à tout point de vue, l’Afrique reste synonyme de dérive totalitaire et humanitaire, synonyme aussi de dérapages, de déséquilibres et d’injustices inacceptables. Toutes choses qui donnent à penser que la première idée majeure de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine reste lettre morte, parce que la libération politique du continent oscille toujours entre idéal et utopie. Les conflits politiques en date se passent comme si l’on revenait -hélas!- aux mêmes conflits d’intérêts et au jeu des puissances (les Etats-Unis, la Chine, l’Union européenne).
Les crises interétatiques se multiplient en raison d’oppositions prétendument « ethniques », religieuses et culturelles. De la sorte, il est permis de penser que le discours du 20 juin 1990 de La Baulle (France), de François Mitterrand, prononcé lors de la 16e Conférence des chefs d’Etat d’Afrique et de France, n’était qu’une formule de rhétorique, un discours paresseux d’intention, d’autant plus qu’il n’a pas permis de faire disparaître la françafrique, ce sanctuaire des réseaux qui, historiquement, avait envoûté le continent via des services secrets, des sociétés et lobbies des hommes politiques et affairistes. D’ailleurs, nous constatons que, sans résultats satisfaisants, des opérations de maintien de la paix sont déployées sur le continent, sous l’égide d’organisations régionales et internationales. De ce fait, Jacques Lanxade a plus de motifs qu’il n’en doute d’affirmer :
L’émergence de ces crises est facilitée par une certaine indifférence des grandes puissances lorsqu’elles concernent des zones dont l’intérêt stratégique a beaucoup diminué et dont l’intérêt économique dans le système libéral qui domine aujourd’hui est limité. Le sous-développement s’y accroît de ce fait, ce qui favorise l’instabilité interne des Etats. L’Afrique subsaharienne est la zone la plus touchée par ce processus. (Jacques Lanxade, 2000 : 235).
Tout se passe donc comme si nous étions dans une logique sacrificielle des damnés de la terre, une sorte de fatalité apocalyptique, dont l’histoire politique est celle de la répétition des mêmes drames, des mêmes conflits armés, avec des auteurs aux costumes variés, suscitant l’incertitude des lendemains. D’où cette déclaration de Jean Ziegler : « L’humiliation, l’exclusion, l’angoisse du lendemain sont le lot de centaines de millions d’êtres humains. Surtout dans l’hémisphère Sud. Pour eux, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations unies, ne sont que des paroles creuses. » (Jean Ziegler, 2008 : 19).
Cette déclaration fait écho au triste constat de Blaise-Pascal Talla :
Depuis le génocide rwandais de 1994 et son cortège de près d’un million de morts, la communauté internationale éprouve une sorte de mauvaise conscience à l’égard de l’Afrique. Elle gère encore plus mal qu’ailleurs les conflits qui y éclatent, laissant à l’organisation des Nations unies (O.N.U.) le soin d’énoncer des principes théoriques lui permettant de se tenir à l’écart de la réalité. Qu’il s’agisse des affrontements entre l’Ethiopie et l’Erythrée, entre la République démocratique du Congo et ses voisins, ou des guerres civiles en Sierra Leone, au Congo ou en Angola, les grands de ce monde se font discrets. Leur action s’est souvent limitée à des envolées lyriques, à l’énonciation de vœux pieux, au mieux à l’organisation de quelque conférence. […] Aux Etats-unis, notamment, la plupart des hommes politiques de tous bords estiment désormais qu’aucune guerre, aucune catastrophe survenant en Afrique ne mérite que l’on mette en jeu la vie d’un seul soldat américain. (Blaise-Pascal Talla, 2000 : 5).
D’où la haine de l’Occident dont parle Jean Ziegler :
Cette passion irréductible habite aujourd’hui une grande majorité des peuples du Sud. Elle agit comme une force mobilisatrice puissante. Cette haine n’est en aucun cas pathologique, elle inspire au contraire un discours structuré et rationnel. Et elle paralyse les Nations unies. Bloquant la négociation internationale, elle laisse sans solutions des conflits et de graves problèmes qui, pourtant, engagent, à l’occasion, la survie même de l’espèce. L’Occident, de son côté, reste sourd, aveugle et muet face à ces manifestations identitaires, fondées sur un désir d’émancipation et de justice émanant des peuples du Sud. […] C’est que la mémoire de l’Occident est dominatrice, imperméable au doute. Celle des peuples du Sud, une mémoire blessée. Et l’Occident ignore la profondeur et la gravité de ces blessures. (Jean Ziegler, 2008 : 14).
1. Intérêt de la réflexion
L’actualité politique africaine nous talonne. Sur les 49 pays les plus pauvres du monde, 33 sont incontestablement situés en Afrique et touchés par la crise. Et comme on peut s’en convaincre, l’Afrique subsaharienne fait l’objet d’un regard profondément pessimiste et d’un traitement misérabiliste de la part de nombreux auteurs, chercheurs et universitaires occidentaux et afropessimistes. Tout se dit comme si les Africains étaient incapables de relever le défi du drame qui secoue cette partie de la planète, pourtant berceau de l’humanité. Les jugements les plus aigus, savamment distillés ici et là, donnent à penser que les dieux et les sages se sont retirés du continent, en le laissant dans un cycle de désespoir, dans une flambée de violences à la vérité sans précédent. C’est du moins ce que laisse entendre terriblement Jean-François Bayard dans La criminalisation de l’Etat en Afrique, notamment lorsqu’il écrit :
« […] La probabilité est forte du retour de l’Afrique noire « au cœur des ténèbres ». Non, répétons-le, celles de la « tradition » ou de la « primitivité », mais celles de son insertion dans le système international par l’intermédiaire d’une économie d’extraction ou de prédation dont nombre des opérateurs sont étrangers et traitent avec des partenaires autochtones plus ou moins militarisés. » (Bayard, J.F., 1997 : 159). Aussi ajoute-t-il : « A en croire la rumeur du globe, l’Afrique subsaharienne serait en quelque sorte le limbe du système international, le bord extérieur de cet astre que nous habitons. Mais, toujours selon l’expérience commune, il est peu probable qu’elle séjourne dans les limbes de ce dernier, au sens où l’entend alors la théologie catholique, c’est-à-dire au seuil de la Rédemption. » (Bayard, J.F., 2006 : III).
Si l’on en croit J.F.Bayard, on est tenté de dire que celui qui regarde l’Afrique subsaharienne et l’interroge ne peut manquer de constater, avant toute chose, qu’elle passe et repasse dans les marges malheureuses de l’humanité, tant la stabilité politique paraît un rêve inaccessible.
Cette lecture, frappée du sceau défaitiste, ne saurait être partagée à nos yeux. Car en effet, comme le note paradoxalement Jean-François Bayard lui-même ; « depuis l’âge d’Adam l’arbre du mal est aussi celui de la connaissance. » (Bayard, J.F., 1997 : 162). Tout ceci pour dire que même si nous sommes dans une situation incertaine, nous n’avons pas le droit moral d’être découragés, désespérés, inquiets. Parce que précisément, s’il est vrai qu’il existe un horizon du désespoir, il est tout aussi vrai que c’est même à l’intérieur de cet horizon que se trouve notre espérance, celle qui permettra de résister au processus du drame à travers les critères de la rationalité politique, dans l’unité du politique et du militaire. En clair, il nous faut rompre avec l’idéologie pessimiste, parce que davantage, si l’on en croit le poète allemand Hölderlin, « là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Et, plus le péril est grand, plus la conscience du danger est grande, plus elle nous dit que nous pouvons trouver des solutions et nous donne des idées qu’il faut pour lutter contre le danger. Encore faut-il le rappeler : souvent, dans l’histoire, l’improbable est arrivé. Pour cette raison, l’interpellation de Jean-Marc Ela trouve sa pertinence et son sens :
Bousculé par l’urgence des défis qui acculent de nombreux intellectuels africains à choisir entre l’exil et la misère, le chercheur ne peut se dérober à la nécessité de soumettre l’état du continent noir à un effort global de réflexion et d’analyse afin de mieux comprendre ce qui nous advient et, peut-être, trouver une issue aux impasses actuelles. (Ela, J.M., 1994 : 7).
Cette invite, adressée aux intellectuels africains, est pour nous un impératif catégorique, qui donne sens et ouverture à l’afroresponsabilité. Autrement dit, il est urgent d’interroger l’actualité de l’Afrique subsaharienne, de faire un état des lieux, de comprendre les raisons du désarroi politique, et surtout de proposer des solutions.
En effet, au cœur d’un passé trahi et d’une histoire falsifiée, nous avons le devoir intellectuel et le droit moral d’engager une réflexion en responsabilité, à l’effet de circonscrire, hors des querelles de chapelles, les raisons du désarroi politique et de proposer des voies de sortie. C’est à ce titre que cet article ambitionne une nouvelle grille d’intelligibilité du drame continental, suivant le paradigme polémologique. Car, outre les facteurs sociaux et économiques, il faut inverser l’illusion, parce que la vérité est ailleurs : l’inculture de l’artmilitaire joue le rôle majeur du mal politique en Afrique subsaharienne. Cela n’est guère étonnant, du fait que « les élites martiales ont passé plus de temps aux commandes de l’Etat en Afrique que les élites politiques civiles », à en croire Michel Louis Martin dans Le soldat africain et le politique : essai sur le militarisme et l’Etat prétorien au sud du sahara. Pis encore,
depuis 1960, on estime à près de soixante-dix les coups de force suivis d’une occupation militaire des sites du pouvoir politique en Afrique noire, dont plus de trente Etats en firent l’expérience. Dans maints Etats, les militaires ont gouverné plus longtemps que les civils; soit pour l’ensemble du continent sub-saharien, une année sur trois depuis les indépendances,
observe le professeur de sociologie politique en 1990 (Michel Louis Martin, 1990 : 4). Pour cette raison, la principale cause du drame politique qui mobilise notre réflexion est l’inculture du métier des armes, le manque de connaissance ou la non-maîtrise de l’art de la guerre par les dirigeants des régions concernées. Dans ce sens, nous soutiendrons avec Hugh Mc Cullum que
voir l’Afrique à travers des histoires d’horreurs et un humanitarisme perverti, c’est escamoter tout le système économique oppressif pudiquement baptisé « mondialisation », c’est faire fi des industries de la communication des USA et d’Europe dont l’impérialisme culturel s’infiltre partout, c’est refuser de voir la livraison d’armes -et pour de grosses sommes- … (Hugh Mc Cullum, 1996 : 29).
2. L’idéologie ethnique : argument fallacieux et préjugé historique de l’anthropologie coloniale
Expliquer le drame politique continental à partir des oppositions ethniques relève d’une vision simpliste et erronée de la réalité sociopolitique africaine. Autrement dit, l’ethnisme ne saurait, en toute objectivité, justifier les crises politiques qui secouent la quasi- totalité des pays de l’Afrique subsaharienne.
En effet, parlant par exemple de la région des « Hautes terres » (le Burundi, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie), nous devons à l’histoire de préciser que c’est l’anthropologie coloniale qui a fractionné les sociétés africaines avec des clivages ethniques, aux intérêts et finalités politiques certains, inavoués et paralysants. Ainsi que nous le montrent avec brio les analyses de Michel Bührer dans Rwanda. Mémoire d’un génocide : peu avant la mainmise européenne sur le Rwanda, les termes hutu et tutsi distinguaient effectivement des catégories de la population, mais elles ne fondaient pas des sentiments d’appartenance identitaire conflictuels. C’est donc l’arrivée des colonisateurs dont les continuateurs sont les « nouveaux maîtres du monde », qui introduit le virus de la division ethnique; une division aujourd’hui entretenue par ceux qui vivent dans l’empire de la honte et que Jean Ziegler s’accorde à nommer avec juste raison « les nouveaux maîtres du monde ».
Il y a donc une erreur d’analyse et d’appréciation à vouloir expliquer la dégénérescence continentale à partir des antagonismes ethniques. A ce sujet, le propos d’André Guichaona se révèle pertinent, notamment lorsqu’il écrit :
Si l’«ethnie » est bien le vecteur de la mobilisation partisane, l’explication ethnique de la crise est à la fois un symptôme d’indigence intellectuelle et un paravent politique : les événements rwandais d’avril 1994 constituent le dénouement programmé d’une crise politique méthodiquement portée à son paroxysme. De même, au Burundi, les usages de l’ethnisme peuvent très précisément être analysés en parallèle des stratégies politiques. (André Guichaona, 1995 : 20-21).
Hugh Mc Cullum corrobore :
Le bon sens populaire est dangereusement simpliste quand il déclare que la tragédie du Rwanda est une poussée sauvage, primitive d’antagonisme ethnique (ou tribal), s’ajoutant à la liste déjà longue de toutes ces crises africaines de violence insensée. Outre le racisme à peine voilé de cette analyse, (…) cela permet à la communauté internationale d’esquiver ses complicités. (Hugh Mc Cullum, 1996 : 31).
D’ailleurs, l’ancien premier ministre rwandais et ancien leader du Mouvement Démocratique Républicain (MDR, principal parti de l’opposition), un hutu, Faustin Twagiramungu déclare :
C’est ridicule. Nous pourrions être parmi les peuples les plus heureux d’Afrique. Nous avons la même langue, les mêmes croyances. Il n’y a pas de chant ou de danse ou de rythme de tambours qui soit spécifique à l’un ou à l’autre dans notre population. Nous avons eu des conflits avant la période coloniale, par exemple pour des questions de propriété foncière, et on s’est parfois battu un peu, mais les chefs réglaient ça par la coutume et il n’y a jamais eu de destructions comme nous venons d’en subir. (propos rapportés par Hugh Mc Cullum, in Dieu était-il au Rwanda ? La faillite des Eglises, Paris, l’Harmattan, 1996, p. 32, ouvrage préfacé par Desmond Tutu).
Cette lecture du sociologue A. Guichaona et de l’expert Hugh Mc Cullum est également partagée par l’ancien président du Burundi, de 1987 à 1993, avant de revenir en 1996, Pierre Buyoya :
Je tiens avant tout, à souligner le constat suivant : il n’y a pas souvenance dans la mémoire populaire d’une quelconque guerre ethnique au Burundi, avant l’arrivée des colons. La société précoloniale n’était pas pour autant un Eden. Elle était traversée par des inégalités et des luttes. Mais à aucun moment ces luttes ne prendront une tournure ethnique. […] Le virus de la division ethnique au Burundi a été inventé et inoculé à notre société par les colonisateurs. Ce sont en effet les nouvelles règles du jeu introduites par la colonisation, qui ont pétrifié, rigidifié et fossilisé les rapports. […] L’anthropologie coloniale ne s’est pas cantonnée à fausser l’écriture de l’histoire du peuplement, elle a aussi forgé puis véhiculé l’image d’une société burundaise pyramidale. Une société coiffée en haut par les éleveurs Tutsi censés détenir le pouvoir, et constituée à la base par les agriculteurs Hutu et les Twa, groupe numériquement insignifiant. » (Pierre Buyoya, 1998 : 49-54).
Ces propos de l’ex président burundais laissent penser que l’histoire a été falsifiée et détournée, à l’effet de rendre permanents les conflits armés sur le continent africain. Et, c’est cette falsification de l’histoire qui nous permet de disqualifier les analyses de Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Bayard, dont le regard sur la profonde et sévère déstabilisation de la région des Grands Lacs met toujours en évidence « l’idéologie d’une ethnicité très particulière, celle mise en œuvre dans l’opposition Hutu-Tutsi ».
En effet, Jean-Pierre Chrétien, un des principaux intervenants dans les débats politiques sur le continent africain, tombe (lui aussi !) -à grand dépit- dans les travers des analyses, notamment lorsqu’il écrit, en termes très tranchants et par ailleurs perplexes :
L’avenir, si avenir il y a, suppose donc, un nouveau contrat social fondé assurément sur un ensemble de garanties et de compromis, mais avant tout sur une véritable révolution culturelle, sur une désaliénation, sur la désintoxication d’un schéma ethniste, dont les références essentielles sont le sang et la mort. Au risque de choquer tel ou tel, il faut dire que Rwandais et Burundais ne peuvent que ressentir le malheur d’être nés hutu ou tutsi, des identités sociales sans richesse culturelle propre, mais revendiquées chaque fois qu’il s’agit d’évoquer des situations pénibles, des peurs, des persécutions ou options honteuses, des souffrances et des catastrophes. (Jean-Pierre Chrétien, 1997 : 384-385).
Cette analyse biaisée -du mal continental- relève aussi bien de la mauvaise foi que de la ruse de l’Occident. Ceci est d’autant plus important à souligner que certains analystes tentent aussi de présenter la prétendue diversité ethnique comme source du drame somalien, et ce en faisant valoir l’argument fallacieux d’une rivalité politico-tribale au sein de l’armée somalienne : ce qui est historiquement et sociologiquement inexact. Car, en effet, la Somalie présente une unité raciale, religieuse, ethnique et linguistique indéniable. Malgré la complexité d’un système de lignages, avec des clans et sous clans, nous devons reconnaître avec Antonio Torrenzano que « le pays présente une homogénéité ethnique et culturelle assez rare sur le continent africain : le peuple somalien parle une même langue -le somali- et pratique une seule religion -l’islam sunnite- » (Antonio Torrenzano, 1995 : 9). Ce pays est homogène, à 99% musulman et 99% arabophone. Dès lors, les causes du drame somalien sont à chercher dans l’usage des armées auxiliaires, mercenaires et mixtes, qui alimentent depuis toujours cette crise. Dans tous les cas, comme nous le montrerons, la Somalie est un foyer de tension des milices, des armées auxiliaires et infractionnistes, faute d’armée républicaine et loyaliste.
3. De la critique des armées mercenaires et auxiliaires à la nécessité d’instituer des armées républicaines
La question militaire est de tout temps au centre de la politique, et cela pour la principale et bonne raison que l’art de gouverner, de quelque manière qu’on l’envisage, se ramène à l’art de la guerre. Rien d’étonnant d’entendre cette boutade de Maurice Duverger : « Le premier qui fut un roi fut un soldat : cette boutade suggère que les armes sont la source du pouvoir, et qu’il repose d’abord sur elles. » (Maurice Duverger, 1964 : 189).
En effet, les armes constituent le moyen le plus propre, le plus approprié et le plus sûr pour quiconque gouverne ou aspire à gouverner ou à maintenir la stabilité de l’Etat. D’ailleurs, à la question de savoir « quel est l’instrument essentiel du pouvoir ? », Bertrand de Jouvenel répond : « L’armée » (Bertrand de Jouvenel, 1998 : 309). Dès lors, les principaux fondements qu’ont les Etats forts sont les bonnes armes et les bonnes armées. Cette éclatante articulation logique des armes et du pouvoir politique indique que la vie politique et la vie militaire sont intimement liées, et ce d’autant plus que la politique est avec juste raison considérée comme l’art de bien gouverner la cité, c’est-à-dire d’assurer la stabilité de l’Etat, le salut de la patrie, la concorde intérieure et la sécurité extérieure.
Ce lien entre la vie politique et le métier des armes est aussi, à n’en point douter, ce qui rend le politique dépendant. Car, que vaut-il sans une force armée ? Nous sommes tenté de dire rien du tout. Parce que le seul art du politique est celui du chef militaire. Dire Etat, c’est dire justice des armes. La question militaire est donc au centre de la politique. Et l’histoire nous enseigne avec Tite-Live et Machiavel que « tous les prophètes armés ont vaincu, et que les désarmés ont été détruits. » (Machiavel, 2001 : 52). Moïse, Cyrus, Thésée, Romulus et César Borgia ont fait observer leurs lois parce qu’ils étaient armés. Les dirigeants qui pensent plus aux plaisirs qu’aux armes et aux bonnes armées échouent fatalement. Le fait d’être désarmé rend le politique méprisable, ce qui est l’une des infamies dont les dirigeants doivent se garder, parce qu’entre un homme armé et un homme désarmé, entre un Etat armé et un Etat désarmé, il n’y a pas de commune mesure; et il n’est pas raisonnable que celui qui est armé obéisse à celui qui est désarmé.
Tout compte fait, nous devons préciser que les armes et les armées avec lesquelles les dirigeants défendent leur territoire leur sont soit propres, soit mercenaires, soit auxiliaires, soit mixtes (exemples d’armées mixtes : les casques bleus, la mission de paix de l’Union Africaine au Soudan -MUAS-; la mission des Nations unies au Soudan -MINUS- ; la force de maintien de la paix ONU-Union Africaine -Minuad- au Soudan, dont le mandat était de surveiller la mise en œuvre d’un accord de paix intervenu en 2006 entre Khartoum et l’un des nombreux groupes rebelles du Darfour, la faction de l’Armée de Libération du Soudan (SLA) de Minni Minnawi, un Zaghawa du Darfour. La Minuad comptait 15 500 soldats et policiers au Darfour). De là l’intérêt de notre réflexion qui interroge la relation entre le pouvoir politique et la force militaire en Afrique subsaharienne. Cette interrogation débouche sur la critique des armées mercenaires et auxiliaires, et surtout sur la nécessité d’instituer des armées républicaines, celles qui rendent les Etats forts et souverains, parce que loyalistes au double sens d’armées dévouées à la cause nationale et au respect de la loi. Ainsi, sans prétendre examiner la situation de tous les pays que compte l’Afrique subsaharienne, nous examinerons quelques cas qui peuvent illustrer notre position.
Toutes proportions gardées, le principal reproche que nous portons contre les armées mercenaires et auxiliaires, voire mixtes, résulte du fait qu’il s’agit des forces étrangères. Or un dirigeant politique doit se fonder sur ce qui dépend de lui, sur les armées qui lui sont soumises. Et comme on peut s’en convaincre, la puissance militaire, avant d’être matérielle, est d’abord humaine : ce sont les hommes qui composent et dirigent l’armée. De la sorte, les armées et les armes propres conviennent mieux à celui qui gouverne et le rassurent davantage, tant elles dépendent de lui. Elles permettent au dirigeant politique d’assurer sa sécurité et celle de ses concitoyens. De là l’idée que la ruine de nombreux Etats de l’Afrique subsaharienne et leur profonde déstabilisation s’expliquent par le fait qu’ils manquent de ressources nationales -politiques et militaires- dévouées aux causes républicaines, et que la vie de leurs institutions repose sur l’action des armées étrangères, au détriment des armées républicaines qui assurent la liberté et la sécurité des Etats. Le Tchad et le Soudan offrent d’ailleurs un tableau historique sombre de l’appui des forces armées extérieures pour déposer les gouvernants.
En effet, sans prétendre insister sur cet exemple, nous entendons simplement faire observer ici, en droite ligne de notre réflexion, que la relation entre ces deux pays est exécrable. Ces deux Etats s’accusent régulièrement de soutenir leurs mouvements rebelles respectifs, notamment au Darfour, province soudanaise, située au Nord-Ouest du pays et ravagée par une guerre civile depuis février 2003. C’est dans cette région que les rebelles s’activent et c’est dans cette même région qu’agissent les groupes rebelles soudanais que Khartoum accuse de recevoir un soutien direct du régime tchadien. Le 24 octobre 2004, l’Union Africaine avait décidé de renforcer sa mission de paix au Soudan, à l’effet de veiller au respect du cessez-le-feu au Darfour. Cette mission qui devait passer de 300 à 3320 soldats et policiers était sous commandement rwandais, faute d’une force armée nationale et républicaine, capable de résister à l’assaut des rebelles : ce qui est un handicap en matière de stratégie militaire et d’indépendance politique. Et comme on peut s’en convaincre, les présidents tchadien Idriss Déby Itno et soudanais Omar el Béchir avaient conclu, jeudi 3 mai 2006, un accord de réconciliation devant mettre fin à une crise entre leurs pays, au terme d’un sommet tripartite organisé par le roi Abdallah d’Arabie Saoudite près de Ryad. L’accord parrainé par le souverain saoudien, qui avait accueilli les deux chefs d’Etat africains à Janadriyah, à 40 kilomètres au Nord-Est, prévoyait notamment l’engagement de chacun des deux pays à ne plus soutenir les rebelles de l’autre pays, ce qui est à l’origine de la tension. En vertu de cet accord, les deux pays s’engageaient à empêcher l’utilisation de leur territoire (respectif) pour abriter, mobiliser, entraîner, faire transiter ou financer les mouvements armés, d’opposition de l’autre partie. Ils s’engageaient également à œuvrer pour éloigner immédiatement ces mouvements de leur territoire, tout en soulignant le respect de leur souveraineté et intégrité territoriale respectives. Et le 31 août 2006, une résolution renforçant la mission des Nations unies au Soudan (MINUS) est signée. Approuvée par 12 voix contre 3 au Conseil de sécurité, la résolution 1706 prévoyait d’augmenter les effectifs de la MINUS et de les faire passer de 12273 casques bleus à 17300 soldats et 3300 policiers, afin de relayer la mission de l’Union africaine (MUAS). Placée sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, elle se proposait notamment de surveiller les incursions des groupes armés le long des frontières du Soudan avec le Tchad et la République Centrafricaine, contribuer au désarmement des ex-combattants et faciliter le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées. Cette résolution a été rejetée par Khartoum le jour même.
Cependant, le drame tchadien date des années 1960, précisément en 1968, avec l’organisation rebelle tchadienne qui voit le jour au Soudan, sous la direction de Goukouni Oueddeï : le Front de Libération nationale du Tchad (Frolinat). Ce mouvement, dont l’ambition est de s’emparer du pouvoir de N’Djamena en renversant François Ngarta Tombalbaye (1er président du pays, élu le 11 août 1960), est soutenu par le colonel Kaddafi, alors qu’il vient de prendre le pouvoir en Libye le 1er septembre 1969. Ainsi commence le drame tchadien, ce terrible et long cycle de guerres civiles qui déchire l’histoire de ce pays. Les rebelles tchadiens seront tour à tour soutenus par la Libye et le Soudan, en partant de déposition en déposition des présidents : François Ngarta Tombalbaye est renversé par un coup d’Etat mené par le général Félix Malloum. Mais en raison des ingérences libyennes et soudanaises, les rebelles finissent par s’emparer du pouvoir suprême à N’Djamena à travers Goukouni Oueddeï (1979-1982), puis Hissène Habré (1982-1990), suivi par Idriss Déby Itno -depuis 1990-, qui bénéficie du soutien actif de la France (opération Epervier) : un accord de coopération technique et militaire entre les deux pays permet à la France d’aider légalement le pouvoir tchadien. Et aujourd’hui, le Tchad souffre encore du soutien des rebelles par le Soudan, et réciproquement.
N’Djamena accuse Khartoum, parrain des rebelles tchadiens ces dernières années, d’être l’instigateur des offensives de 2008, qui avaient pour but de perturber le déploiement de la force européenne dans l’Est du Tchad et en Centrafrique (Eurofor), censée protéger 450000 réfugiés du Darfour soudanais et déplacés tchadiens et centrafricains. D’ailleurs, dans une lettre au Conseil de sécurité de l’O.N.U., et datée de novembre 2006, le Tchad affirme que des groupes influents proches de la famille royale saoudienne aidaient à recruter et équiper de jeunes mercenaires liés à Al- Quaïda pour le compte de la rébellion tchadienne. Et, l’Etat tchadien s’était excusé auprès de Khartoum pour l’incursion de son armée le 9 avril 2007 en territoire soudanais, expliquant toutefois que ses militaires étaient à la poursuite de rebelles venant du Darfour (Ouest du Soudan). Ces affrontements avaient fait 17 morts parmi les soldats et les policiers soudanais, selon Khartoum, et 30 des deux côtés, selon N’Djamena.
En vérité, les armées mercenaires et auxiliaires sont inutiles et dangereuses. Et si un gouvernant a son pouvoir fondé sur elles, il ne sera jamais solide, ni sûr; car, elles sont généralement désunies, ambitieuses, sans disciplines, infidèles; gaillardes avec les amis; avec les ennemis lâches. Avec elles, on ne diffère la ruine qu’autant qu’on diffère l’assaut; et dans la paix, l’Etat est dépouillé par elles, dans la guerre par les ennemies.
Les troupes mercenaires n’ont d’autre amour ni d’autre raison qui les tienne en campagne qu’un peu de salaire; lequel ne suffit pas à faire qu’ils veuillent mourir pour vous. Quant aux troupes auxiliaires et mixtes, elles sont les plus dangereuses. Et un Etat qui les emploie n’a aucune autorité sur elles. Celle-ci demeure chez leur mandant. De tels soldats, après qu’ils ont vaincu, pillent le plus souvent celui qui les a engagés et celui contre qui ils ont été engagés. Ils le font, soit à cause de la perfidie de leur mandant, soit à cause de leur ambition. Un Etat doit donc faire un tout autre choix que de recourir à des armées auxiliaires pour se défendre, surtout s’il doit s’y fier totalement. Car tout accord et toute convention avec l’ennemi, durs qu’ils soient, seront moins pesants qu’un tel choix. Les gouvernants ambitieux ne peuvent donc avoir de meilleure occasion de s’emparer d’une cité ou d’un pays, que celle (l’occasion) où ils sont priés d’envoyer leurs armées pour se défendre. De ce point de vue, celui qui est assez ambitieux pour faire appel à une telle aide, non seulement afin de se défendre mais aussi d’attaquer, cherche à conquérir ce qu’il ne peut garder et peut se voir aisément enlever ce qu’il a gagné.
Cette critique des armées mercenaires et auxiliaires résulte d’une profession de foi patriotique : une armée nationale est digne de confiance, de sécurité et de victoire ; parce que précisément, elle est constituée de citoyens, de nationaux qui prônent le salut et la liberté de leur patrie. Ce que nous soulignons en substance ici c’est l’idée qu’il est préférable de subir une défaite avec ses propres armes que de gagner une guerre et vivre sous la dépendance d’une puissance étrangère. Et comme le souligne Friedrich A. Hayek dans La route de la servitude, « l’homme qui ne peut pas se fier à ses propres moyens pour réussir possède rarement un esprit indépendant et un caractère fort. » (Hayek, F. A., 1993 : 89). Pour le dire autrement, un succès qui mène à la dépendance n’est pas un succès, tant les conséquences privent l’Etat de la liberté civile. Dans cette optique, nous pouvons rappeler, en référence à la Bible, dans l’Ancien Testament, que nous voyons David combattre Goliath avec ses propres armes, en refusant toute aide extérieure, malgré la disparité physique et « militaire » du combat.
Tout ceci pour dire que la confiance en soi est une force psychologique qui concourt à la victoire. Cette confiance et cette exigence, dans un Etat, ne peuvent être entretenues qu’avec les soldats citoyens, les nationaux, parce qu’ils ont une appartenance territoriale commune, et aussi parce que l’entente est plus facile entre les hommes nés de la même nation, sous le même ciel. Et, aucun Etat n’est à l’abri des trahisons et des attaques lorsqu’il n’a pas de défenseurs qui lui appartiennent en propre. Autrement dit, comme le fait observer le secrétaire florentin, « il est nécessaire avant toute autre chose, comme véritable fondement de chaque entreprise, de se pourvoir d’armes propres, parce qu’on ne peut avoir de soldats plus fidèles, plus véritables, ni meilleurs, et bien que chacun d’eux soit bon, tous ensemble, ils deviendront meilleurs quand ils verront qu’ils sont commandés par leur prince, honorés par lui et qu’il cultive leur relation. » (Machiavel, N., 2000 : 165). Encore faut-il le préciser : la confiance dans la parole des autres n’est pas une valeur politique. Pour cette raison, les gouvernants doivent se méfier des armées mercenaires, auxiliaires et mixtes dont la fidélité est douteuse. A l’appui de cette réflexion, nous citons trois exemples qui ont valeur d’école : la Somalie, le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC/l’ex-Zaïre).
Si ces exemples ont de l’importance et retiennent notre attention, c’est qu’en touchant aux questions politique et militaire, leur examen est la clé de compréhension du drame continental et de la dépendance du politique en Afrique subsaharienne.
4. Illustration de trois cas d’école du drame continental : la Somalie, le Rwanda et la République Démocratique du Congo
Plaçons-nous sur le terrain des faits.
4.1. La Somalie : un territoire sans étiquette
La situation politique de la Somalie, ce haut plateau désertique, reste toujours préoccupante en raison d’une prétendue et interminable guerre civile qui ravage ce pays depuis 1991, et ce avec l’opération des Nations Unies pour la Somalie (onusom) qui avait tourné au fiasco, avec le retrait de cette force en 1995 suite à la mort d’au moins 151 casques bleus. Les clichés ethnico-misérabilistes et le fondamentalisme religieux souvent évoqués -bon gré mal gré- sont loin de justifier objectivement le drame somalien, dont les causes remontent à fort loin.
En effet, un observateur critique ne peut manquer de localiser la Somalie comme un foyer de tensions des milices et des armées auxiliaires, faute d’armée républicaine et loyaliste pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. Cette situation n’est guère étonnante, parce que, comme le fait observer Antonio Torrenzano, « la Somalie n’a pas eu à l’origine des frontières stables, ni des limites vraiment définies, si l’on considère comme frontières géographiques celles qui ressortent des traités de 1897 et 1908 » (1995 : 68). Cette histoire n’est pas sans conséquences, surtout quand nous savons que les côtes somaliennes, au nord de ce pays, sont au plus près du détroit de Bab-el-Mandab (la porte des pleurs) qui boucle la mer Rouge où transite le trafic maritime pétrolier des Etats occidentaux. C’est dire que la Somalie, ce pays pauvre de la corne de l’Afrique, situé entre le Golfe d’Aden et l’Océan Indien, a toujours présenté un enjeu stratégique majeur.
Si donc nous nous proposons d’être critique sur le drame somalien, nous reconnaîtrons que la Somalie est historiquement un territoire sans étiquette : d’abord en raison de la constitution -à l’origine- de ce pays par deux entités administratives distinctes : le British Somaliland au Nord qui connaît son indépendance le 26 juin 1960 et la Somalia italiana au Sud, qui sera indépendante le 1er juillet 1960 ; ensuite, la revendication de l’unité politique par l’élite sudiste qui ambitionnait le rêve d’un grand pays, regroupant trois voisins ayant en partage un peuplement, le somali : Djibouti français, l’Ogaden éthiopien et Kenyan Northern. Ce rêve, en somme légitime, rendra plus difficile l’équation de l’indépendance et de la souveraineté, en privant la Somalie de sa liberté politique. Aujourd’hui, comme on peut s’en convaincre, les troupes onusiennes et les troupes éthiopiennes et ougandaises de l’Amisom ont fini par faire de Mogadiscio -la capitale somalienne- et de Baïdoa -le siège du Parlement somalien- des zones de non droit, de destitution, de guerilla, de manœuvres obscures, de coups d’Etat, de violences exacerbées, révolutionnaires et quasi quotidiennes, décimant des millions d’hommes, de femmes et d’enfants.
En effet, en permettant et en laissant les forces éthiopiennes et ougandaises contrôler l’aéroport de Mogadiscio, la communauté internationale n’a fait que légitimer, d’une certaine manière, la prise en otage de la Somalie par ses voisins, l’Ethiopie et l’Ouganda : ce qui constitue un impair en matière de stratégie militaire. Là réside tout le mal de la Somalie : la présence des troupes mercenaires et auxiliaires (ou mixtes) sur l’ensemble du territoire. Ni les troupes américaines, ni les troupes mixtes de l’onusom (l’opération des Nations unies pour la Somalie) ni celles de l’amisom -mixtes aussi- (la mission africaine pour la Somalie) n’ont jamais pu régler le principal problème : l’indépendance politique et militaire de la Somalie, sa sécurisation et sa stabilité. Plus étrange, c’est la présence permanente de la force militaire éthiopienne en Somalie, quand nous savons qu’en 1979, ce pays a subi une défaite militaire historique contre l’Ethiopie pour la région de l’Ogaden. Et cette défaite des militaires somaliens, malgré le soutien -combien mitigé- des pays membres de la ligue arabe, des Etats-Unis et de l’Europe (la Grande Bretagne et la France livrèrent des armes en Somalie) dans la guerre contre l’Ethiopie pour l’Ogaden, est un vecteur de l’instabilité et de la violence qui règnent en Somalie. C’est donc avec raison que Stephen Smith écrit dans Somalie. La guerre perdue de l’humanitaire : La guerre de l’Ogaden, que la Somalie a perdu dans l’humiliation, les a ruinés au-delà de leur pauvreté atavique, vieille compagne des pasteurs de brousse.» (1993 : 14). Aussi ajoute-t-il :
« au lendemain de la fuite de Siad Barre de Mogadiscio, la communauté internationale a manqué sa plus belle occasion de retour. En intervenant alors massivement, ne serait-ce que d’abord avec une promesse d’engagement, elle aurait pu stabiliser une ville, puis peut-être tout un pays, sur un palier d’attente dans sa descente aux enfers. (Stephen Smith, 1993 : 88).
En vérité, l’installation des bases militaires éthiopiennes et ougandaises en Somalie n’a fait que pérenniser le mal somalien. Et aujourd’hui, le conflit sur l’Ogaden se poursuit sous forme de guérilla où s’articulent indiscutablement rapports stratégiques internationaux, alliances politiques variables et impératifs diplomatiques aux effets dramatiques et imprévisibles. Rappelons tout de même que l’armée éthiopienne a une capacité destructrice beaucoup plus forte d’une armée professionnalisée, déjà bien expérimentée en matière de répression populaire et qui dispose d’appuis majeurs. C’est dans cette optique que Philippe Leymarie et Thierry Perret écrivent, dans Les 100 clés de l’Afrique : « L’Ethiopie reste, en effectifs, un des Etats les plus militarisés du continent avec 350 000 hommes » (2006 : 57). Et le fait que les soldats ougandais « protègent » l’aéroport de Mogadiscio permet à l’Ethiopie de faire entrer en Somalie du matériel militaire pour alimenter les milices et les foyers de tension. D’ailleurs, nous nous souvenons que l’armée éthiopienne est intervenue en Somalie, fin 2006, officiellement, pour chasser les tribunaux islamiques qui contrôlaient Mogadiscio. Et en mars 2007, près de 1600 soldats ougandais, en majorité des officiers experts et logisticiens militaires, ont été déployés en Somalie dans le cadre de la force africaine de paix à Mogadiscio. Que des armées auxiliaires ou mixtes de l’Amisom, avec près de 8000 hommes, envahissent un Etat au prétendu motif de le sécuriser est un précédent très dangereux et fâcheux, qui plonge ce pays dans l’abîme de l’histoire. En clair, le déploiement de la force de maintien de la paix de l’Union africaine en Somalie a un revers dont les conséquences compromettent, à notre sens, le devenir sociopolitique et militaire de ce pays. Aujourd’hui, nous pouvons toujours dire ceci avec Stephen Smith :
En Somalie, les bourreaux et les victimes meurent, tous, de la même façon : en quittant un monde auquel ils n’ont rien compris -et qui le leur rend bien. Les uns se sont révoltés, rageusement, sans espoir de rémission, brûlant la vie des deux bouts : pas seulement la leur… Les autres se sont résignés à une existence de zombies, âmes en peine, sans corps, victimes du trépas bien avant d’être exécutées ou affamées à mort. Pour les uns comme pour les autres, à l’arrivée, il n’y a pas de différence : l’altérité, c’est ce qui me donne la mort ou ce à qui je la donne le premier. (1993 : 132)
Au-delà donc des clichés misérabilistes, de la résistance islamique et du fondamentalisme religieux souvent pointés pour justifier le conflit armé et le climat politique délétère, force est de constater et de reconnaître, mais pour aussitôt le regretter, que les forces militaires africaines sont en partie responsables de la tragédie somalienne. A ce propos, nous pouvons rappeler que le président ougandais Yoweri Museveni avait affirmé que le mandat de ses troupes n’est pas de désarmer les milices présentes en Somalie. Cette déclaration laisse perplexe et dubitatif, tant elle est de nature à nous faire penser objectivement que les forces armées auxiliaires de certains pays africains, à l’instar de l’Ethiopie et de l’Ouganda, participent à l’instabilité politique de la Somalie. Et pour s’en convaincre, il nous souviendra que lors de la revue des troupes ougandaises qui devaient partir en Somalie, le président ougandais avait clairement et officiellement déclaré ce qui suit, à Jinja, au sud de l’Ouganda : « Nous n’allons pas en Somalie pour imposer la paix aux somaliens, mais pour l’aider à reconstruire son armée. […] Le mandat de mes hommes n’est pas de désarmer les milices. » (AFP, 2 mars 2007).
Ce terrible aveu laisse penser que les forces armées ougandaises perpétuent la guerre au lieu d’y mettre fin. C’est dire que les différentes forces en conflit montrent une indifférence criminelle au bien-être des civils. Les parties en présence sont toutes responsables des violations graves. Et l’indifférence du Conseil de Sécurité des Nations Unies vis-à-vis de cette crise n’a fait qu’accroître la tragédie. On peut donc pointer et condamner avec raison la présence militaire éthiopienne et ougandaise en Somalie, surtout que depuis la défaite des tribunaux islamiques qui contrôlaient la quasi-totalité du centre et du sud de la Somalie, y compris Mogadiscio, ce pays est devenu une véritable poudrière, un théâtre d’attaques régulières menées par des insurgés dans les rangs desquels se trouvent des combattants islamistes. Et comme le fait remarquer Mamadou Aliou Barry (2006 : 373),
« la disponibilité des armes légères rend les conflits africains plus meurtriers, entrave les opérations de maintien de la paix et freine la reconstruction des Etats. Les maladies, la famine et les violences augmentent à cause de cette accumulation excessive d’armements. »
En somme, la Somalie souffre d’une inculture du métier des armes avec ses modalités; inculture dont la responsabilité incombe aussi bien aux responsables politiques de ce pays qu’à la communauté internationale. Les règles, pratiques et préceptes que les hommes de métier observent ou doivent observer pour se défendre et défendre la Somalie sont totalement ignorées au profit d’une prise en otage de ce pays par des milices et des armées auxiliaires. En clair, la Somalie est historiquement dépourvue d’une force militaire républicaine et loyaliste, c’est-à-dire une armée nationale et puissante, capable d’assurer, au moyen d’une réconciliation nationale et par l’entretien ou l’emploi de forces organisées, la protection et l’intégrité du territoire. Seule une armée nationale, républicaine et loyaliste, serait capable de libérer la Somalie de l’occupation des forces étrangères, éthiopiennes et ougandaises en l’espèce.
4.2. Le génocide rwandais de 1994
Le génocide rwandais de 1994 exprime bien et sans détour la réalité politique dont il est question dans notre réflexion : l’usage des armées mercenaires et auxiliaires et la dépendance du politique. Cette deuxième illustration a non seulement valeur de référence historique, mais elle nous évite de perdre la mémoire devant la conscience d’un passé et d’un avenir trahis. Car, comme le rappelle Hugh Mc Cullum, « l’histoire du Rwanda montre les deux facettes de notre humanité. […] Si tout ce que l’Ouest peut fournir est une sorte d’ « humanisme à contre-cœur » (dixit un Rapport d’African Rights), il y aura sûrement d’autres génocides au Rwanda » (1996 : 6-28).
Cela dit, rappelons que la proclamation de la République rwandaise date de 1961; date de l’indépendance de ce pays, avec à sa tête le président Grégoire Kayibanda. En 1973, Juvénal Habyarimana prend le pouvoir à la suite d’un coup d’état militaire. En 1990, le Front Patriotique Rwandais (FPR), dirigé par Paul Kagamé et Alexis Kanyarengwé, marque son opposition au pouvoir de Kigali et décide de renverser le président Juvénal Habyarimana, avec le soutien de l’Ouganda : Yoweri Museveni est alors sollicité par Paul Kagamé. Et pourtant, du point de vue de la rationalité politique et de la stratégie militaire, cette sollicitation était une erreur fatale, tant elle compromettait par avance l’avenir du Rwanda. Parce que précisément, l’armée ougandaise, étrangère en l’espèce, allait obéir à son mandant. Et comme nous l’avons dit précédemment, une armée auxiliaire pille aussi bien celui qui l’a engagée que celui contre qui elle a été engagée.
La dépendance du politique rwandais est donc une infirmité historique qui date de la création du Front Patriotique Rwandais. En effet, comme le note Hugh Mc Cullum :
Le Front Patriotique Rwandais (FPR) a été constitué au départ des restes de la National Resistance Army (NRA) de Yoweri Museveni, qui renversa Tito Okello après que ce dernier ait lui-même renversé le régime de Milton Obote en 1986, et dont le gouvernement qu’il a formé est à présent l’enfant chéri des investisseurs du monde entier. Beaucoup de dirigeants de la NRA étaient des Tutsi du Rwanda réfugiés en Ouganda depuis 1959. Cette communauté de Tutsi en exil, dont le nombre a été évalué à 200 000, avait appris l’anglais et était bien intégrée dans la société ougandaise. Après 1986, certains officiers de la NRA, dont Paul Kagamé (…), ont créé en grand secret le FPR. Ensuite seulement ils ont demandé l’appui de Museveni. » (1996 : 42-43).
Denis Ropa renchérit : « Museveni, parrain de Paul Kagamé, l’a entraîné dans les maquis pendant 10 ans et l’a aidé à créer la fameuse « armée de libération » et à prendre le pouvoir à Kigali » (1998 : 10). C’est donc cet appui historique de Yoweri Museveni à Paul Kagamé qui donnera le ton de la première offensive du Front Patriotique Rwandais en 1990 (cette offensive échoue la première fois grâce à l’intervention des troupes françaises : l’opération « Turquoise »), contre le régime de Kigali. Cette offensive est dirigée par les forces ougandaises, soutenues par les armées de l’ex-Zaïre composées des Banyamulengue (les Tutsi zaïrois). C’est la raison pour laquelle la lutte armée avait été lancée à partir des frontières ougandaises, évidemment avec l’autorisation du président Yoweri Museveni. Et Michel Bührer d’écrire : « 1990 le Front Patriotique Rwandais (FPR), formé d’exilés Tutsi attaque le Rwanda par le nord avec le soutien de l’Ouganda. » (1996 : 8). C’est dire que le pouvoir de Paul Kagamé reposait à la base sur des forces militaires étrangères. En d’autres termes, pour déstabiliser le régime de Juvénal Habyarimana, Paul Kagamé avait une force qui ne lui appartenait pas en propre. Et les conditions dans lesquelles Juvénal Habyarimana a été assassiné montrent très bien qu’il s’agissait d’une conspiration militaire savamment organisée par les armées auxiliaires, n’ayant d’autres missions que celles d’obéir à leur mandant. Le président Juvénal Habyarimana a été assassiné le mercredi 6 avril 1994, en compagnie du tout nouveau président burundais, Cyprien Ntaryamira, après avoir assisté à une réunion des chefs d’Etat : l’avion qui le ramenait de Dar-es Salam (Tanzanie), son Mystère Falcon Executive -que lui avait offert le gouvernement français de François Mitterrand- a été abattu par des missiles sol-air. Les auteurs de ce drame, et nous ne pouvons en douter, étaient soit les troupes du Front Patriotique Rwandais (FPR), soit les officiers français, comme le note Hugh Mc Cullum :
« La France aurait fourni les missiles sol-air qui ont abattu l’avion d’Habyarimana : African Rights le prétend, mais on spécule beaucoup sur la question de savoir qui a exécuté le tir fatal. Pourtant, la plupart des Rwandais croient que le bouton a été poussé soit par des tireurs d’élite français, soit par trois membres de la Garde Présidentielle d’Habyarimana. » (1996 : 52).
Dans tous les cas, les auteurs du coup du 6 avril 1994, à 20h30 heure locale, étaient des officiers des armées auxiliaires, ougandaises et françaises en l’espèce, présentes dans le pays, et plus précisément à Kigali. Et il ne restait plus que cela et rien que cela pour piller le pays et tuer les citoyens dans la plus totale indifférence. Le massacre de l’archevêque de Kigali et ses camarades à Gakurazo, le dimanche 5 juin 1994, en pleine « guerre civile » est une parfaite illustration : il s’agit précisément des évêques Vincent Nsengiyumva, archevêque de Kigali, de Joseph Ruzindana, évêque de Byumba et de Thaddée Nsengiyumva, évêque de Kabgayi et président de la Conférence épiscopale, avec 9 prêtres, ainsi que le Supérieur général des Frères Josephites, Jean Baptiste Nsinga. Ils ont tous été assassinés par les soldats du Front Patriotique Rwandais. A ce sujet, Hugh Mc Cullum écrit :
Le signal du début du génocide venait d’être donné. En cent jours, un million d’êtres humains seront tués et la moitié de la population du Rwanda sera sur les chemins de l’exode. C’est le moment où la communauté internationale a tourné le dos, laissant quelques voix esseulées soulever les questions existentielles de la souffrance et de la mort, de leur coût humain, des conséquences politiques de cette relance de la déstabilisation dans la région, des suites judiciaires du génocide sur d’autres pays et les conséquences morales de notre manque de responsabilité et de solidarité. (1996 : 49-50).
C’est là l’une des causes, disons mieux, la plus évidente cause, qui pénètre l’explication du génocide rwandais. Les armées auxiliaires, ougandaises et françaises en l’occurrence, ont mis à mal le Rwanda en raison de la perfidie et des ambitions de leurs mandants. Le génocide a donc été commis en raison de la légitime défense des uns et des autres, suite à l’invasion des troupes étrangères, barbares en l’espèce. De ce point de vue, les propos de Monique Mass, dans Paris-Kigali 1990-1994. Pour un génocide en Afrique, sont assez révélateurs de la responsabilité du gouvernement français dans ce qu’il convient d’appeler indiscutablement le génocide rwandais. La journaliste et spécialiste dans les questions africaines depuis 1975 déclare:
Au Rwanda, la diplomatie et l’armée française ont défendu la cause d’un régime qui, pour ne point périr, échafaudait l’idée d’une solution finale. […] La majorité des civils massacrés au Rwanda sont tombés comme « complices » de l’ennemi, celui que Paris aussi désignait comme tel. […] La France et les Français n’ont pas encore accompli le deuil de leur empire sur l’Afrique. […] Aucune explication totalement satisfaisante n’a jamais vraiment éclairé les positions exprimées par François Mitterrand sur le Rwanda. […] Aussi officiellement, deux pairs de compagnies de 150 hommes chacune environ seront dépêchées au Rwanda lorsque l’exigera le rétablissement de l’équilibre des forces en faveur du régime Habyarimana. (1999 : 12-25).
4.3. La République Démocratique du Congo : l’impair de Laurent Désiré Kabila
Cet exemple de la fin du 20e siècle dans la région des Grands Lacs a valeur d’école : non seulement il touche, comme les deux premières illustrations, à la question politique et militaire, mais son examen est la clé de compréhension du drame congolais et de la chute du président de l’Alliance Démocratique pour la Libération du Congo.
En effet, nous devons à l’histoire de rappeler que pour renverser Mobutu, Laurent Désiré Kabila a eu recours aux armées auxiliaires des pays voisins, notamment le Rwanda, l’Ouganda et l’Angola. De là sa grande dépendance, et certainement sa plus grande maladresse, étant entendu que les armées auxiliaires ne servent que celui à qui elles appartiennent en propre. Or la rébellion que L.D. Kabila avait mise en place était dirigée par un officier rwandais, le commandant en chef de l’armée rwandaise, James Kabaréré, qui avait à ses côtés le chef d’Etat-major de l’armée rwandaise, Nyamwasa kayumba, ainsi que les Tutsi rwandais réfugiés au Zaïre et devenus zaïrois, les Banyamulengue, fidèles au Front Patriotique Rwandais de Paul Kagamé.
L’Alliance Démocratique pour la Libération du Congo, dont Kabila était le président, était savamment dirigée par deux principales forces étrangères : l’actuel président rwandais, Paul Kagamé et le président ougandais Yoweri Museveni, tous deux amis et résolus à s’emparer des richesses minières de l’ex-Zaïre, en renversant Mobutu. Voilà qui, tout en chassant Mobutu du pouvoir, avait compromis le dessein de Kabila, celui de la République Démocratique du Congo, et conséquemment celui de la région des Grands Lacs. Car en effet, devenu président, Kabila avait non seulement pour ennemis tous ceux qu’il avait dépouillés, mais encore et surtout ceux qui, déçus après avoir espéré une amélioration des conditions de vie, lui avaient permis d’accéder au pouvoir et qu’il ne pouvait satisfaire, pas plus qu’il ne pouvait répondre positivement aux accords conclus avec les pays voisins, notamment l’exploitation et le partage des ressources naturelles.
Cette cause (le recours aux armées étrangères), en vérité la plus forte jamais indiquée par certains analystes politiques, fait voler en éclats toutes les raisons plus qu’apparentes que fondées qu’on pourrait donner pour expliquer la ruine et l’assassinat de Kabila. En accédant au pouvoir avec le soutien et la force des armées auxiliaires, étrangères en l’espèce, Laurent Désiré Kabila avait déjà creusé sa propre tombe : il avait accepté naïvement l’alliance d’une victoire pernicieuse qui ne lui appartenait pas en propre, oubliant par là même que la servitude étrangère d’un Etat est la plus grande infirmité politique; surtout qu’il n’est point d’amitiés qui, par la marche du temps, ne soient devenues leur propre contraire. Le succès avec les armées auxiliaires est toujours celui des puissances étrangères. Lui fallait-il fréquenter les textes des théoriciens politiques et experts en stratégie militaire pour le comprendre ? Assurément. Mais cet homme était-il réellement capable de cette intelligence ? Le doute est permis, tant le pouvoir à tout prix aveugle l’esprit des hommes.
En effet, L. D. Kabila, le président autoproclamé le 17 mai 1997, alors qu’il n’aurait pas dû faire d’accord avec le Rwanda, l’Ouganda et l’Angola, en fit. L’amitié et l’inimitié mesurées de ces pays voisins lui furent dommageables. Son assassinat ou sa ruine n’était rien d’autre qu’une manière rationnelle de payer son tribut aux dirigeants des Etats voisins qu’il ne reconnaissait plus. Il lui fallait incontestablement faire et accepter le solde des vainqueurs, le solde de tous ceux qui l’ont porté au pouvoir. Et il ne pouvait en être autrement : le prix du dépouillement de Mobutu devait être payé à brève ou longue échéance par son successeur en raison des causes du renversement de Mobutu. Et jamais cela ne pouvait se faire sans violence, tant les intérêts des hommes et des Etats étaient en jeu. Telle est la fatalité à laquelle conduit l’usage des armées auxiliaires et mercenaires : on reste sous la dépendance de leur mandant.
Cette analyse pénètre, en un sens, l’explication de la crise qui paralyse la région des Grands Lacs, une région touchée par une profonde et constante déstabilisation du fait de la recomposition politico-géo-stratégique. En clair, le mal de la région réside, à bien y regarder, dans l’usage des armées mercenaires et auxiliaires. D’ailleurs, aujourd’hui, force est de reconnaître que des experts de l’ONU, dans leur rapport examiné jeudi 23 janvier 2014 au Conseil de sécurité, ont accusé une nouvelle fois le Rwanda et l’Ouganda de coopérer avec les rebelles congolais du mouvement M23.
Nous tenons donc cet usage des armées mercenaires et auxiliaires comme l’une des causes principales de déstabilisation et de la ruine de la région des « Hautes terres ». Cette cause est en vérité le plus grand défi que les gouvernants africains ne peuvent que difficilement relever, aussi longtemps que leurs Etats n’auront pas d’armées républicaines et loyalistes pour défendre l’intégrité des territoires. C’est dire que parmi toutes les situations malheureuses, la plus déplorable est celle d’un Etat qui en est réduit au point de ne pouvoir ni être en paix, ni supporter la guerre, comme la République Démocratique du Congo. C’est à cet état que sont réduits les gouvernants qui sont trop gênés par les conditions de paix et qui, d’autre part, voulant faire la guerre, sont contraints de devenir la proie de leurs alliés ou de leurs ennemis. On en vient à cette extrémité en raison du recours aux armées mercenaires et auxiliaires. Clairement dit, à chaque fois que les armées n’appartiennent pas au dirigeant ou à l’Etat, il ne peut y avoir un succès certain. De ce point de vue, il est permis de penser que la manière d’acquérir le pouvoir conditionne généralement sa perte. Les armées étrangères placent toujours le dirigeant ou l’Etat dans une certaine soumission ou dépendance politique. Parce que précisément, si l’on perd, on reste battu, et si l’on gagne, on demeure leur prisonnier. Toute sollicitation extérieure constitue une dépendance qui ruine et aliène le politique et l’Etat.
Conclusion
A la lumière des trois cas d’école pointés (la Somalie, le Rwanda et la République Démocratique du Congo), l’examen de notre problématique nous permet de dire que l’Afrique subsaharienne doit cesser avec l’arbitrage international des conflits interétatiques et intraétatiques; conflits que la France et ses alliés occidentaux continuent de soutenir, comme en témoignent nos analyses et références, avec la mise en œuvre de nombreux accords de paix savamment distillés dans les réseaux liberticides de la nébuleuse Cour Pénale Internationale, une construction -à notre sens- perfide, dont la base juridique n’est connue d’aucun peuple africain. En clair, l’Afrique doit désormais être désoccidentalisée : c’est un impératif moral et politique de la Charte universelle des droits de l’homme. Pour cette raison, nous pensons que quand les gouvernants africains eux-mêmes auront institué des armées républicaines et loyalistes, il leur appartiendra d’évaluer les moyens qu’ils ont d’assurer la stabilité de leurs Etats dans le dialogue du politique et du militaire, en n’intégrant qu’ensuite -et suivant les situations- l’extérieur à leur stratégie, comme un appui facultatif, et non comme le moteur essentiel de cette vieille françafrique.
Les desseins stratégiques des Etats n’étant pas toujours totalement dépourvus d’arrières-pensées, rien ne peut nous convaincre qu’un Etat n’a pas des intentions hégémoniques sur un autre. Avec le monde, chaque dirigeant politique africain doit jouer à fin contre fin, et auprès du renard, contre le renard. Parce que précisément, le monde des relations internationales est toujours plein d’artifices et de malices. Cette prudence et cette prise de conscience éviteraient à l’Afrique subsaharienne des procès dépaysés des gouvernants africains, à l’exemple du sierraleonais Charles Taylor, du congolais Jean Pierre Bemba ou de l’ivoirien Laurent Bagbo. A ce sujet, le moins que nous puissions dire, à quelques exceptions près, c’est que les missions des Nations unies en Afrique subsaharienne ne créent jamais un environnement propice aux accords de paix, pas plus qu’elles ne suscitent des efforts dans la voie d’un règlement définitif, transparent et pacifique des conflits.
Loin d’engager à tout prix un procès en responsabilité, nous devons, à la vérité de l’histoire, reconnaître qu’aucun continent, aucune puissance extérieure ne viendra offrir la stabilité politique aux Etats africains, surtout quand nous savons tous que la prospérité de l’Occident et de l’Asie passe aujourd’hui et à grand éclat par l’appauvrissement de l’Afrique subsaharienne, notamment la détérioration des termes de l’échange, la vente des armes par les maîtres du capitalisme triomphant et le maintien des milices qui plongent les Etats africains dans l’abîme politique. De ce fait, Aminata Traoré, dont le propos est pertinent et assez révélateur, a plus de motifs qu’elle n’en doute d’écrire : « L’Afrique est le théâtre d’affrontements absurdes et d’une extrême gravité. […] Il va falloir que les Africains assument davantage et mieux leurs responsabilités, tant dans l’analyse de l’interminable crise qui ronge le continent, que dans la formulation des énoncés et des solutions aux problèmes posés. […] Les grandes puissances qui jouent aujourd’hui la carte de l’afro-optimisme, ne sont ni sincères, ni crédibles. » (1997 : 10). Ceci est d’autant plus important à souligner que le bonheur des peuples d’Afrique ne se fera pas sans la responsabilité des Africains eux-mêmes. Et ce bonheur ne peut être réalisé que dans les conditions d’indépendance politique, militaire et économique, de nature à assurer une grande liberté pour l’élaboration et la mise en pratique du processus de démocratisation des Etats, aux enjeux socioéconomiques visibles. C’est pour cette raison que la désoccidentalisation de l’Afrique subsaharienne est à poser et à réaliser comme un impératif non négociable, aux confins d’une rupture irréversible avec les gouvernants du système totalitaire postcolonial.
Au total, à la question de savoir « s’il y a une alternative raisonnable aux conflits armés qui déchirent l’Afrique subsaharienne », volontiers, nous répondons par l’affirmative. Car, en dépit du poids de l’histoire, les Africains retrouveront et doivent retrouver, grâce au dialogue permanent et constructif du politique et du militaire, leur place dans le monde, au nom de l’afroresponsabilité, et surtout sur la base d’un projet de société formulé de manière participative et assumée sans complexe : une société de justice, solidaire et forte. Et un tel optimisme n’est pas dépourvu de fondements pour tout gouvernant qui saura mettre en intelligence l’arme et la toge, parce que ce sont les bons soldats qui sont le nerf de la guerre. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’armée doit toujours s’entendre comme un service public qui se propose d’assurer, par l’entretien ou l’emploi des forces organisées, la protection des intérêts d’un Etat. Les dirigeants politiques avertis jugent toujours qu’il est nécessaire de s’armer d’armes et de soldats qui leur appartiennent en propre, et dont le territoire abonde, de telle sorte qu’on pourra aisément en tirer le nombre d’hommes bien qualifiés que l’on voudra pour la défense et l’intégrité du territoire. De ce point de vue, l’art de la guerre, entendu comme stratégie, se définit comme la connaissance du métier des armes avec ses modalités. Il s’agit précisément d’un ensemble de règles, pratiques et préceptes que les hommes de métier (les militaires), dans leur dialogue avec les politiques, observent ou doivent observer pour se défendre ou pour attaquer l’ennemi, en assurant la victoire, le triomphe, la gloire et l’unité de l’Etat.
Aujourd’hui, les armées africaines doivent prendre conscience de leur rôle prééminent, dans le service public, étant entendu qu’une armée nationale et régulière, républicaine et loyaliste par nature, constitue la principale donnée de la vertu politico-militaire, contre des armées étrangères. Mieux, les armées africaines doivent désormais se concentrer pour une action commune, dans leur dialogue avec le politique, sur leur objet. Elles ont plus que jamais l’obligation de relever la tête et de regarder vers les sommets, pour instaurer la philosophie propre aux armées loyalistes et républicaines : faire sentinelles et venir au secours de la liberté si elle est sourdement attaquée, ou élever des barrières contre le despotisme. Ce qui suppose une formation et une marche vers les armées de métier. Peut-être faut-il le préciser : il n’y a point de couverture nationale et républicaine sans une armée de métier, au sens où l’entendait Charles de Gaulle. La politique parle le langage de la force armée, indispensable à la constitution de l’Etat. De ce fait, il est urgent pour les gouvernants africains de s’exercer à l’action commune avec leurs soldats, de se rapprocher les uns des autres dans leur mouvement patriotique, parce que davantage, lorsque les uns manquent la réplique, pour l’ensemble ou pour l’Etat, tout est perdu, à en croire le réalisme de Charles de Gaulle. Car, les valeurs de liberté sont d’abord les valeurs de sécurité, et celles-ci sont -par nature- des valeurs militaires. Dans cette optique, Michel Louis Martin a raison de faire observer ce qui suit, dans Le soldat africain et le politique : essais sur le militarisme et l’Etat prétorien au sud du sahara :
La séparation de l’arme et de la toge, ainsi que la subordination de celle-ci à celle-là, constitue deux aspects décisifs distinguant l’Etat développé de l’Etat sous développé. Dans le premier, la tension naturelle civile-militaire est stabilisée et le contrôle des armes par le politique institutionnalisé. Dans l’Etat sous-développé, en revanche, la frontière civile-militaire est poreuse et conflictuelle et la domination du militaire par le pouvoir peu effective. Partant de l’hypothèse que l’une des dimensions du malaise affectant les armées africaines, et les poussant… à des comportements interventionnistes, a longtemps tenu au faible développement militaire de la région sub-saharienne, cette amorce récente de revalorisation stratégique sera peut-être un facteur d’atténuation du militarisme. (1990 : 3-8).
Références bibliographiques
« Jeune Afrique Economie, N°304- Du 28 février au 12 mars 2000 ».
« Jeune Afrique Economie, N°374-novembre-décembre 2008 ».
« L’Autre Afrique, N°5 Du 18 au 24 juin 1997 ».
Aliou Barry, M., (2006) : Guerre et trafics d’armes en Afrique. Approche géostratégique, Paris, L’Harmattan.
Bayard, J. F., (2006) : L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard.
Bayard, J.F., (1997) : La criminalisation de l’Etat en Afrique, Bruxelles, Complexe, ouvrage collectif.
Bertrand de Jouvenel, (1998) : Du pouvoir, Paris, Hachette Littératures.
Bührer, M., (1996) : Rwanda. Mémoire d’un génocide, Paris, Editions de l’UNESCO.
Buyoya, P., (1998) : Mission possible : construire une paix durable au Burundi, Paris, L’Harmattan.
Chemillier-Gendreau, M., Engelhard, P., (2000) : Peut-on être vivant en Afrique ?, Paris, P.U.F.
Chrétien, J.P., (1997) : Le défi. Rwanda et Burundi : 1990-1996. De l’ethnisme, Paris, Karthala.
Duverger, M., (1964) : Introduction à la politique, Paris, Gallimard.
Ela, J.M., (1994) : Afrique. L’irruption des pauvres. Société contre ingérence, pouvoir et argent, Paris, L’Harmattan.
Guichaona, A., (1995) : Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994), Paris, Karthala.
Hayek, F. A., (1993) : La route de la servitude, Paris, P.U.F.
Hugh Mc Cullum, (1996) : Dieu était-il au Rwanda ? La faillite des Eglises, Paris, L’Harmattan, préface de Desmond Tutu.
Lanxade, J., Michaud, Y. (2002) : Le pouvoir, l’Etat, la politique, Paris, Odile Jacob, ouvrage collectif.
Leymarie, P. et Perret, T., (2006) : Les 100 clés de l’Afrique, Paris, Hachettes Littératures,
Machiavel, (2000) : Le prince, Paris, Librairie Générale française.
Machiavel, (2001) : Le prince, Paris, Actes sud.
Mass, M., (1999) : Paris-Kigali 1990-1994. Pour un génocide en Afrique, Paris, L’Harmattan.
Michel Louis Martin, (1990) : Le soldat africain et le politique : essai sur le militarisme et l’Etat prétorien au sud du sahara, Toulouse, Presses de L’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse.
Smith, S., (1993) : Somalie. La guerre perdue de l’humanitaire, Paris, Calmann-Lévy.
Torrenzano, A., (1995) : L’imbroglio somalien. Historique d’une crise de succession, Paris, L’Harmattan.
Ziegler, J. (2008) : La haine de l’occident, Paris, Albin Michel.