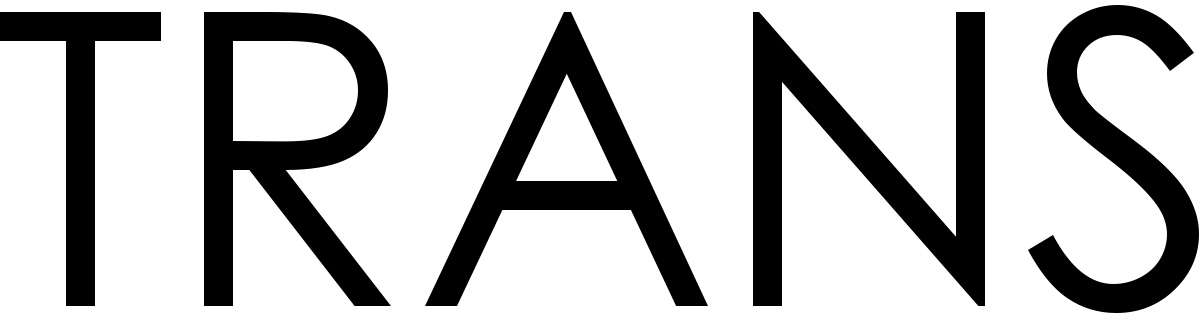Rabeh Sebaa
Dès le texte de présentation du premier numéro de la revue Peuples méditerranéens en Octobre 1977, on pouvait lire «L’unité de la Méditerranée que tendent à imposer l’expansion du capitalisme et la réponse qu’elle provoque posent en termes nouveaux la notion de mediterraneité ou de ce que l’on pourrait appeler le binôme islamo-méditerranéen de manière à se départager aussi dans les mots d’une idéologie qui marqua l’entre- deux guerres …»
Cette vision de la méditerranée casse la binarité ou la bipolarité de la rive sud opposée à la rive nord. Paul Vieille, directeur de la revue jusqu’à la date de sa disparition en 1997, après la parution de 80 numéros, introduit une troisième rive une rive «intruse» qui constituera une dimension de la personnalité de la revue jusqu’à sa disparition: Cette rive intruse est ce qu’il appelle Le monde islamo-méditerranéen.
Cette approche tourne, ainsi, le dos à la vision réductrice de la méditerranée conventionnelle, en la reconfigurant continument en méditerranée plurielle: Dans le numéro suivant cette vision est formulée de façon explicite: «Sont retenus comme faisant partie de l’aire méditerranéenne, tous les pays riverains de la Méditerranée orientale et occidentale et de l’Adriatique mais aussi tous les tous les pays qui , très anciennement ont été étroitement mêlés à une histoire dont le centre géographique se situe sur la mer Méditerranée, c’est-à-dire des pays comme l’Iran, l’Afghanistan, ceux de la péninsule arabique, le Soudan et l’Ethiopie en raison des rapports étroits (guerres, échanges, relations culturelle etc.…) que les peuples de ces régions ont, historiquement, entretenue avec les riverains de la Méditerranée».
C’est cette conception large et généreuse de la méditerranée qui habitera et ne quittera jamais la vision engagée de la revue Peuples méditerranéens.
Cette reconfiguration, à la fois géographique, philosophique et littéraire, de la Méditerranée est également une manière de rendre justice à cette partie du monde, tant ce monde islamo-méditerranéen, cette rive tierce a été dominée, malmenée, scotomisée, niée au point où la Méditerranée comme espace d’appartenance partagée, n’apparait, au fond que comme un mythe d’origine, condamné à l’évanescence.
Les numéros suivants de la revue ne cesseront de se demander d’ailleurs s’il ya jamais eu une identité méditerranéenne en partage? De même que de se demander que représente le monde islamo-méditerranéen dans l’imaginaire de l’Europe et de façon générale de l’Occident?
La revue, le relèvera quelques années plus tard dans une contribution de son directeur Paul Vieille intitulée l’unité de la méditerranée et son développement où il rappelle les grandes lignes qui ont présidé à la création de la revue il souligne «L’analyse que l’on faisait en 1977 et les conclusions que l’on tirait sont plus que jamais valables aujourd’hui. Les rapports de la Méditerranée avec l’Europe du nord se sont détériorées, la situation de la mer intérieure s’est aggravée».
L’Histoire ne cesse, hélas, de lui donner journellement raison. On voit, présentement, comment les drames quotidiens autour de Lampedusa ou ailleurs, tendent à transformer la Méditerranée, en une vaste nécropole liquide.
De toute vraisemblance, les politiques méditerranéennes de l’Europe sont indissociables, voire inconcevables sans les sociétés islamo-méditerranéennes. Bien que, depuis l’expression de la préférence, affichée et assumée, par celle-ci, pour son flanc Est, une dialectique charriant une vision euro centrée, et non euro-méditerranéenne, s’est mise, ostensiblement, en branle et ne s’est guère démentie depuis. Dialectique confortée par le verrouillage forcené des frontières, conjugué à des débats intérieurs récurrents sur les démons de l’Intrusion (minarets, buqua, polygamie, identité nationale, le nucléaire iranien et récemment le burkini devenu le chancre de fixation de toute la saison estivale.)
Ces démons qui sont autant de symptômes, au sens clinique du terme, du malaise épouvanté, d’une Europe prétendument, cernée de toutes parts. Une citadelle qui assure se prémunir autant des référents culturels envahissants et menaçants, que des appétits aiguisés, que son aisance matérielle suscite, ou attise chez les populations des pays qui l’entourent.
Depuis la fin du vingtième siècle, cette méditerranée, vue d’Europe apparait de plus en plus comme une palissade roide, hissée sur les vagues agitées du déni.
Une muraille bétonnée qui aspire à l’hermétisme. Même la binarité géographique référentielle, Nord-Sud, a transmuté en dualité culturelle de confrontation, voire d’affrontement, annihilant tout projet de partage de l’être-là méditerranéen, dans la convivialité.
Dans cette vision euro centrée, la revue Peuples méditerranéens n’a cessé de déconstruire, la Méditerranée se présente comme un espace de contingentement, d’imperméabilité, de bannissement et d’obturation, nourrissant un imaginaire de surprotection.
L’imaginaire d’une Europe recroquevillée, repliée sur elle-même, clôturée, claquemurée, cloitrée dans sa frousse et son ignorance grandissante de l’Altérité immanente, les voisins de son flanc sud et le monde islamo-méditerranéen, en l’occurrence.
Dans ces conditions, il n’y a aucune surprise à observer l’amenuisement ou l’érosion de sa présence dans cette partie de la Méditerranée, et par voie de conséquence, l’évanouissement ascendant du projet de construction d’une aire euro-méditerranéenne, décemment partagée. Un projet remis au goût du jour par la création de l’Union pour la Méditerranée le 13 juillet 2008 à Paris, mais vite tombé en désuétude.
Faut-il, alors, s’étonner de voir certains de ces pays réagir à cette volonté entêtée d’obstruction des pores de la Méditerranée? A la forclusion obstinée de ses horizons? Et au rétrécissement drastique infligé à ses rivages, qui confine à l’exigüité et à l’étouffement?
Une double séparation
1/ Sur le plan culturel, avec des rejets et des reflux identitaires, changeant de forme et de contenu, selon les conjonctures, et qui ont pour point constant de récuser tout projet euro-méditerranéen, immanquablement confondu ou réduit à sa dimension occidentale. Ce rejet est d’autant plus aisé qu’il n’existe pas de socle méditerranéen ancré dans l’imaginaire sociétal de ces pays, se considérant d’abord comme arabes et musulmans. Hormis un vague sentiment de proximité ou de mitoyenneté géographique, la méditerranée est restée absente de la symbolique d’identification et d’appartenance arabo-musulmane, qui a plutôt priorisé l’unité arabe et la consolidation des liens dans la Ûmma, fondés sur la religion et la langue communes. De ce fait la méditerranée comme espace d’identification n’a jamais été pensée et encore moins célébrée.
Il n’existe aucun Braudel dans le monde arabe. Il existe, en revanche, des adeptes de l’exhumation cyclique et ritualisée de certaines valeurs prétendument culturelles, puisées dans le fonds arabo-musulman diffus et sustentant bien des ressentiments, parfois exacerbés, contre l’Europe, symbole de l’Occident suffisant et dédaigneux. Des ressentiments qui surgissent, souvent, à l’insu de l’Europe, malgré le tintamarre rugissant sur les démons et les symboles de l’Intrusion, cités plus haut. Ces ressentiments qui sont l’expression actualisée d’un legs civilisationnel fortement embrouillé, revêtent des caractères éminemment culturels, parfois religieux. Mais au-delà des bornages multiples qui existent entre les deux flancs, la plus importante est, sans conteste, d’ordre mental. Elle procède d’une vision d’éloignement délibéré voire d’exclusiondéclarée, à l’instar de l’euphémisme, à courte sémantique, subi-choisi, qui confine les rivages extérieurs au nord, dans une altérisation durableconçue comme intrinsèquement incompatible avec la culture européenne.
La polémique autour de l’adhésion de la Turquie à l’UE, demeure un exemple édifiant. On ne semble aucunement tirer les conséquences de ce casus belli. Ce qui amène à reposer constamment l’inévitable question, mentionnée plus haut, et tant décriée par la revue Peuples méditerranéens, celle de l’Identité culturelle de l’Europe non assumée. En revanche, la volonté de concevoir le projet d’un univers méditerranéen dans sa culturalité plurielle et diversifié revient à reconsidérer sérieusement la configuration, et partant la représentation actuelle des relations culturelles euro-méditerranéennes et par extension le rapport d’ambivalence timorée de l’Europe au reste du monde méditerranéen, au monde islamo-méditerranéen voire au monde tout court.
2/ C’est sur le plan économique que le divorce, ou tout au moins la séparation de corps, entre le monde islamo-méditerranéen et l’Europe est la plus intimement consommée. La diversification des partenaires, qui s’était déjà amorcée avec les Etats-Unis, s’est amplement élargie aux pays de l’Asie, notamment la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l’Inde, rejoint par la Turquie et l’Iran, déjà solidement implantés dans la rive sud. A ce rythme les Etats-Unis d’Amérique, ces non méditerranéens, sont en passe de devenir l’acteur déterminant en Méditerranée, même si celle-ci est, apparemment, scotomisée de leur littérature stratégique. Une attitude qui tranche avec celle de l’Europe, dont l’inflation discursive sur la Méditerranée est inversement proportionnelle à la parcimonie des initiatives en sa faveur.
Le mirage de l’Euro-méditerranée
Pendant ce temps, le projet d’une aire euro-méditerranéenne, appelée à devenir à l’horizon, décalé, 2010-2020, une vaste zone de libre échange et de prospérité économique (ZLEEM), est encore à l’état d’abstraction. Encore une échéance qui restera, sans doute, lettre morte, comme bien des serments et des jurements mort-nés, de la charte du processus de Barcelone.
De toute évidence la promesse euro-méditerranéenne ne saurait se réaliser tant qu’une vision ou une représentation d’antagonisation, voire d’antinomisation habite durablement les rapports de l’Europe avec ses partenaires méditerranéens, qu’ils soient de la rive sud ou du monde islamo-méditerranéen tel qu’il est défini dans la problématique de la revue P M.
Cette représentation d’opposition, qui tend à se banaliser, anéantit toute possibilité d’une méditerraneité apaisée. Une méditerraneité retrouvée. Elle ruine les fondements des attaches complexes et diversifiées qui se sont tissés à travers l’histoire. Des attaches qui se trouvent, fortement embrouillées, mais qui refusent de s’estomper, malgré les dissonances et les discordances proclamées. Il est patent que des différenciations et des diversifications, de toute nature, habitent et agitent les rivages chamarrés de la méditerranée. On ne se lassera jamais de le répéter, elle est le lieu d’un entrelacs enchevêtré où s’imbriquent des nuances et des dissemblances, mais c’est aussi un nœud d’interstices où s’accomplit rituellement, mais séparément, un même amarrage. D’où l’urgence pour l’Europe de «se reméditerranéiser», selon la belle formule d’Edgar Morin.
Support bibliographique
1- Voir l’ensemble des numéros de la revue Peuples Méditerranéens De 1 à 20 https://catalog.hathitrust.org/Record/000642880 http://www.limag.com/new/index.php?inc=dspper&per=00003393
2- Thierry Fabre l’Occident contre la méditerranée, éléments pour une approche géoculturelle in l’Europe et la méditerranée, Confluences Méditerranée N° 7 Eté 1993, pp 143-153.
3- Voir Claudine Rulleau et Paul Balta, La Méditerranée berceau de l’avenir, Les Essentiels, Ed Milan, Toulouse, 2006, pour la fibre culturelle enthousiaste qui traverse tout l’ouvrage.
4-Sur les inquiétudes, les incertitudes et le chemin qui reste, encore, à parcourir depuis Barcelone, voir Bichara Khader L’Europe pour la Méditerranée: De Barcelone à Barcelone (1995-2008) Ed. L’Harmattan, Paris, 2009 ainsi que Roberto Aliboni et Fouad Ammor, Du PEM à L’union méditerranéenne, Euromesco papers N°77, 2009.
5- Fernand Braudel a consacré l’essentiel de son effort intellectuel à la Mare Nostrum, au point où son œuvre est devenue synonyme de la méditerranée. Dans l’un de ses ouvrages, au titre évocateur, pour cette livraison, Mémoires de la Méditerranée, (Editions de Fallois 1998), il souligne, déjà, l’existence de deux parties méditerranéennes différenciées, l’une occidentale l’autre orientale, qui n’ont pas évolué conjointement et dont les divergences civilisationelles sont allées crescendo. Les ratages euro-méditerranéens présents sont-ils l’une des formes de manifestation actualisée de ces divergences?
7- Hayète Chérigui, La politique méditerranéenne de la France, entre diplomatie collective et leadership Ed. L’Harmattan, Paris, 1997.
8- Fin avril 2010, s’est tenue à Oran la conférence des 5+5 regroupant l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Lybie, la Mauritanie, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et Malte, consacrée au dossier des énergies renouvelables. Cela montre bien que l’Europe a, enfin, compris l’importance de l’enjeu. Ce sommet s’est soldé par la décision de création d’un Observatoire méditerranéen des énergies nouvelles situé à Oran qui n’a jamais vu le jour. Encore un mirage.
9- Sur les volets sécuritaire et stratégique voir Lesser, Ian O Rediscovering the Mediterranean: A Transatlantic Perspective on Security and Strategy, GMF Policy Brief, 2008.
10- Edgar Morin Penser la méditerranée et mediterranéiser la pensée in Méditerranée, linévitable dialogue N° 28, 1998.
Pas moins de sept livraisons de la revue Confluences-Méditerranée ont été consacrées à la Méditerranée: 1993, N° 7 l’Europe et la Méditerranée; 1994, N° 12, Mouvements islamistes en Méditerranée, N°28, Méditerranée, l’inévitable dialogue; 2000, N° 35 Euro-méditerranée, un projet à réinventer; 2002, N° 40 La Méditerranée à l’épreuve du 11 septembre; 2006, N° 58, Eau et pouvoirs en Méditerranée; 2007, N° 63 La France et la Méditerranée, sans compter l’ensemble des numéros qui ont pour substantifique matière les questions méditerranéennes. L’inévitable dialogue CM N° 28 1998-1999 pp 33-47 Harmattan Paris.
11- Rabeh Sebaa Algérie, la tierce rive en méditerranée CM N° 74 été 2010. Harmattan Paris. Une partie de cette publication est reprise dans la présente contribution.