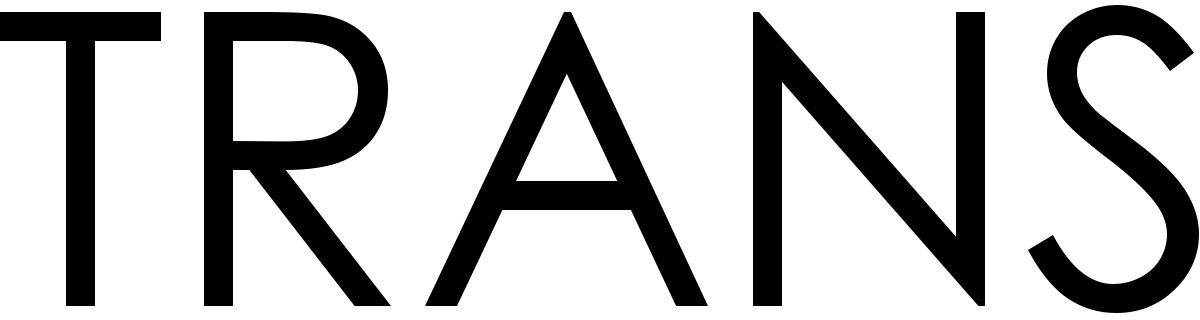ALLAM-IDDOU Samira
Centre Universitaire d’Aïn Témouchent
Abstract
In the context of globalization, the dynamics of national and international economic and trade exchanges are increasingly intensifying in the daily life of different countries. The impact of university education on society and the world of work is becoming more and more important. It should be mentioned that university training not only requires mainly specialty skills, but language skills to be integrated in the current labor market as well. It is therefore appropriate in this article to focus on the characteristics of the language needs of students in the different fields of their specialty, namely Trade and Economic Management. Through this communication we try to present a proposal for a pedagogical approach which must meet the students‘ demand and satisfy their language needs in their field of specialization in order to gain access to the most diverse professional sectors.
Mots clefs : compétences langagières-compétences de spécialité-besoins langagiers et communicatifs-formation universitaire– langues étrangères- marché du travail.
-
Introduction et problématique
Notre présent article reflète l’intérêt suscité par le thème du colloque non seulement auprès des enseignants, mais aussi auprès des étudiants. Ces derniers constituent l’élément central de tout projet pédagogique.
Dans le contexte de la mondialisation, la dynamique des échanges économiques et commerciaux, nationaux et internationaux, s’intensifie de plus en plus, dans la vie quotidienne des différents pays. Ainsi, actuellement, l’impact de la formation universitaire, sur la société et le monde du travail, devient de plus en plus important. Rappelons que la formation universitaire est l’un des principaux acteurs du changement social, économique : elle en est même un vecteur principal. Elle joue un rôle majeur en apportant des actions positives et constructives, dans le développent de notre société et la résolution de ses problèmes.
Néanmoins, il est à constater, aujourd’hui, que la situation actuelle de l’université algérienne ne semble guère radieuse, face à une mondialisation héraldique. Il suffit de penser au développement de cette noble institution, face aux nouveaux défis qu’induit cette mondialisation : compétition internationale de plus en plus implacable et bataille inégale de la communication (face aux réseaux transnationaux d’échanges pour la constitution de réelles « communautés de communication », favorisant le transfert quantitatif de l’information mais sûrement pas qualitatif.) (Miliani. M, 2006 : 97).
Par ailleurs, il est important de mentionner que la formation universitaire demande ou exige, de prime abord, un approfondissement des compétences de spécialité, mais aussi des compétences langagières, pour pouvoir se repositionner et pour mieux avancer, dans cette ère de grandes mutations, surtout scientifiques, technologiques, économiques.
En vue de répondre aux exigences imposées par le marché, en besoins langagiers et répondre aussi au processus de l’homogénéisation linguistique externe, qu’impose la mondialisation, la réforme universitaire, avec la mise en place du LMD en 2004, restructure et révise les programmes d’enseignement, dont l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères, en l’occurrence le français et l’anglais, dans les différentes filières scientifiques et de spécialités, telles que les Sciences Commerciales, Economiques et de Gestion(…),deviennent des objectifs d’une primauté majeure, à assigner à ses spécialités.
Il convient donc, dans cet article, de s’intéresser aux caractéristiques des besoins langagiers des étudiants, dans les différents domaines de leur spécialité, à savoir le Commerce et la Gestion Economique. Aussi, par le biais de cet article, il nous semble utile de proposer une intervention, voire même une stratégie pédagogique, qui doit répondre à la demande des étudiants et satisfaire leurs besoins langagiers, dans leur domaine de spécialisation. Mais avant d’apporter toute proposition, notre réflexion nous amène à formuler une interrogation essentielle, voire une problématique :
« Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour la formation de « performants » étudiants des filières scientifiques ? »
Ce qui provoque d’autres questions inhérentes à cet axe :
-
Quel est le rôle de l’enseignant ou du formateur proprement dit ?
-
Est-ce qu’il y a un spécifique de la formation des apprenants des filières ou des branches scientifiques ?
-
Quelle sont les exigences pédagogiques pour ce type d’apprentissage ?
-
Quelle sont les dispositions ou les méthodes pédagogiques à entreprendre ?
-
Quelles sont les perspectives de l’intégration de ces apprenants sur le marché du travail actuel ?
Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, et après avoir constaté que les syllabus de ces filières semblent ignorer et leur développement à l’université, nous allons d’abord essayer par le présent article, de démontrer le rôle que joue l’apprentissage des langues étrangères, à caractère spécifique, en vue de l’intégration des étudiants dans la vie professionnelle et le marché du travail actuel.
-
Méthode d’apprentissage des langues étrangères à caractère spécifique
Il est utile de considérer que parmi les domaines où l’apprentissage des langues étrangères en l’occurrence l’anglais et le français, considérées comme des langues de savoir (plus de 80% de la littérature scientifique se fait en anglais dans le monde), est devenu obligatoire, on peut citer celui des Sciences Commerciales et de Gestion. Ces filières demandent réellement une bonne maîtrise des langues étrangères, voire même un approfondissement des procédés et des pratiques pédagogiques, pour pouvoir répondre d’une manière efficace aux besoins, ainsi qu’aux exigences du public ciblé ; c’est-à-dire, les étudiants. Car, dès la fin de leur cursus universitaire, les apprenants des ces filières se verront confrontés à des situations où l’usage et la maîtrise de ces langues étrangères, dans des contextes spécifiques, peuvent s’avérer d’une importance majeure.
L’apprentissage des langues à caractère spécifique devient une nécessité, tant les différentes situations discursives auxquelles vont être confrontés les futurs diplômés, dans le cadre des situations professionnels et qui réclament non seulement une meilleure maîtrise des éléments linguistiques de base, appelée aussi le FOG (français sur objectif général) par les chercheurs spécialisés en didactiques, mais aussi une bonne maîtrise des éléments linguistiques, à caractère spécifique.
Ceci nous amène à parler plus particulièrement du FOS, c’est-à-dire, du français sur objectif spécifique.
Cette même expression nous est parvenue de l’anglais « English for spécific Purposes » (ESP). AMARA. A (2004 : 145) définit le FOS comme « une langue seconde que l’apprenant acquiert dans le cadre d’un apprentissage scolaire ». Par ailleurs, SEBANE. M (2011 : 377), nous propose une définition plus détaillée de ce concept :
il s’agit d’une situation particulière d’enseignement du français langue étrangère (FLE), à l’issue de laquelle l’apprenant doit être capable d’accomplir une activité, qui sollicite l’utilisation de la langue. L’objectif de cet enseignement est d’amener l’apprenant non pas à connaître seulement la langue française, comme langue de culture, mais d’être apte à entreprendre par le biais de cette langue. L’apprenant n’apprend plus « le » français » mais « du « français ».
Concernant le dispositif FOU, autrement dit, français sur objectif universitaire. Selon l’auteure, il s’agit d’un enseignement qui est destiné à des étudiants de niveau et de spécialités confondus. Son objectif général est le « comment » c’est-à-dire comment prendre des notes, comment rédiger un résumé, une synthèse de documents, une introduction, un plan, une conclusion …. Le FOU ne concerne pas seulement le public de scientifique mais aussi les étudiants inscrits dans les filières littéraires.
Ce type d’enseignement a pour mission principale de réussir l’intégration de tous les étudiants, à l’université. Le FOU se distingue du français de spécialité en cela qu’il n’a pas le contenu d’une discipline.
À partir de ces définitions, nous constatons que l’enseignement des langues étrangères sur objectif spécifique (commerce, gestion, marketing, hôtellerie, tourisme, etc.) ne se différencie pas de l’enseignement des langues étrangère en général, les démarches à mettre en œuvre, sont les mêmes à ces situations d’apprentissage.
[…] dans la mesure où la problématique posée par les formations sur objectifs spécifiques, ne se différencie pas fondamentalement de la problématique générale de l’enseignement des langues, les démarches à mettre en œuvre vont se révéler utilement applicables à toute situation d’apprentissage. (BALMET., S-E et DE LEGGE.M-H, 1992 : 7)
À cet effet, il convient donc de rappeler la question de l’utilité de la langue en général.
Ce qu’on appelle communément langue générale doit être considérée comme pré-requis et un acquis de base afin de mieux appréhender une éventuelle individualisation des besoins. Une base linguistique commune et générale assurerait également une meilleure adaptation et une meilleur adéquation aux domaines spécifique qui eux même ont besoin d’éléments communs pour assurer des liens interdisciplinaires. (KIES. M, 2011 : 34).
Une telle stratégie offre une meilleure acquisition de ces outils langagiers, en développant chez l’étudiant une réflexion métalinguistique1, qui lui permettra d’établir le lien entre la langue et les spécialités enseignées, afin de mieux s’approprier les savoirs produits ailleurs, dans des langues qu’il ne maîtrise pas (français, anglais, …).
Néanmoins, il arrive que cette situation particulière d’apprentissage nécessite un engagement matériel et pédagogique adapté, pour pouvoir mettre en concordance, l’enseignement à objectifs spécifiques avec les réalités du terrain et ses particularités.
Cependant, il est à constater que des difficultés de la mise en place de cet enseignement se posent. Donc, il est essentiel de mener une réflexion sur les liens entre théorie et terrain, non seulement du point de vue linguistique, mais aussi du point de vue didactique. A cet effet, une étude et une analyse optimale des besoins langagiers des étudiants, est nécessaire pour cerner leurs carences et pouvoir améliorer leurs capacités linguistiques et communicatives.
-
Précepte ou quelle stratégie pédagogique préconiser ?
Ce que nous proposons, comme solution, pour affronter cette mondialisation qui exige un approfondissement des compétences de spécialité, mais aussi des compétences langagières, à l’instar des chercheurs spécialisés en didactique et en sociolinguistique, il nous semble qu’il existe une solution appropriée, à laquelle quatre partenaires doivent contribuer et qui sont : les décideurs politiques, les autorités éducatives, les enseignants et les apprenants. Laissons de côté les deux premiers partenaires et commençons d’abord par ‘ les gardiens de la norme’, c’est-à- dire, les enseignants qui sont, pensons-nous, les premiers responsables, du niveau des compétences de leurs apprenants.
A cet effet, ils doivent non seulement collaborer d’une manière systématique et stratégique, à mieux renforcer l’apprentissage des langues étrangères, mais aussi changer les représentations des apprenants, en leur expliquant que la dimension linguistique n’est pas secondaire, dans leur apprentissage. Car la langue peut être aussi un moyen que l’école utilise pour véhiculer des représentations sociolinguistiques. Elle joue à la fois un rôle important dans la transmission des connaissances et la reconnaissance de la langue légitime ; car toute langue véhicule non seulement des savoirs savants (des représentatifs relatifs à la langue elle-même), mais également des savoirs sociaux (représentatifs relatifs aux valeurs culturelles, etc).
Ceci dit, le rôle des représentations linguistiques est très important dans le sens où il détermine les attitude et oriente certains comportements sociaux, y compris les pratiques linguistiques, car elles peuvent faire tourner « la boussole » dans le sens inverse ; d’autant plus que l’image qu’a le locuteur d’une langue donnée peut être définie comme « des conceptions que les locuteurs, ou groupe de locuteurs, ont de son rôle, de sa valeur, de ses fonctions et qui, pour être souvent non conscient, sont néanmoins, à l’origine des comportements. » (BAUTIER. C.E, 1981 : 25). Ces représentations produisent quant à elles, comme nous l’avons mentionné, différentes attitudes vis-à vis des langues étrangères. La diversité des locuteurs et la diversité de leurs conduites, dépendent inévitablement des représentations linguistiques, inhérentes aux idéologies linguistiques2, qui s’alimentent dans les idéologies. Ces dernières seront diffusées par le biais de passeurs culturels, qui véhiculent des discours épilinguistiques, des images, des comportements et des styles.
C’est la raison pour laquelle nous adoptons le même point de vue que le professeur MILIANI quant à l’apprentissage des langues étrangères. En effet, ce didacticien estime qu’il […] serait souhaitable qu’ils [les enseignants] puissent procéder de manière systématique et stratégique comme leurs pairs britanniques qui, par le biais du « langage across the curriculum » de 1975 (la langue à travers le cursus scolaire) ont contribué à mieux asseoir l’apprentissage de la langue anglaise, mais aussi pour changer les représentations des apprenants, en leurs faisant saisir l’idée, que la dimension linguistique n’est pas secondaire, dans leurs apprentissages.
Créer du sens au niveau de n’importe quelle spécialité est aussi un problème langagier. Ce processus faciliterait aussi le transfert (positif il faut espérer), qui aiderait à l’acquisition des langues étrangères, afin que ces dernières contribuent à l’annulation des représentations monolithiques (développées par l’école) des apprenants, face aux problèmes langagiers. (MILIANI. M, 2006 : 104)
En outre, aujourd’hui l’importance des langues étrangères n’est plus à démontrer. Il faut mentionner qu’il est impensable d’oublier de mettre l’accent sur leur apprentissage, ainsi que leur maîtrise qui permettrait non seulement de comprendre la différence de l’autre, dans un monde où les distances s’effacent de plus en plus, mais c’est surtout l’importance de ces langues, en terme utilitaire, que l’on doit évoquer. Il faut leur expliquer que les langues étrangères sont des langues de la technologie, d’ouverture, de développement et de la modernité.
Leur maîtrise représente un atout pour la réussite professionnelle, dans le monde du travail (qui demande de plus en plus la connaissance de ces langues). TALEB IBRAHIMI. K (1995 : 17) nous éclaire mieux sur cette situation linguistique, en affirmant qu’ « à l’université le français reste la langue prépondérante, dans les filières scientifiques et technologiques ; la langue française reste prépondérante, à l’usage dans la vie économique du pays : les secteurs économiques et financiers fonctionnent presque en français. »
Mais, avant toute chose, il serait pertinent de rappeler que les enseignants ont pour tâche primordiale d’accompagner leurs apprenants, dans l’acquisition du savoir, pour en faire des compétences réelles, aboutissant à un acte positif dans le développement de notre société. Ils ont aussi pour objectif principal, d’identifier les besoins langagiers et communicatifs de leurs apprenants, afin de les introduire dans le processus constructeur de compétences langagières, communicatives, stratégiques,… Ils ont également pour mission non seulement de transmettre un savoir, comme nous venons de le mentionner plus haut, mais aussi de permettre à l’apprenant de développer son savoir, son savoir-être, autrement dit, sa volonté de s’engager dans le processus de l’apprentissage, afin de mettre en pratique ses compétences et son expérience et de créer également un savoir-faire (ALLAM-IDDOU. S, 2015 : 101).
Ceci développe et complète en grande partie les savoirs et les savoir-faire langagiers, liés aux objectifs assignés et de les réinvestir de façon optimale, en situation pratique. Car aujourd’hui, il n’est plus question d’un enseignement théorique et il est important d’éviter de creuser le fossé, entre la théorie et la pratique. Bien au contraire, préconiser une stratégie dans le sens où l’alternance entre théorie et pratique, met le plus souvent possible, les apprenants en situation réelle de communication.
De ce fait, la méthodologie la mieux adaptée, pensons-nous, à ce type d’apprentissage est l’approche communicative dans le sens où elle permet de favoriser, de mettre en œuvre et de consolider, d’une façon optimale, les compétences langagières relatives à cet apprentissage. La maîtrise de celles-ci permet également aux apprenants de faire face avec succès, si nous osons dire, aux situations de communication, auxquelles ils seront confrontés, plus tard, dans leur vie professionnelle.
Ainsi, il est à souligner que les enseignants sont prioritairement tenus d’être munis des compétences professionnelles aptes à produire, à leur tour, des compétences. Ces dernières sont définies comme « capacités à mobiliser des connaissances et savoir-faire spécifiques dans une situation donnée pour résoudre un problème spécifique ». (Rapport final de la conférence internationale : 2004). Alors, ils doivent systématiquement élaborer des supports didactiques, en adéquation à des situations d’imprégnation. Par exemple, ils sont sensés consacrer des cours de communication orale aux étudiants.
Ce genre de cours peut développer chez les étudiants une aisance à parler en public et consolider leurs capacités langagières. Ces cours sont très encourageants dans les situations de négociations commerciales. Étant donné qu’aujourd’hui, les étudiants sont ‘des demandeurs d’outils opérateurs’, les enseignants doivent améliorer leurs techniques de rédaction (exemples : écrire des CV, des lettres commerciales, des rapports administratifs).
Les enseignants doivent également apprendre à leurs étudiants de reproduire, en TD, les principales circonstances, dans lesquelles les étudiants sont appelés à travailler. Ces derniers doivent se montrer capables de reproduire des situations de communications, liées par exemple, aux domaines des affaires. En plus, il nous semble primordial d’habituer l’étudiant à écouter des enregistrements ayant comme sujet principal une tractation commerciale. Ceci l’aiderait à l’assimilation des messages en situation authentique. Ils doivent leur fournir les outils nécessaires pour communiquer en langues étrangères, en l’occurrence le français et l’anglais, dans leurs pratiques professionnelles futures. Enfin, nous considérons que les enseignants sont, en grande partie, responsables de la formation de leurs apprenants, c’est la raison pour laquelle ils doivent veiller à intellectualiser, voire même professionnaliser des comportements, sachant que ces comportements ne s’acquièrent pas en formation seulement, mais bien avant, dans les pratiques quotidiennes exercées au sein de la classe, avec les apprenants.
Quant aux étudiants, il leur est indispensable d’abord de comprendre que la responsabilité d’apprentissage n’incombe pas seulement à l’enseignant, ils ne doivent pas se contenter seulement de ce que l’enseignant leur donne. Ils doivent comprendre que le savoir, surtout dans le contexte universitaire, ne se limite pas uniquement à celui de l’enseignant, autrefois appelé ‘détenteur du savoir’, mais il faut qu’ils soient partie prenante dans le façonnement du savoir, en cours ou en TD, en s’impliquant de manière active dans leur apprentissage, car s’agissant d’un processus interactionnel entre enseignant et étudiants qui permettra justement à ces derniers de participer à leur construction intellectuelle.
Ils doivent également savoir établir le lien entre la langue et les spécialités enseignées, pour pouvoir exprimer des savoirs produits, ailleurs, dans des langues qu’ils ne maîtrisent pas. Savoir approfondir dans la langue étrangère les compétences spécifiques à leurs domaines de spécialité. Subséquemment, une inscription qui s’avère très indispensable au CIEL3, par exemple, les aidera à avoir un accès plus facile à leurs études universitaires, comme ils seront également capables de développer leurs compétences langagières et communicationnelles. Il s’agit, pour nous, d’une formation linguistique qui apporterait des solutions concrètes. A ce sujet, M. SEBANE (2011 : 378) apporte plus de précisions en disant qu’il s’agit :
D’une formation en amont de leur formation initiale, c’est-à-dire que les deux mois (septembre, Octobre) devrait être consacrés à une remise à niveau linguistiques avec des sessions intensives et une initiation aux caractéristiques des méthodes de travail qu’ils vont utiliser durant leur cursus (Prise de notes, cours magistral, résumé). Et durant l’année universitaire, le module de langue (1H30 / semaine) devrait être assuré par les enseignants du CEIL qui ont été formés à ce type d’enseignement.
Mais, le plus important pour mieux apprendre et maîtriser les langues étrangères, l’étudiant doit pratiquer ces langues, doit communiquer en langues étrangères, afin d’améliorer et développer ses capacités langagières, liées surtout au domaine de sa spécialité et qui lui seront très utiles, plus tard, dans des contextes professionnels réels. Comprendre et maîtriser d’abord les langues étrangères dans leurs dimensions linguistiques/culturelles, mais surtout savoir les réinvestir, par la suite, l’aidera sans aucun doute à mieux structurer sa personnalité, ses représentations, ses conceptions et ses préjugés vis-à-vis de ces langues. Ceci s’avère indispensable dans le développement de son autonomie intellectuelle et interculturelle.
Etant donné que nous sommes spécialisée en sciences du langage, nous projetons de mener une enquête sociolinguistique chez les étudiants de la troisième année des départements des Sciences Commerciales, Economiques et de Gestion4 (voir les pages qui suivent) pour pouvoir comprendre les représentations5 de ces étudiants, ainsi que leurs attitudes vis-à-vis des langues étrangères. Rappelons que dés la fin de leur cursus universitaires, les étudiants en question se verront confronter à des situations réelles de communication où une bonne maîtrise du français et de l’anglais se révèle d’une grande importance.
3. Élément de conclusion
En guise de conclusion, nous devons retenir que la formation universitaire se doit de palier aux exigences nouvelles, quant aux compétences de spécialité, mais aussi des compétences langagières nécessaires, pour leur acquisition et leur maîtrise. C’est pour ces raisons qu’allier FOS et FOU [surtout dans le cas des étudiants des départements des Sciences Commerciales, Economiques et de Gestion] serait en effet une solution qui permettraient à surmonter les obstacles6.
Ainsi, il est essentiel pour nous d’ajouter que la responsabilité des enseignants chercheurs s’avère incontournable, dans ce domaine qui permettrait une démarche de qualité dans la mise en œuvre d’un programme d’apprentissage spécifique, en adéquation avec ces spécialités, afin de répondre aux exigences pédagogiques, associées à cet enseignement et ainsi les exigences des étudiants en question. Nous soulignons que ce constat établi concernant la maîtrise des langues étrangères, en vue de l’intégration des étudiants sur le marché actuel, est loin d’être exhaustif. Il serait intéressant de procéder à d’autres études plus approfondies, pour pouvoir trouver des éléments de réponse à la batterie de questions, que nous avons évoquée dans notre introduction. Rappelons que cet article n’a pas pour ambition d’adopter ou d’appliquer impérativement une démarche pédagogique. Il n’a pour objectif, que de faire une simple proposition qui pourrait répondre à la demande des étudiants, inscrits en Sciences Commerciales, Economique de Gestion et satisfaire leurs besoins langagiers. Donc, nous laissons le soin, dans d’autres cadres d’intervention, à nos collègues en sociolinguistique et en didactique spécialisés en FOS et/ou FOU d’apporter plus d’éclaircissements à sujet.
-
Description de l’enquête sociolinguistique
L’intitulé de l’enquête : Représentations linguistiques et pratiques langagières. (Cas des apprenants des départements de Sciences Commerciales, Economiques et de Gestion).
Cette étude est une ébauche préalable des représentations d’un groupe d’une centaine d’étudiants universitaires, relatives à l’apprentissage des langues étrangères à savoir le français et l’anglais. Dans cette étude, les apprenants sont des étudiants du département des Sciences Commerciales, Economiques et de Gestion donc ces études conduisent les étudiants aux secteurs professionnels les plus diversifiés, allant du commerce à l’industrie, de la finance à la comptabilité en passant par le management et les ressources humaines. Les diplômes d’Economie-Gestion sont appréciés dans les services d’études, de recherche, de conseil. On les trouve dans les très grands organismes et entreprises, mais aussi dans l’enseignement et la recherche, le secteur de la banque et de l’assurance. A cet effet, l’étude se déroule à l’Institut des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion du Centre Universitaire d’Ain Témouchent où nous exerçons notre métier d’enseignante. Dans cette étude, nous nous attachons également à étudier les représentations des enseignants de ces filières afin de détecter des inadéquations entre les représentations des apprenants et celles des enseignants. Dans le but d’explorer le phénomène des représentations de différentes perspectives, nous utilisons diverses approches méthodologiques. Nous optons pour des moyens d’investigation directs : un questionnaire pour les étudiants, et un entretien semi-directif avec les enseignants. Ces outils de recherche nous permettent de faire émerger les représentations des étudiants, qui constituent notre panel, vis-à-vis des langues étrangère, leurs opinions et leurs attitudes. Nous rassemblons des données à la fois quantitatives issues des questionnaires et qualitatives issues des entretiens afin de pouvoir expliquer les données obtenues. Les catégories d’analyse émanent d’un questionnaire et la transcription des entretins. La méthode d’analyse s’inscrit dans une perspective sociolinguistique. À une analyse de contenu succède une analyse du discours, le tout portant à la fois sur des entretiens et des enquêtes explicites. Un des principaux objectifs de cette étude est de mettre en lumière les représentations fondamentales des étudiants. Par le biais de cette étude, nous essayons aussi de montrer qu’il existe des liens entre les représentations des étudiants, leurs attentes et le type de leur motivation.
-
Références bibliographiques
-
ALLAM-IDDOU, S. (2015), De l’usage des textes littéraires comme outil didactique pour l’enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère, [https://gerflint.fr/Base/Chili11/allam-iddou.pdf]
-
ALLAM-IDDOU, S. (2012), L’insécurité linguistique en FLE : entre représentations linguistiques et pratiques langagières. (cas des apprenants de la 3ème année secondaire), Edilivre-Editions , Paris, France.
-
AMARA, A. (2004), Quel français de spécialité par rapport à quelle langue maternelle ? Cahier de langue et de littérature, Revue n°2, Université de Mostagemen.
-
BALMET, S- et DE LEGGE, M. (1992), Pratiques du français scientifique, Ed. Hachette, 07.
-
BAUTIER, C.E, (1981), Une norme ou des normes, Insécurité linguistique et norme endogène en Afrique francophone, Paris Langues, 25.
-
GUEUNIER, N. (1997), Représentations linguistiques, Sociolinguistique, concepts de base, Edition P. Margada, Belgique, 246.
-
KIES, M. (2011), L’enseignement de l’Anglais dans les Filières des Sciences Economiques, At-Talimia, Revue n°1. Université Djilali Liabes, 34.
-
LERAT, P. (1995), Les langues spécialisées, Paris, PUF.
-
MILIANI, M. (2006), L’Université Algérienne face au Marché des Langues : L’autre challenge à La Mondialisation, Interculturalité et Didactique, Revue n°9 IMAGO, 103.
-
Rapport final de la conférence internationale de l’éducation, 47ème session, Genève (8-11) Septembre 2004, Unesco, BIE, [unesdoc.unesco.org/images/0013/001377/137735f.pdf]
-
SEBANE, M. (2011), FOS / FOU : Quel français pour les étudiants algériens des filières scientifiques ?, [https://gerflint.fr/Base/Monde8-T2/sebane.pdf]
-
TALEB IBRAHIMI, K. (1995), Les Algériens et leur(s) langue(s), Éléments pour une approche sociolinguistique de la société algérienne, El Hikma, Alger, 17.
1 Miliani. M, Op.cit.
2 GUEUNIER, N. (1997), Représentations linguistiques, Sociolinguistique, concepts de base, Edition P. Margada, Belgique, 246.
3Centre d’enseignement intensif des langues.
4 Les étudiants en question sont des apprenants de la 3ème année spécialisés en management, commerce international et marketing
5Se référer à l’enquête menée par ALLAM-IDDOU. S, (2009), L’insécurité linguistique en FLE : entre représentations linguistiques et pratiques langagières. (Cas des apprenants de la 3ème année secondaire), Université Djilali Liabes, Sidi Bel Abbès.
6 SEBANE. M, Op, Cit.