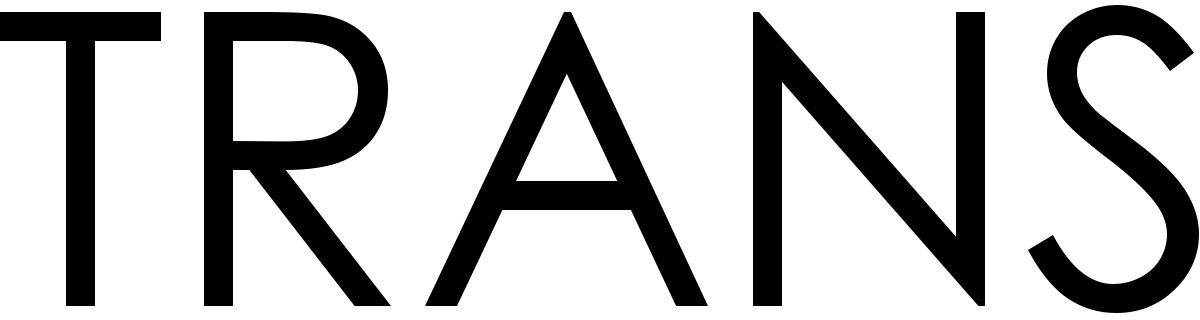Dr. BESSAI Rachid
Université A. Mira de Bejaia
Résumé
Le sujet de notre intervention s’inscrit dans le champ de la sociologie éducative, qui s’intéresse à étudier les phénomènes liés à l’éducation, la famille, l’école et à l’employabilité de la langue dans le milieu familial et scolaire. L’objectif de cette recherche sera d’étudier à travers une approche sociologique qualitative les pratiques éducatives familiales et leur rapport à la langue dans la région de Kabylie. L’intérêt sociologique de cette étude consiste à traiter la question des pratiques éducatives et langagières menées par la famille lors de son interaction avec l’école dans un contexte social connu par ces particularités linguistiques et culturelles. Nous entendons par le terme « pratiques éducatives et langagières»: toutes les actions et les pratiques quotidiennes menées par les parents envers leurs enfants sur le plan éducatif et scolaire (style de socialisation familiale, la nature des relations parents/enfants, la langue utilisée dans le dialogue entre les membres de la famille et son employabilité). Bref, nombreux sont les éléments suscités par l’objectif de cette intervention, dont lesquels nous tenterons d’intégrer la langue comme un élément principal dans ces pratiques éducatives et de montrer leurs influences multiples sur le plan scolaire, social et professionnel.
Mots-clés: pratiques éducatives-pratiques langagières–représentations sociales–famille-école.
ملخص:
يندرج موضوع مداخلتنا في حقل علم الاجتماع التربوي، الذي يهتم بدراسة الظواهر المتعلقة بالتربية والأسرة والمدرسة، وكذلك كيفية توظيف اللغة في الوسط الأسري والمدرسي. إن الهدف من هذا البحث هو دراسة الممارسات التربوية للأسرة وعلاقتها باللغة في منطقة القبائل. تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية السوسيولوجية كونها تعالج بطريقة كيفية مجموعة من الممارسات التربوية واللغوية التي تقوم بها الأسرة أثناء تفاعلها مع المدرسة في مجتمع معقد معروف بخصائصه اللغوية والثقافية. نقصد بمصطلح „الممارسات التربوية واللغوية“: كل الإجراءات والأفعال والممارسات اليومية التي يقوم بها الآباء تجاه أبنائهم سواء من الناحية التربوية أو من الناحية المدرسية، مثل (نمط التنشئة الاجتماعية وطبيعة العلاقات بين الآباء والأبناء واللغة المستخدمة في الحوار بين أفراد الأسرة وكذلك طريقة توظيفها). باختصار توجد العديد من العناصر التي أثارها الهدف من هذه الدراسة، والتي سنحاول من خلالها إدماج عامل اللغة كعنصر أساسي لتفسير هذه الممارسات التربوية وكذلك تبيان تأثيراتها المختلفة على المستوى المدرسي والاجتماعي والمهني.
الكلمات المفتاحية: الممارسات التربوية-الممارسات اللغوية – التمثلات الاجتماعية – الأسرة – المدرسة.
Introduction
La structure familiale en Kabylie est affectée par les conditions et les changements que la société lui impose, elle représente un sous-système social dans lequel l’enfant est élevé, grandit et acquière les premières règles qui définissent ses relations sociales avec autrui, à travers le processus de socialisation (ADDI, H.1999: 35). On ne peut étudier la famille en dehors de sa réalité sociologique, des circonstances qui l’entourent et le système de valeurs qui guide les interactions des acteurs et qui nous permet d’interpréter et de comprendre les pratiques éducatives familiales.
Nous entendons par le terme « pratiques éducatives et langagières»: toutes les actions et les pratiques quotidiennes menées par les parents envers leurs enfants sur le plan éducatif et scolaire (style de socialisation familiale, la nature des relations parents/enfants, la langue utilisée dans le dialogue entre les membres de la famille…etc).
Cette employabilité de la langue au sein de la famille est soumise à un certain nombre de facteurs sociaux et culturels, en particulier ceux liés à la langue de formation des parents et au contexte social dans lequel se trouve la famille (DE SINGLY, F. 2010: 89). Les disparités linguistiques observées dans la société algérienne, par rapport à la pratique de la langue, dépendent pratiquement de l’environnement socioculturel de chaque région. En Kabylie par exemple, compte tenu de ses spécificités éducatives, linguistiques et culturelles, une distinction peut être faite entre deux modèles dans l’utilisation de la langue: le premier est formel, monopolisé par des familles qui appartiennent aux classes privilégiées socialement et culturellement, elles utilisent habituellement la langue française dans leurs discussions.
Le deuxième est simple, commun et partagé par plusieurs couches sociales, il est le seul moyen pour elles de s’exprimer en langue maternelle (Tamazight). Ces deux modèles reflètent en réalité deux types d’employabilité: Le première est caractérisé par une construction langagière valable même dans d’autres régions du pays, parce qu’il est souvent indépendant de l’environnement social dans lequel il est inséré (BOUKHOBZA, M. 1989: 123).
En revanche, le deuxième dispose d’une langue riche en termes de vocabulaire, mais utilisé uniquement au sein de la même classe sociale ou dans la même zone géographique (BOUKHOBZA, M. 1989: 124). Bref, nombreux sont les éléments suscités par l’objectif de cette intervention, nous tenterons donc d’étudier la langue comme un élément principal de ces pratiques éducatives pour tenter d’analyser et de montrer leurs influences multiples sur le plan scolaire, social et professionnel.
- Problématique
Notre problématique repose sur l’idée qu’il existe une sorte de contradiction dans la famille algérienne. D’une part, nous remarquons que les pratiques et les stratégies menées par la famille expriment sa volonté et sa forte détermination à investir dans la scolarité des enfants. Ce qui signifie qu’elle essaye à tout prix de mettre tous les moyens nécessaires pour atteindre le succès scolaire et social et d’assurer un avenir prometteur pour ses membres. L’école, est donc pour la plupart des groupes sociaux un lieu d’apprentissage et de promotion sociale.
Cet intérêt porté à l’école se manifeste par le biais de grands espoirs attachés à l’établissement scolaire qui se traduit probablement d’une façon implicite par une certaine gamme potentielle d’actes et d’enjeux selon lesquels la famille visait à maintenir ses objectifs et où les parents investissent en permanence dans l’éducation de leurs enfants – selon leurs niveaux d’instruction – afin de les aider à réussir même si cela leur en coûte du temps et de l’argent (BENMELHA, G. 1982: 140). D’autre part, selon les résultats de l’enquête que nous avons effectuée auparavant sur les représentations des parents de l’école publique algérienne, il semble que les parents font preuve de pessimisme et de perte de confiance envers cette institution. Cela se manifeste, d’après les sociologues, à travers des discours négatifs sur l’école et des critiques répétées par les parents ainsi que leur rapport à l’institution scolaire qui est souvent en situation de malentendu (LAHIRE, B. 1995 : 88). Ceci suggère que l’école n’est plus un centre d’intérêt pour les parents qui ne lui font pas pleinement confiance comme un moyen de promotion sociale pour leurs enfants. Ils préfèrent d’autres moyens de réussite pour leurs enfants sans passer par l’école (DUBET, F. 1997 : 45).
Cela indique d’après ce que nous avons précédemment expliqué qu’il existe un fait réel contradictoire entre ce que les parents disent à travers leurs opinions et les perceptions de l’école d’une part, et ce qu’ils font en matière de pratiques éducatives quotidiennes d’autre part. Cette contradiction nous a motivé à mener une étude empirique afin de répondre à plusieurs questions suscitées par l’objectif de cette intervention, ci-dessous quelques unes : Quelles sont les différentes pratiques et les stratégies éducatives menées par les familles dans la région de Bejaïa? Quels sont les facteurs et les raisons qui les pousseraient à développer ce type de stratégies ? Quel est l’impact de la langue sur ces pratiques et ces multiples influences en milieu scolaire ?
- Méthodologie
Afin de répondre à ces questions de recherche, nous avons opté pour la méthode qualitative, qui semble, à notre avis, la plus appropriée pour traiter ce type de sujets parce que nous voulons expliquer certains aspects de l’éducation dans la famille à Bejaia, notamment ceux qui sont liés aux pratiques éducatives parentales. Notre utilisation du qualitatif se justifie également par le choix de la technique d’enquête, car nous avons utilisé la technique de l’entrevue qui nous permet d’approfondir davantage par une série de questions sous forme d’entretiens destinés aux parents d’élèves par rapport à l’éducation et à la scolarité de leurs enfants (PAILLE, P. MUCCHIELLI, A. 2008 : 124). Nous souhaiterions mettre la lumière sur les caractéristiques de la famille dans la région de Béjaia en matière d’éducation et son rapport à l’école tout en montrant les influences multiples de ses stratégies sur le plan scolaire.
Nous avons donc utilisé, un entretien « semi-directif » qui s’appuie sur la compréhension, qui est un outil approprié pour enquêter sur les pratiques et les stratégies parentales (PAILLE, P. MUCCHIELLI, A. 2008 : 211). Le but d’interroger les parents d’élèves par le biais d’un entretien est de leur donner plus de liberté de sorte à exprimer leurs idées et leurs attitudes et de répondre à nos questions qui visent à dégager les caractéristiques de leur environnement socioculturel.
Il convient de noter également que le but d’interroger ces parents est de vérifier s’il y a réellement une contradiction entre ce qu’ils déclarent (leurs opinions, attitudes et représentations) et ce qu’ils font dans la réalité (leurs comportements, action et pratiques). Ensuite, montrer la différence entre les actions menées et les objectifs visés pour tenter d’interpréter et de comprendre les stratégies éducatives familiales.
- Lieu de l’enquête
L’enquête a eu lieu dans la wilaya de Bejaia qui représente le cadre spatial de notre étude où nous avons choisi un groupe de familles dans différentes localités de la région de Bejaia pour plusieurs raisons. D’abord notre connaissance du terrain : Nous vivons dans cette région où nous avons beaucoup d’informations sur les caractéristiques de la famille bougeotte. Ensuite, nous connaissons l’environnement social des familles et leur quotidien, chose qui nous a aidés à mener des entretiens avec ces familles.
Enfin, notre expérience modeste en tant que chercheur à plusieurs reprises auprès des personnes issues de cette région, nous a motivés pour faire l’enquête. Nous avons essayé donc d’utiliser notre réseau de relations sociales (voisins, amis, parents, chefs d’établissements scolaires et habitants du quartier) afin de se rapprocher du groupe de familles visé.L’envie de faire une étude sociologique sur notre région nous a motivé à choisir un groupe de familles dans le but d’interroger plus particulièrement les parents sur plusieurs points liés à l’éducation et à la scolarité de leurs enfants, d’autant plus que les études sociologiques consacrées à ce sujet sont très rares notamment dans cette région.
Bejaia est une ville d’histoire et de tourisme, classée parmi les villes caractérisées par une densité de population et une mobilité démographique rapide. Elle est connue également par sa diversité au niveau culturel et social, elle est aussi un lieu de production de certaines valeurs et de la convergence de diverses pratiques disparates socialement, culturellement et même linguistiquement.
Le degré d’ouverture et d’innovation qu’a connu la ville de Bejaia ces dernières années a motivé notre choix pour effectuer une recherche sur la structure familiale. Cette ville porte toutes les qualités existant dans les grandes villes sur le plan historique, économique et culturel. Toutes ces caractéristiques ont fait de cette ville un endroit pour la formation d’un groupe de pratiques éducatives et de stratégies familiales, qui semblent parfois mélangées et contradictoires.
- Présentation des familles interrogées
Nous avons sélectionné un groupe de 20 familles dont les caractéristiques culturelles et sociales sont hétérogènes représentant de nombreuses localités de la wilaya de Bejaia. Nous avons fait en sorte que ces familles possèdent au moins un élève scolarisé, et qu’elles représentent les différents groupes sociaux qui ne sont pas nécessairement homogènes. Après que le contact ait été effectué avec ces familles à l’aide des amis et des voisins, nous avons mené la plupart de nos entretiens avec les parents dans leurs domiciles.
- Analyse des données et résultats de l’enquête
Il semble, dans un premier temps, que la relation famille-école est caractérisée par une dynamique d’échange parfois implicite où la famille réagit en interaction par un ensemble de pratiques et de stratégies éducatives visant une possession plus grande du capital scolaire. Chaque famille a sa propre façon d’agir par rapport à l’enjeu scolaire d’où les différences entre les familles apparaissent au niveau des actions éducatives liées parfois aux caractéristiques culturelles et sociales de chaque groupe social d’appartenance. Il ressort à travers notre analyse du contenu des entretiens que ces pratiques éducatives parentales peuvent être classées selon quatre types :
- Style de socialisation familiale
- Dialogue familial et la langue utilisée
- Comportement parental envers les deux sexes
- Méthodes de punition ou/et de récompense
5.1. Style de socialisation familiale (relations parents/enfants)
Après l’analyse des entretiens, il ressort que la majorité des parents ont déclaré qu’ils ont de bonnes relations avec leurs enfants, à l’opposé de ce que nous imaginions avant l’enquête. Peut-être la norme qu’ils ont pris dans ces rapports c’est l’obéissance des enfants aux ordres parentaux, c’est-à-dire sans qu’il y ait une culture pour encourager les initiatives personnelles. Beaucoup de parents ont connus dans le passé un style éducatif traditionnel où certaines valeurs doivent être respectées par tous au cours du processus d’éducation (BENALI, R. 2004 : 174). Ces valeurs sont véhiculées par une culture traditionnelle de la famille algérienne et de la famille kabyle en particulier, qui sont ancrées dans la conscience collective et devenues une partie intégrante du processus de socialisation familiale.
Cependant, après la désintégration de la famille élargie et l’émergence de la famille nucléaire, les parents -grâce à leur niveau d’instruction- tentent de transformer l’héritage éducatif qu’ils ont connus dans le passé avec leur ancêtres d’une manière différente aux enfants en les poussant vers plus d’autonomie, d’indépendance et de responsabilités (BENALI, R. 2004 :182). Ils préfèrent donc un style éducatif permissif avec plus de liberté d’expression pour les enfants.
5.2. Dialogue au sein de la famille et la langue utilisée
Les résultats de l’enquête nous montrent qu’il y a en effet un dialogue au sein des familles interrogées, mais à des degrés différents, en fonction des caractéristiques culturelles de chaque famille: on peut distinguer entre deux catégories de parents: il y a ceux qui croient à la culture du dialogue, d’ailleurs qui fait partie de la tradition familiale, là où les membres de la famille sont autour d’une table ronde pour discuter des questions relatives à la famille avec la participation des enfants afin d’exprimer leurs points de vue sur les sujets abordés, voire même sont impliqués dans la prise de décision (THIN, D. 1998 : 64). Cela ne s’applique pas à ce que nous avons observé par rapport à la deuxième catégorie de parents, qui ont un niveau d’instruction limité et qui accordent moins d’importance au dialogue familiale, car ce n’est pas une priorité pour eux.
Quant à la langue utilisée dans le dialogue au sein des familles interrogées, nous avons constaté que la langue berbère est la plus utilisée, parce que pratiquement tous les habitants de la région parlent cette langue, puis arrive en deuxième position, le mélange entre le berbère et le français, et enfin à un degrés moins, le mélange entre le berbère, le français et l’arabe.
L’employabilité de la langue dans ce cas est soumise à un certain nombre de facteurs culturels, en particulier ceux liés à la langue de formation des parents (DURU-BELLAT, M. VAN ZANTAN, A. 2002 : 169). Exemple : lorsque les parents sont francophones, ils utilisent souvent la langue française dans leurs pratiques quotidiennes en matière d’éducation parfois sans faire attention, ce qui provoque parfois une perturbation dans l’acquisition de la langue maternelle chez les enfants.
5.3. Comportement parental envers les deux sexes sur le plan éducatif et affectif
La majorité des parents interrogés se sont mis d’accord qu’il y a une différence d’éducation envers les deux sexes. Les garçons, par exemple, bénéficient d’une marge de liberté plus grande que celle donnée aux filles surtout de la part des mamans. Quant aux filles, elles bénéficient de la part du père d’une tendresse et d’une tolérance plus significative que celle réservée aux garçons. Donc même les pratiques éducatives parentales sont influencées par ce style de socialisation.
Par ailleurs, certains parents ont témoigné que l’éducation de la fille est plus difficile que celle du garçon, parce que les filles sont plus audacieuses aujourd’hui, car elles ont les mêmes droits que les garçons. En ce qui concerne les pratiques des parents sur le plan affectif, une conclusion intéressante apparaît dans les résultats de l’enquête : les parents n’expriment pas leurs affection envers leurs enfants d’une manière explicite, c’est-à-dire, qu’ils ne montrent pas ouvertement et facilement leurs sentiments aux enfants, mais bien au contraire, ils préfèrent les cacher / les taire dès que les enfants avancent dans l’âge.
5.4. Méthodes de punition ou/et de récompense des enfants sur le plan scolaire
Nous avons constaté, dans un premier temps, que la majorité des parents interrogés procèdent à la punition de leurs enfants, qui est selon eux une méthode efficace et nécessaire parfois pour corriger le comportement d’indiscipline chez l’enfant. Ce comportement parental par rapport est très présent chez les familles qui n’ont pas encore dépassé le style éducatif traditionnel caractérisé généralement par l’autorité (BOUTEFNOUCHET, M. 1980 : 53). Mais, il existe une autre conception chez certains parents, qui pensent que la punition est une méthode révolue et qu’elle est non conforme aux caractéristiques de la famille contemporaine (DURNING, P. 1995 : 149).
Quant aux méthodes employées par les parents pour punir leurs enfants sur le plan scolaire, la plupart d’entre eux ont tendance à recourir à :
Un discours sévère envers les enfants pour les blâmer
La colère et le refus de discuter avec les enfants pendant une certaine période
Priver les enfants de choses qu’ils aiment
L’utilisation de la violence verbale et même physique dans certains cas.
Quant aux méthodes employées par les parents pour récompenser leurs enfants sur le plan scolaire, les parents ont cité quelques unes:
Offrir aux enfants des cadeaux
Remercier et encourager moralement les enfants.
Organiser une excursion pour les enfants
Offrir de l’argent
Acheter des livres, des vêtements et autres cadeaux.
Conclusion
Nous sommes convaincus que dans les études qualitatives, comme celle que nous avons menée sur les pratiques éducatives familiales, il n’est pas juste de généraliser les résultats de notre enquête à d’autres régions d’Algérie. En outre, nous savons que les caractéristiques éducatives des familles interrogées dans cette région ne sont pas vraiment différentes par rapport aux caractéristiques éducatives et sociologiques de la famille algérienne en général.
Les transformations qu’a connues la famille dans notre société a produit de nouveaux modèles et d’autres perceptions de la structure familiale. Ce qui lui a permis de se reproduire pratiquement sous forme de nouvelles spécificités reflétant ainsi la présence des pratiques et des stratégies éducatives différentes à celles qui prévalaient dans le passé (KHERROUBI, M. 2008 :186). Le modèle éducatif proposé par les familles que nous avons étudiées est constitué d’un ensemble de valeurs et de pratiques, y compris celles traditionnelles et contemporaines coexistent entre elles ce qui fait que leur influences varient en fonction des caractéristiques socioculturelles des milieux sociaux auxquels appartiennent ces familles.
Par ailleurs, à travers leurs représentations de l’éducation, les parents cherchent à concevoir de nouveaux rôles pour les membres de la famille. Ces changements ont provoqué l’émergence de nouvelles stratégies dans le domaine scolaire, d’où l’intérêt porté à l’école, et au savoir. Contrairement à ce qui a été dit sur les familles modestes dépossédées du capital culturel, considérant qu’elles ne s’intéressent pas à la scolarité de leurs enfants et qu’elles ne s’investissent pas dans les études (BALLION, R. 1982 : 72), nous avons constaté l’inverse, elles ont exprimées leurs grandes ambitions et une forte mobilisation autour de l’enjeu scolaire à la différence de leurs niveaux culturels, économiques et sociaux.
Les parents ont changé leurs perspectives sur le plan éducatif en produisant de nouvelles perceptions du projet scolaire qu’ils veulent réaliser à travers la scolarisation de leurs enfants (BEAUD, S. 2003 : 231). Cela survient parfois d’une manière latente, bien que les parents sont conscients de l’enjeu scolaire, ils savent bien l’importance et le rôle joué par le capital scolaire dans la détermination de la position sociale qu’occupent les personnes et les familles dans la société.
Bien que la famille dans la région de Bejaïa n’a pas beaucoup d’expérience en ce qui concerne son rapport avec le système scolaire mais elle tente à travers une série de pratiques éducatives, qui se transforment spontanément par la suite en stratégie parfois réfléchies de chercher progressivement de nouvelles façons plus adaptées aux situations actuelles de sorte qu’elle se positionne sous de nouveaux changements et défis qui l’attendent à l’avenir, notamment sur le plan scolaire, professionnel et social.
Bibliographie
ADDI, H. (1999), Les mutations de la société Algérienne : famille et lien social dans l’Algérie contemporaine, édition la Découverte, Paris.
BALLION, R. (1982), Les consommateurs de l’école, édition Stock, Paris.
BEAUD, S. (2003), Le baccalauréat : passeport ou mirage, in Revue « Problèmes politiques et sociaux », n° 891, aout 2003, édition documentation française, Paris.
BENALI, R. (2004), Les pratiques éducatives des parents algériens : entre tradition et modernité, thèse de doctorat, sous la direction de Paul Durning, université Paris 10.
BENMELHA, G. (1982), La famille Algérienne entre le droit des personnes et le droit public, in « revue Algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques », Alger.
BOUKHOBZA, M. (1989), Rupture et transformations sociales en Algérie, OPU, Alger.
BOUTEFNOUCHET, M. (1980), La famille Algérienne, édition SNED, Alger.
DE SINGLY, F. (2010), Sociologie de la famille contemporaine, édition, A. Colin, Paris.
DUBET, F. (1997). Ecole, familles : le malentendu, édition Textuel, Paris.
DURNING, P. (1995). Education familiale acteurs, processus et enjeux, édition Puf, Paris.
DURU-BELLAT, M. VAN ZANTAN, A. (2002), Sociologie de l’école, édition Armand Colin, Paris.
KELLERHALS, J. MONTANDON, C. (1991), Les stratégies éducatives des familles, édition Delachaux & Niestle, Suisse.
KHERROUBI, M. (2008), Des parents dans l’école, édition Eres, Paris.
LAHIRE, B. (1995), Tableaux de familles, édition Gallimard & seuil, Paris.
PAILLE, P. MUCCHIELLI, A. (2008), L’analyse qualitative en sciences sociales et humaines, édition Armand Colin, 2ème éd, Paris. .
ROLAND, N. (2010), Du choix de l’école secondaire par les familles issues de milieux populaires, thèse de doctorat ; sous la direction de Vincent Carette, UL Bruxelles.
THIN, D. (1998), Quartiers populaires: l’école et les familles, édition PUF, Lyon.