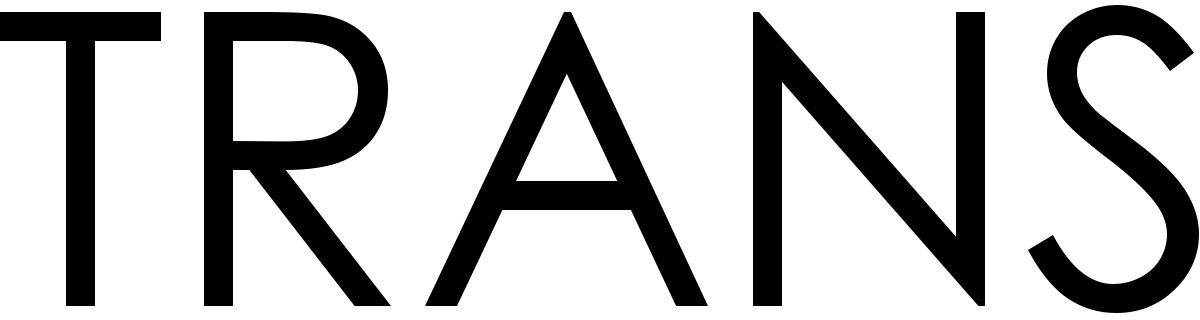BUNANI MWANGA Prince
CRESH à Kinshasa/Gombe
Abstract:
La mondialisation, aussi vielle que le monde, ne cesse de prendre des tournures inexplicables et la facette la plus marquante de la globalisation dans l’enseignement supérieur et universitaire demeure l’internationalisation. Non seulement les mutations sont plus profondes et plus rapides que par le passé, mais elles ont de plus en plus tendance à se vulgariser à travers le monde et dans tous les secteurs, celui de l’enseignement en général, l’enseignement supérieur et universitaire en particulier dont la libéralisation s’accélère à une vitesse exponentielle.
A heure actuelle le savoir, plus que par le passé, occupe une place capitale dans le progrès économique et social des pays. Les éléments les plus caractéristiques de la mondialisation demeurent entre autre l’essor des technologies de l’information et de la communication. Le constat est cependant amer dans la plupart des Etats africains en général et surtout en Afrique francophone en particulier où la part maigre du budget alloué à l’enseignement supérieur et universitaire a pour conséquences notamment la détérioration des conditions d’études. Ce qui entraîne inévitablement un frein à la recherche pourtant deuxième volet de l’activité universitaire. Au vu de tous ces fléaux qui rongent ce secteur, l’Afrique francophone est appelée à relever les défis de nouvelles exigences imposées par le contexte de la globalisation afin de se taper une place dans la compétition universitaire avec tous ses dividendes.
Mots cles:
-
Globalisation – enseignement supérieur et universitaire – recherche – stratégie – qualité – budget
Introduction
La crise de l’enseignement universitaire en Afrique francophone se manifeste dans différents axes notamment :
-
L’insuffisance des infrastructures viables ;
-
Dégradation continue de quelques infrastructures existantes ;
-
Faible part de l’enveloppe budgétaire allouée à l’enseignement supérieur et Universitaire
-
Carence du personnel enseignant qualifié (professeurs) dans la quasi-totalité des établissements supérieurs et universitaires
-
L’inadaptation des programmes académiques face aux exigences actuelles (système LMD)
-
Fuite de cerveaux vers l’étranger
-
La corruption sous toutes ses formes
-
Absence de bibliothèques universitaires numérisées avec connexion Internet
-
Absence d’équipement moderne dans quelques Centres de recherches existants
-
Les faibles taux de rendement (beaucoup d’échecs)
-
Absence totale des bourses d’études, etc.
-
La faible coopération sous régionale en faveur des jeunes chercheurs (bourses octroyées)
Il convient par ailleurs de souligner que la crise de l’enseignement supérieur et universitaire en Afrique francophone est multiforme se traduisant dans le fonctionnement des institutions concernées. Cette crise peut être appréhendée à travers des éléments qui sont soit des inputs pour le système éducatif lui même (quand ceux-ci représentent les conditions d’étude), soit des indicateurs de performance du système, soit des indicateurs de pertinence par rapport à l’environnement socio-économique du pays.
Ainsi, il convient de diagnostiquer quelques défis majeurs qui rongent inévitablement le système éducatif avant de proposer les pistes de solution à moyen et à long terme. Il s’agit entre autre de :
Section 1. Les défis de l’enseignement supérieur
1.1L’insuffisance des infrastructures
L’insuffisance des infrastructures éducatives demeure un mal commun à l’ensemble des pays francophones.
Ce défit se traduit en particulier par une limitation des capacités d’accueil très accentuée en l’occurrence : bibliothèque de recherche moderne quasi inexistante et peu équipée par rapport aux besoins des étudient, le surpeuplement des étudiants dans les auditoires non sonorisés, manque de restaurants universitaires pour certains pays (cas de la RD.Congo), l’absence de connexion Internet et la non-informatisation des bibliothèques.
Cependant il sied de noter ce défit se prononce avec plus d’acuité dans quelques Etats francophones comparativement au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire où des efforts louables ont été accomplis.
1.2.Les faiblesses dans les conditions d’encadrement
Le déséquilibre numérique entre les enseignants (appelés à dispenser les cours et recherches) et le nombre croissant d’étudiants pose inévitablement un épineux problème. Ce ci contribue par ailleurs à la baisse de niveau de la qualité des enseignements reçus car, les formateurs pour se dédouaner de leur charge académique, se voient obligés soit de vendre uniquement le support des cours peu expliqués, soit confier les charges horaires à de non professeurs d’université (Assistant et chef de travaux en RD Congo). Cette situation impacte négativement sur l’encadrement des mémoires et l’avenir des troisièmes cycles.
Notons par ailleurs que la plupart des institutions d’enseignement supérieur ne sont pas connecté aux réseaux mondiaux de recherche.
1.3. Les faibles rendements et la subjectivité dans la cotation des étudiants
Il est sans ignorer que la quasi-totalité des pays francophones connaissent un taux d’échec élevé qui se caractérise très souvent par l’inefficacité interne pour plusieurs raisons : le programme des cours très ambitieux et inachevés à la fin de l’année académique, absence de travaux pratiques, indisponibilité des formateurs et manque de motivation dans le chef des étudiants.
Il est sans doute vrai que le contenu des programmes de cours ne rencontre pas toujours les réalités du marché de travail. Ce qui crée une sorte de déconnexion des enseignements reçus aux réalités socio-économiques.
Section 2. Les germes de la crise
Les symptomatiques de la crise de l’enseignement supérieur dans les Etats de l’Afrique francophone sont notamment dues à des facteurs économiques, institutionnels et sociopolitiques.
2.1Les facteurs économiques
La crise de l’enseignement supérieur en Afrique est avant tout d’ordre économique. Le faible pouvoir d’achat des parents ne permet pas l’accès de leurs enfants à l’éducation universitaire de qualité car, ceci implique un coût qui paraît être une contrainte majeure. Les quelques universités viables dénombrées sont l’apanage des enfants des bourgeois. Le reste des étudiants se déversent dans des formations supérieures de second rang.
Il en est aussi de ressources maigres allouées aux institutions universitaires et de leur mode de gestion orthodoxe.
L’insuffisance des budgets alloués à l’enseignement supérieur influe négativement sur la qualité des enseignements dispensés et sur la viabilité des infrastructures d’accueil tel que dit supra. Conséquences directes : dysfonctionnement et inefficacité des institutions.
2.2. Les facteurs institutionnels
Le mode de soutient et financement des études supérieures en Afrique francophone constitue également un facteur explicatif de la crise de l’enseignement supérieur. L’intervention de l’Etat dans l’octroi des bourses d’études est restée un souvenir dans la mémoire des étudiants. Cette situation fait naitre souvent de revendications et tensions sociales allant jusqu’à organiser de grèves.
Un tour d’horizon dans certains pays francophones où le seuil de la pauvreté est évolutif, démontre à suffisance que l’absence de moyens financiers capables de financer des études justifie les échecs de performances enregistrées dans les différents établissements universitaires
.
Les données des enquêtes menées dans les différents pays montrent évidemment
comment les différents États se sont désengagés dans ce domaine et permettent aussi de comprendre les conditions matérielles dans lesquelles les études sont effectuées en Afrique francophone.
En République Démocratique du Congo, la mort de l’État providence et de l’idéologie socialisante qui ont prévalu dans ce pays jusqu’à la fin de la décennie1980 ont eu des implications majeures sur l’accès des populations aux services sociaux de base et notamment
L’éducation. Les réformes entreprises au Congo en ma tière d’attribution des bourses d’études ont substantiellement réduit le nombre d’étudiants boursiers, substituant ainsi les parents à l’État quant au financement des études.
2.3 Le traitement du personnel enseignant
Globalement, la condition du personnel enseignant dans la plupart des pays francophones pose encore un problème récurrent qui ronge la fonction noble de l’enseignement supérieur en particulier puisqu’elle touche aux conditions de survie du professionnel de l’éducation. Ainsi, nous constatons que les salaires et traitement de base alloués au corps enseignant connaissent une pente négative inquiétante entrainant ainsi la chute du pouvoir d’achat. Comme conséquence directe : la démotivation des enseignants qui préfèrent développer d’autres activités informelles lucratives et sacrifier l’avenir des intellectuels.
2.4. Absence de l’orientation des étudiants par les autorités institutionnelles et académiques
L’orientation académique est une tâche dont l’intérêt s’exprime à la fois dans le souci de réguler les flux d’entrée des étudiants et dans le souci d’affecter les étudiants dans les différentes facultés en suivant leur profil et leur capacité. En ce sens, elle a une influence certaine sur les performances des étudiants dans les différentes filières.
Fort malheureusement, nous assistons un laissez guider des impétrants avec de taux d’échec catastrophiques. Ainsi, un étudiant qui a fini en sciences commerciales et administratives s’oriente à embrasser la faculté de polytechnique pour devenir ingénieur civil. Résultat attendu : inaptitude intellectuelle faute de background dans les cours de base.
Les institutions des pays africains francophones ont tout simplement ignoré cette procédure d’orientation (pourtant une obligation Etatique) pour laisser la liberté de choix aux étudiants.
2.5.La déconnexion des instituions supérieures et universitaires aux réseaux mondiaux de recherche et la faible coopération sous-régionale
La faiblesse des institutions universitaires africaines et des centres nationaux de recherche est le principal facteur de la marginalisation des universités africaine francophones des réseaux mondiaux de recherche. En effet, ainsi que le souligne Mvé- Ondo (1998), les universités africaines sont confrontées à un défi majeur qui est celui de leur ouverture à l’international. Qu’il s’agisse du partenariat ou de la coopération Sud-Sud ou Nord-Sud, un des faits majeurs qui caractérise aussi les universités d’Afrique francophone est leur faible intégration régionale et internationale.
Rares sont les universités africaines qui entretiennent des relations de partenariat avec les autres universités. La coopération au niveau régional dans le domaine de l’enseignement supérieur est très limitée et les formes visibles restent : Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et le Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (PTCI).
Le CAMES qui regroupe seize pays de la région a naturellement permis le renforcement de la coopération régionale et internationale par la participation à ses programmes des enseignants et chercheurs français, canadiens, belges, suisses et américains. Le PTCI qui, comme le nom l’indique, ne concerne que le niveau III de l’enseignement supérieur et ceci dans un seul domaine qui est celui de l’économie.
Ces faiblesses institutionnelles sont donc autant de facteurs qui expliquent la crise actuelle de l’enseignement supérieur en Afrique francophone.
2.6. Les facteurs historiques
Deux incidences majeures peuvent expliquer la crise actuelle de l’enseignement supérieur et universitaire en Afrique Francophone :
-
La première incidence relève de l’héritage colonial. En effet, l’enseignement colonial a laissé des tares dans le contenu et la finalité des programmes qui étaient mis en place bien avant la nationalisation des institutions d’enseignement supérieur. Dans le propos de Yala-Di-Pholo (1983), l’analyse du contenu des programmes d’études hérités de la colonisation fait transparaître l’idée que cet enseignement n’a pas été organisé pour former des élites promoteurs et artisans du bien-être social.
Section 3. Des approches de solutions
Eu égard à ce qui précède concernant la nature de la crise, d’une part, et ses facteurs, d’autre part, il sied de proposer quelques approches de solutions qui constituent les axes essentiels d’une politique efficace pour l’amélioration et la transformation de l’enseignement supérieur en Afrique francophone.
3.1 Le budget de l’enseignement supérieur et sa gouvernance
Les faiblesses avérées par les gouvernements de financer suffisamment le secteur de l’enseignement supérieur ont eu des effets négatifs sur la qualité de l’encadrement et le manque d’infrastructures. Elles nécessitent que soient identifiées et diversifiées de nouvelles sources de financement, condition essentielle à la transformation du système éducatif.
Les éléments d’une telle réforme se s’articulent comme suit :
au niveau de la recherche, l’enseignement supérieur en Afrique francophone devrait bénéficier d’une source indépendante de financement. Ce qui permettra aux universités de jouer leur rôle primordial de production des connaissances scientifiques susceptible de booster le développement du continent.
Il s’agit donc de faire des institutions d’enseignement supérieur des producteurs de découvertes scientifiques dont la recherche en amont serait financée par les utilisateurs potentiels ;
Au niveau de l’enseignement proprement dit, les institutions d’enseignement supérieur en Afrique francophone devraient créer des interfaces entre elles et le monde du travail à travers la formation continue qui est incontestablement une source potentielle de financement de leurs activités ;
Au niveau du management, il convient de renforcer, par la transparence et les nouveaux systèmes d’information au sein des institutions d’enseignement supérieur, la gouvernance, la gestion administrative et financière et le management de l’enseignement supérieur axé sur le résultat.
3.2 L’opportunité de l’enseignement supérieur
Afin de rendre l’enseignement supérieur et universitaire performant en Afrique francophone, il sied de :
• diversifier l’enseignement supérieur au détriment de l’élitisme pour offrir, d’une part, une formation adaptée aux aspirations, aux aptitudes et aux moyens de chaque étudiant, et, d’autre part, pour être en adéquation avec les demandes du secteur privé et du pays ;
• instaurer un dialogue constructif entre l’ensemble des partenaires et des acteurs de l’enseignement supérieur tant au niveau national que régional;
• accélérer le processus de professionnalisation des filières en vue d’adapter la formation aux besoins du marché du travail. L’implantation effective et la généralisation du système LMD pourraient constituer le moteur de la nécessaire reconfiguration de l’offre de formation. La raison fondamentale
est que la réforme LMD doit être comprise comme un processus fondamental du changement des institutions d’enseignement supérieur, des programmes et des pratiques académiques et pédagogiques ;
• accélérer l’implantation et la diffusion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour faire face aux nouvelles exigences de l’internationalisation de l’enseignement supérieur.
3.3. La condition enseignante
L’amélioration de la condition enseignante pour le maintien de l’équilibre de l’enseignement supérieur en Afrique francophone est fondamentale dès lors qu’elle conditionne la motivation au sein du corps enseignant. Une politique d’amélioration de la condition enseignante nécessite donc la revalorisation du statut des enseignants.
Cette revalorisation ne peut produire les résultats attendus que si elle est maillée par des règles claires qui allégeraient la tendance des enseignants au cumul de fonctions.
Ainsi afin de contribuer à l’accroissement de la pertinence de l’enseignement supérieur et de la recherche, la réforme doit porter aussi sur la production des ressources humaines aptes à offrir des programmes pertinents et reconnus internationalement en fonction des ressources financières des États.
Conclusion
Malgré son expansion quantitative, l’enseignement supérieur des pays de l’Afrique francophone reste l’un des moins développés au monde. En effet, la croissance rapide des effectifs et la crise économique des années 1980 ainsi que le fardeau de l’endettement ont plongé l’enseignement supérieur dans une crise profonde et complexe qui a eu pour conséquences la dégradation des infrastructures et des équipements, la baisse sensible de la qualité de la formation et de la recherche, l’aggravation du chômage des diplômés, la fuite des cerveaux, etc.
Plusieurs réformes ont été initiées pour tenter de faire face aux multiples problèmes qui minent ce secteur, mais cette crise persiste au point où la situation éducative est communément décrite comme un univers de désolation.
Malgré le caractère multiforme de cette crise, la situation ne reste pas pour autant figée car des solutions sont possibles si les pouvoirs publics mettent un peu d’imagination et surtout une réelle volonté politique pour rendre effectif la refondation de l’Université en Afrique francophone dans un contexte mondial où le savoir est devenu l’enjeu majeur du développement culturel, linguistique.
Références bibliographiques
-
Abdelkader, A., 2002, « En Afrique, l’enseignement supérieur sacrifié », Le Monde
Diplomatique, mars.
-
Banque Mondiale, 1994, « Les universités africaines : stratégies pour la stabilisation
et la revitalisation », Findings, Région-Afrique, 10, janvier.
-
Chachage, C.L.S., 2001, « Les transformations de l’enseignement supérieur et
l’exterminisme académique », Bulletin du CODESRIA, n° 1et 2.
-
Eury, X., 2002, La crise de l’Enseignement Supérieur en Afrique Subsaharienne :
Analyse économique des causes et voies possibles de redressement, Dijon : Thèse
pour le Doctorat ès Sciences Économiques.
-
Niang, S., 1998, « Les universités africaines et la mondialisation », in UNESCO,
Enseignement Supérieur en Afrique : Réalisations, défis et perspectives, Dakar
: UNESCO.
-
Site internet