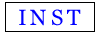Traduire la poésie italienne contemporaine: Montale
en chinois
Barbara
Leonesi ( Torino/Italia)
Les questions que je vais soulever portent sur la traduction
poétique de l'italien vers le chinois, tant au niveau des
langues que des cultures. J'ai basé mon analyse sur le
répertoire des traductions chinoises de poèmes de
Eugenio Montale, qui compte environ 220 textes(1). Au-delà de mon penchant personnel, j'ai
choisi ce poète car il avait obtenu le Nobel en 1975 et
grâce à l'attention qui est portée en Chine
aux prix Nobel, on peut compter sur un corpus significatif
de traductions. Celles-ci ont été effectuées
à partir de 1978: jusqu'à la fin des années
70 Montale avait été censuré en tant que
poète bourgeois décadent(2), et c'est seulement grâce à la censure
plus modérée qui caractérise le nouveau cours
politique de la République Populaire depuis la fin des
années 70 que des traductions de poèmes furent autorisées(3).
Il faut noter que, si la tradition de traduction littéraire
est récente en Chine (la première traduction d'un
roman occidental, La dame aux camélias de Dumas,
date de 1898), celle des études d'italien l'est encore
plus: on ne trouve de traduction directe d'oeuvres littéraires
italiennes qu'à partir des années 70. Auparavant,
la littérature italienne était traduite du japonais,
de l'anglais, du français, du russe, et de l'allemand.
J'aborderai en premier les différences linguistique
entre l'italien et le chinois qui peuvent influencer la traduction;
deuxièmement, je focaliserai sur le traitement des données
culturelles.
L'italien est une langue flexionnelle: les noms et les adjectifs
sont marqués en genre et en nombre, les verbes selon le
mode, le temps, la personne. Le chinois est une langue sans marques
morphologiques nécessaires: les relations entre les termes
sont signalées par des mots grammaticaux (adverbes, prépositions,
etc) et par l'ordre des mots. L'un des problèmes les plus
délicats posés au traducteur est l'absence de marque
morphologique de temps dans le verbe chinois.
Les traducteurs chinois transposent la forme normative de l'italien
- marquage de temps sur toutes les occurrences du verbe - par
la forme normative du chinois - absence de marquage. En étant
non-marquée, cette forme ne distingue pas passé,
présent et futur; elle nous donne tout simplement l'information
d'un déroulement dans la contemporanéité
de toutes les actions, mais on ne connaît pas la position
de cette contemporanéité tout au long de la ligne
temporelle par rapport au moment de l'énonciation. Ces
informations relatives au moment de l´action par rapport
au moment de l´énonciation ou à un repère
donné, ne sont pas toujours indispensables à la
compréhension des textes, d´autant plus que des mots
outils (noms de temps, suffixes aspectuels) renseignent, entre
autres, sur les relations d´antériorité et
la temporalité interne de l´action.
On trouve chez Montale un grand nombre de poèmes caractérisés
par l'utilisation uniforme du présent de l'indicatif. Le
poète joue sur la valeur déictique/ non-déictique
de ce temps pour présenter un monde poétique qui
est réel et actuel et en même temps onirique, c'est
le maintenant qui fuit et, à la fois, le temps indéfini
de la vérité. Les exemples sont nombreux, et la
traduction en chinois à l'aide de la forme standard non-marquée
reconstruit bien cette atmosphère d'indétermination,
d'effacement de la localisation temporelle: validité au
moment actuel, ou au passé, ou au futur, et en même
temps intemporelle.
(1)
Portami il girasole ch'io lo trapianti...
Portami il girasole ch'io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l'ansietà del suo volto giallino.
Tendono alla chiarità le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
E8 dunque la ventura delle venture.
Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze
e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.
E. Montale, 1925
|

Liu Ruting,1992
|
Apporte-moi le tournesol...
Apporte-moi le tournesol, que je le transplante
dans mon terrain brûlé par l'air salin;
et qu'il montre tout le jour aux miroirs bleus
du ciel l'anxieté de son visage jaune pâle.
A la clarté tendent les choses obscures,
les corps s'épuisent en flux
de teintes: elles en musique. S'effacer,
la suprême aventure.
Oui, porte-moi la plante qui nous mène
où vont surgir les blondes transparences
et s'exhaler la vie, telle une essence;
apporte-moi le tournesol fou de lumière.
P. Angelini, 1991(4) |
S'il te plaît, le tournesol donne moi
S'il te plaît, le tournesol donne(5) moi
c'est moi qui l'a transplanté dans ce terrain brûlé
par le salin
celui là, tout le jour, l'anxiété du jaune
visage
dirige vers le bleu ciel.
Les choses obscures toujours donnent vers la lumière,
leurs formes dans le flux des couleurs disparaissent,
les couleurs dans la musique disparaissent.
Donc, combien de chances dans une seule chance se dissolvent.
S'il te plaît, cette plante donne moi,
elle toujours va vers la lumière,
la nature physique de la vie sublime:
s'il te plaît, ce tournesol affolé poursuivant la
lumière donne moi(6). |
Le célèbre poème Meriggiare pallido
e assorto... constitue un cas limite, car ici Montale, en
dépit des règles syntaxiques de l'italien courant,
utilise toujours pour le verbe de la proposition principale la
forme sémi-finie du verbe - l'infinitif. Supprimant ainsi
toutes coordonnées de temps et de personne, Montale crée
une atmosphère hors du temps, surréelle. Dans ce
cas particulier, la forme standard du chinois correspond parfaitement
à l'italien du point de vue sémantique. Cependant,
du point de vue esthétique, il y a un écart remarquable
entre forme normative courante non marquée (chinois) et
forme exceptionnelle marquée (italien). Parmi les cinq
traductions chinoises dont on dispose, je voudrais toutefois signaler
celle de Shen Emei et Liu Xirong qui ont surmonté cet obstacle
en marquant par la particule aspectuelle durative zhe  tous les équivalents des verbes italiens
à l'infinitif.
tous les équivalents des verbes italiens
à l'infinitif.
(2)
Meriggiare pallido e assorto...
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
(...)
Montale, 1925
|

(...)
Ye Weilian, 1974
|
Á midi faire halte...
Á midi faire halte, pâle et pensif,
à l'ombre près d'un brûlant mur d'enclos,
écouter parmi les ronces et les broussailles
claquement de merles, bruissements de serpents. (...)
P. Angelini, 1991
|
Á midi se reposer
Á midi se reposer, pâle absorbé
s'appuyant au brûlant mur du jardin
parmi broussailles et rameaux écouter
le cui cui des oiseaux noirs, le remue-ménage des
serpents
(...) |

(...)
Qian Hongjia, 1988
|

(...)
Lü Tongliu,1989
|
|
La méridienne
Midi, à côté du mur du jardin rouge flamboyant
je repose calmement, portant un visage pâle
parmi broussailles et ronces j'E9coute attentif
oiseaux de montagne crier bizarrement, les serpents glisser frou
frou.
(...) |
Promenade en un midi d'été
Les murs rouges des champs et des jardins font ressortir l'ombre
verte toute sombre
mon visage est pâle
en retenant le souffle écouter attentivement
sur les branches des arbres secs les petits oiseaux gazouillent
tout bas
parmi les touffes de mauvaises herbes froufrou passent les serpents.
(...) |
|

(...)
Fei Bai, 1990
|
* * *

(...)
Shen Emei, Liu Xirong, 1996
|
Faire la méridienne
C0 midi faire la méridienne, pâle, attentif
E0 côté du mur du jardin, l'air si chaude brûle,
là où poussent broussailles et mauvaises herbes
E9couter le clappement des oiseaux noirs, le froufrou des serpents.
(...) |
* * *
Midi, le soleil enflammé brûle
le visage est pâle, le coeur est lourd d'inquiétude,
s'appuyer au muret incandescent du verger
EAtre en train d'écouter attentivement
là où poussent broussailles et ronces
cot cot le gazouillement des merles
sss sss le glissement des couleuvres.
(...) |
Cependant, si l'on peut accepter facilement l'absence de localisation
temporelle relative pour les poèmes dominés par
le temps présent, il est plus difficile de l'accepter pour
ceux dominés par le temps passés. En effet le «
temps verbal » n'a pas pour seule fonction d'indiquer une
position temporelle relative. Le poème Nella serra
(3)se compose de 4 strophes dont les deux premières sont
consacrées à la description d'une serre, et les
deux dernières à une réflexion du poète.
(3)
Nella serra
S'empì d'uno zampettio
di talpe la limonaia,
brillò in un rosario di caute
gocce la falce fienaia.
S'accese sui pomi cotogni,
un punto, una cocciniglia,
si udì inalberarsi alla striglia
il poney - e poi vinse il sogno.
Rapito e leggero ero intriso
di te, la tua forma era il mio
respiro nascosto, il tuo viso
nel mio si fondeva, e l'oscuro
pensiero di Dio discendeva
sui pochi viventi, tra suoni
celesti e infantili tamburi
e globi sospesi di fulmini
su me, su te, sui limoni...
E. Montale, 1956
|
Dans la serre
Un piétinement de taupes emplit
la serre des citronniers,
dans un chapelet de gouttes hésitantes
la faux à foin brilla.
Sur les coings s'alluma
un point, une cochenille,
on entendit se cabrer sous l'étrille
le poney - et le rêve triompha.
Ravi et léger, j'étais imprégné
de toi, ta forme était en moi
souffle secret; ton visage
dans le mien se fondait, et l'obscure
pensée de Dieu descendait
sur les quelques vivants, au milieu de
sons célestes et de tambours enfantins
et de globes pendus de foudres,
sur moi, sur toi, sur les citrons...
P. Angelini, 1991
|
|

Liu Ruting, 1992 |
Dans la serre
Dans la serre des citronniers
le bruit des pas des taupes.
La faux à foin
parmi rangs de perles de rosée brille.
Les fruits du cognassier
le rouge laqué éblouissant et brillant ,
le poney portant le mors pousse des rougissements
après c'est le rêve qui gagne sur tout.
Je m'enivre de toi,
te vois serein et joyeux, ton apparence
est mon souffle secret, ton visage
comme mon visage est brun, se fondent ensemble.
Seule la pensée de Dieu
tombe sur peu de vies, parmi
les sons de l'univers, les tambours des jeunes
et les corps célestes suspendus parmi les éclairs
tombe sur moi, sur toi, sur les citronniers.... |
La séquence de passés simples des deux premières
strophes n'indique pas seulement une perspective de rétrospection,
(événement antérieur au moment de l'énonciation)
mais encore marque l'entrée dans la dimension du récit.
À travers l'indice du temps verbal, l'auteur transporte
le lecteur non seulement dans un Temps différent, mais
dans un univers différent, l'univers du récit. Enfin,
la répétition du passé simple, temps caractérisant
l'action principale, crée un effet stylistique particulier:
tous les verbes sont mis en relief et portés sur l'avant-scène,
d'où l'effacement de l'arrière plan. Dans la traduction
chinoise, non seulement le relief, mais surtout la dimension du
rE9cit est perdue: là réside, à mon avis,
la raison du sentiment de malaise face à cette traduction.
Les problèmes les plus significatifs apparaissent là
où, en italien, on passe d'une dimension temporelle à
une autre: en chinois, tout passage d'une dimension à l'autre
doit être signalée, le cas échéant,
la séquence des verbes est ordonnée sur une même
dimension. Revenons à l'exemple (3) de Nella serra:
le contraste thématique entre ces deux parties est souligné
par une série de procédés stylistique, et
en premier lieu par le changement du temps verbal: dans les deux
premières strophes tous les verbes sont au passé
simple, dans les deux dernières à l'imparfait. Le
poème se déroule sur deux plans distincts: au premier
plan, la description de la serre enfermE9e dans le cercle de l'accompli
marqué par le passé simple; à l'arrière
plan, la pensé du poète qui s'épanouit dans
une durée marquée par l'imparfait. L'action et la
pensée ont un rythme différent, un tempo
différent. Cela n'affleure pas de la traduction chinoise,
où l'on n'a aucune distinction entre premier/ arrière
plan, entre le rythme rapide de la première partie et le
rythme plus lent de la deuxième.
C0 côté du problème de l´expression
des relations temporelles, une des principales difficultés
rencontrés par le traducteur est la relative rigidité
de l´ordre des mots en chinois. En effet c'est la position
relative des mots dans la phrase qui permet d'identifier leur
rôle grammatical. Cette "rigidité" est
relative, car elle est propre au mandarin normatif, tel qu'on
l'enseigne à l'école.(7).
. Or, la langue littéraire, et notamment la langue poétique,
ne se conforment nulle part à des normes imposées,
et le poème cité tout à l'heure de Montale
n'est qu'un exemple. Or, c'est ce que font souvent les traducteurs
chinois de Montale. Pourquoi ? Cette question dépasse le
cadre de notre propos ici. Prenons l'exemple d'une tournure de
style propre à la poésie de Montale qui, se heurtant
à l'ordre normatif des mots du chinois, pose un problème
en traduction.
Celle-ci est habitée par une foule de choses, d'objets,
qui ne se bornent pas au rôle traditionnel d'éléments
de mise en scène, mais s'imposent en tant que présences
authentiques et essentielles.(8)
. Couper l'objet des suggestions et des échos littéraires,
pour atteindre une animation non plus subjective mais objective
de la réalité, et dévoiler enfin "l'illusion
du monde en tant que représentation"(9).
. Ainsi le poète déplace fréquemment la
détermination après le nom de la chose.(10).
auquel elle se réfère. Souvent le nom de chose
est isolé de son complément verbal au moyen d'une
proposition relative où le pronom relatif joue le rôle
de sujet. On peut citer nombre d'exemples:
(4)
La frangia dei capelli...
La frangia dei capelli che ti vela
la fronte puerile, tu distrarla
con la mano non devi. (...)
E. Montale, 1956
|
La frange de cheveux
La frange de cheveux qui voile
ton front puéril, tu ne dois pas
l' écarter de la main. (...)
P. Angelini, 1991
|
|

Lü Tongliu, 1992
|
La frange
La frange a caché ton front puéril
mais tu ne doit pas l'écarter de la main. (...) |
(5)
Delta
La vita che si rompe nei travasi
secreti a te ho legata: (...)
E. Montale, 1925
|
Delta
La vie qui se rompt dans les transfusions
secrètes, je l'ai liée à toi: (...)
P. Angelini, 1991
|
|

Lü Tongliu, 1992
|
Delta
La vie s'est brisée en morceaux,
inaperçue bouge,
elle et toi, je vous ai liées ensemble: (...) |
Or, en chinois, tout déterminant doit précéder
son déterminé: la phrase relative est un déterminant
du terme auquel elle se réfère, et donc le précède:
il est évident que l'opération opérée
par Montale d'isolement du group nominal référant
aux choses au moyen d'une série d'attributions et incidentes
postposées constitue un problème. De plus, dans
la plupart des cas la structure [group nominal + détermination
postposée] est placée au début du poème:
la relative, en isolant la chose du discours, la confine en même
temps seule en ouverture du poème dans la position du thème.
Dans la plupart des cas, les traducteurs chinois ont préféré
avoir recours à deux propositions coordonnées pour
traduire la construction [group nominal + relative + group verbal].
Dans ce cas, le group nominal qui en italien est repris par le
pronom relatif, apparaît en chinois dans les deux coordonnées:
le traducteur le répète, ou bien a recours à
une anaphore. Les exemples (4) et (5) illustrent cette structure.
Par cette solution on conserve l'ordre des mots du texte italien
(et donc la thématisation!), mais on attribue aux deux
propositions le même niveau informationnel.
Dans l'ensemble, l'impression que produit la lecture des traductions
chinoises de Montale est celle d'étouffement: tout est
expliqué, rien n'est ambiguë, il n'y a pas d'espace
libre pour l'essor de l'imagination. Cela contraste avec la brièveté
et la rigueur des originaux.
Dans la plupart des cas, les traducteurs explicitent des relations
syntaxiques supposées qui, ayant pour but de paraphraser
le texte original, produisent un effet de redondance.
Cela est d'autant plus étonnant qu'une riche tradition
critique, en chinois et en langues occidentales, dénonce
les premières traductions de poésie chinoise classique
en anglais ou en français pour les nombreux ajouts de connecteurs,
de sujets, de coordonnés temporelles etc.(11)
On est donc étonné de retrouver dans les traductions
chinoises de Montale la même tendance à l'explicitation
de relations syntaxiques supposées même si, comme
le démontre suffisamment l'abondante bibliographie linguistique
tant sur la fonction "sujet" en chinois que sur les
connecteurs, la présence de ces éléments
n'est nullement obligatoire. Revenons à l'exemple (2):
Qian Hongjia choisit d'ajouter le sujet de première personne
wo  (je) même là
où le poète italien a soigneusement effacé
toute trace de coordonnée temporelle et personnelle, en
ayant recours à la forme semi-finie du verbe.
(je) même là
où le poète italien a soigneusement effacé
toute trace de coordonnée temporelle et personnelle, en
ayant recours à la forme semi-finie du verbe.
L'ajout de marques syntaxiques supposées n'a qu'une
fonction de paraphrase du texte original, comme le montre l'exemple
ci-dessus: le traducteur transforme le rapport d'identification
entre le mal de vivre abstrait et les images concrètes
qui constituent ses "corrélatifs objectifs".(12) en un rapport de comparaison
par l'ajout du verbe sihu  (sembler, apparaître comme).
(sembler, apparaître comme).
(6)
|
Spesso il male di vivere ho incontrato...
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.(...)
E. Montale, 1925
|
Souvent j'ai rencontré le mal de vivre
Souvent j'ai rencontré le mal de vivre:
c'était le ruisseau étranglé qui gargouille,
c'était la feuille qui se recroqueville,
desséchée, c'était le cheval terrassé.(...)
P. Angelini, 1991
|
|

Lü Tongliu, 1989
|
Le mal de vivre
Souvent j'ai cogné
contre les assauts du mal de vivre:
ils ressemblaient au ruisseau au cours étranglé
qui à part soi bouillonne,
E0 la feuille morte rajeunie et desséchée
sous un soleil brûlant,
et encore à l'oiseau abattu à mort
exhalant le dernier soupir. (...) |
On a l'impression que les traducteurs, craignant l'ambiguïté
et/ou l'obscurité.(13),
s'efforcent de produire un texte claire et immédiatement
compréhensible. Mais, comme l'a souligné Antoine
Berman, la traduction d'une oeuvre littéraire n'a pas de
fonction communicative: à chaque fois que la traduction
se pose comme acte de communication, elle devient une non-comunication.(14).
J'ai repéré de nombreux ajouts de compléments
du nom, de spécifications, voire de vers complets. Cette
redondance paraphrastique n'est pas balancée par un effort
équivalent pour expliciter les références
culturelles, qui demeurent quelques fois incomprises.
La première partie de cet article concernait la grammaire
des langues en jeu; dans cette seconde partie, je vais poser la
question du contexte implicite.
Certes, il n'est pas question d'un paratexte ou intratexte
glosant tout donné culturel; le traducteur devrait établir
un partage entre "explications superflues" - qui seraient
redondantes - et "explications bienvenues", indispensables
à l'éclairage des notions opaques. Dans le cas présent,
où les deux langues appartiennent à deux monde culturels
fort éloignés, la nécessité de donner
des points de repère au lecteur de la langue cible devient
urgente.
Pour combler les blancs culturels, le traducteur peut choisir,
en général, entre deux démarches différentes:
soit il donne une brève explication à l'intérieur
du texte, soit il a recours à une note en bas de page.
L'exemple suivant illustre un traitement positif des blancs culturels:
Liu Ruting expose dans une note en bas de page le mythe de la
nymphe Aréthuse (v. 7a), et explique à l'intérieur
du texte les vers "e qualcosa che va e tropp'altro che/non
passerE0 la cruna" (et quelque chose qui va et trop d'autres
qui/ne passeront pas le chas de l'aiguille) se référant
clairement à l'Evangile de St. Marc. Pour peindre la difficulté
de l'accès au paradis, Jésus pose la comparaison
avec le passage à travers le chas d'une aiguille. Le traducteur
chinois préfère abandonner la fidélité
à la lettre pour reconstruire un sens qui soit immédiatement
compréhensible au lecteur chinois (combien de choses ne
peuvent pas franchir la passe).
(7)
L'estate
(...)
Forse nel guizzo argenteo della trota
controcorrente
torni anche tu al mio piede fanciulla morta
Aretusa.
Ecco l'omero acceso, la pepita
travolta al sole,
la cavolaia folle, il filo teso
dal ragno su la spuma che ribolle -
e qualcosa che va e tropp'altro che
non passerE0 la cruna...
Occorrono troppe vite per farne una.
E. Montale, 1939
|
L' été
(...)
Peut-être dans l'éclair argenté de la
truite
E0 contre-courant
reviens-tu toi aussi à mes pieds enfant morte
Aréthuse.
Voici l'épaule en feu, la pépite
entraînée au soleil,
la piéride folle, le fil de l'araignée
tendu sur l'écume qui bouillonne -
et quelque chose qui va et trop d'autres qui
ne passeront pas le chas de l'aiguille...
Il faut trop de vies pour en faire une.
P. Angelini, 1991
|
|

Liu Ruting, 1992
|
L'étè
(...)
La truite monte à contre-courant
gaiement saute en miroitant une lumière argentée
déesse Aréthuse*
toi aussi reviens à la vie retourne à côté
de moi.
Les cimes ouvrent leurs bras, lingots d'or
sous le soleil brillent scintillants
les papillons multicolores voltigent, l'araignée
sur l'écume qui bouillonne tisse la toile.
Dans le monde une chose grandit
mais combien de choses ne peuvent pas franchir la passe...
Une multitude de vies arrive à peine à en faire
une.
* Aréthuse, divinité de la tradition grecque,
une des divinités de la mer. La divinité du fleuve
Alfeo étant amoureux d'elle, elle se mua en source pour
l'échapper. Alfeo alors se mua en fleuve et la poursuivit
avec tenace; enfin, il la rattrapa, et les eaux du fleuve et
de la source coulèrent ensemble. |
Dans le corpus des traductions de Montale, les notes en bas
de pages sont plutôt rares. Dans le principal recueil monographique
sur Montale en chinois (1992), on trouve une cinquantaine de notes
sur un total de 173 poèmes, soit un rapport de une sur
quatre.
La plupart des notes fournissent des données factuelles
: un bon nombre donnent les coordonnées des lieux géographiques
cités, les dates des naissance et de mort des personnages
historiques et l'histoire des personnages mythiques.
Certaines notes s'enracinent dans des failles du texte traduit:
par exemple, en choisissant des caractères généralement
utilisés en chinois dans les prénoms de fille pour
transcrire phonétiquement le prénom Dora, on aurait
pu, comme l'a fait Yip Wai-lim, se dispenser des notes laconiques
ajoutées par les autres traducteurs du type "prénom
de fille"(15).
Les traducteurs des poèmes de Montale manifestent une
attention particulière à la géographie italienne.
Cela aide le lecteur à trouver des points de repères
dans un espace étranger, mais, dans la plupart des cas,
ne constitue pas un support significatif à la reconstruction
des échos et du sens du poème. Plus intéressant,
encore que discutable, est le travail effectué par certains
traducteurs pour modifier l'ambiance de Montale afin de l'approcher
à l'imaginaire et à l'expérience du lecteur
chinois. La visée n'est pas une translation littérale
du texte original, mais plutôt la reconstitution du rapport
que le texte original instaure avec son lecteur italien. Le paysage
dans lequel s'installe celui-ci est parfois très différent
non seulement du paysage typique de la poésie chinoise
classique, mais surtout du paysage dont le lecteur chinois a l'expérience.
Le nespolo (néflier) devient alors l'arbre des lychees(16), le chien danois un pékinois(17). Le merle est oiseau
commun en Europe mais non pas en Chine: en dépit de l'existence
en chinois d'un équivalant reçu, jamais les traducteurs
chinois n'y ont recours. Il devient soit un générique
"petit oiseau" (xiao niao  )
soit "oiseau de montagne" (shan niao
)
soit "oiseau de montagne" (shan niao  )(18), ou un "corbeau"(wuya
)(18), ou un "corbeau"(wuya
 )(19), ou encore huamei
)(19), ou encore huamei  (20) (garrulax canorus),
un oiseau célèbre pour son chant très répandu
en Chine mais pas du tout en Europe.
(20) (garrulax canorus),
un oiseau célèbre pour son chant très répandu
en Chine mais pas du tout en Europe.
Ce travail d'acclimatation du paysage de Montale au lecteur
chinois a parfois donné des résultats discutables:
dans le poème I limoni(21), Lü Tongliu traduit cimase (cimaise)
par feiyan : ce terme désigne
non seulement corniche dans un sens générique, mais
il est utilisé dans les textes spécialisés
d'architecture pour indiquer les corniches recourbées vers
le haut typiques des constructions chinoises et extrême-orientales.
: ce terme désigne
non seulement corniche dans un sens générique, mais
il est utilisé dans les textes spécialisés
d'architecture pour indiquer les corniches recourbées vers
le haut typiques des constructions chinoises et extrême-orientales.
Les références à l'histoire, nombreuses
surtout dans les poèmes écrits vers les années
Trente-Quarante - sont en général restituées
ou annotées en traduction: on trouve cependant des contre-exemples
parfois grotesque, comme la bomba ballerina (bombe ballerine)
se référant à la guerre, et non pas à
des "bruits de joie" (huankuai shengxi  )
ainsi que le traduit Liu Ruting(22).
Le traducteur n'a pas saisi la triste ironie sur laquelle se joue
le poème, où le fracas de la guerre est comparé
à celui d'une fête.
)
ainsi que le traduit Liu Ruting(22).
Le traducteur n'a pas saisi la triste ironie sur laquelle se joue
le poème, où le fracas de la guerre est comparé
à celui d'une fête.
Les références littéraires aussi, au moins
les principales, ont été traitées en général
de façon satisfaisante: les noms des écrivains ont
été annotés, même si brièvement.
Les nombreuses échos de Dante et de la Divine Comédie
aussi ont été reconnues et expliquées, en
note ou dans le texte: Caron, le limbe, Lucifer, l'enfer. Seuls
les indices plus cachés, comme par exemple le mouvement
de descente qui est en premier lieu descente en enfer, trajet
de souffrance et en même temps de résurrection, n'ont
pas été reconnus. La Comedia de Dante est
bien connue des lecteurs cultivés chinois, et l'on peut
supposer particulièrement du public qui s'intéresse
E0 Montale. Par exemple, dans le poème Arsenio,
il se peut que, même en l'absence de glose, la traduction
exacte des trois verbes répétés discendi
ait pu parler au lecteur chinois. Cependant, Liu Ruting ne saisit
pas l'évocation du texte original, et traduit deux occurrences
de discendi par zou lai  (s'approcher), qui indique un mouvement horizontal. Il n'est plus
question d'explication bienvenue, superflue ou manquante; on est
ici sur le niveau premier de la compréhension du poème
dans l'ensemble de ses E9vocations.
(s'approcher), qui indique un mouvement horizontal. Il n'est plus
question d'explication bienvenue, superflue ou manquante; on est
ici sur le niveau premier de la compréhension du poème
dans l'ensemble de ses E9vocations.
Les problèmes majeures concernent sûrement les
références religieuse. Ce n'est pas un hasard si
tous les critiques chinois de Montale dénoncent l'obscurité
du troisième recueil, le plus "mystique". C'est
une obscurité qui dérive d'une difficulté
d'interprétation et de repérage E0 l'intérieur
du réseau serrée de symboles tirés de la
religion chrétienne. Si les traducteurs comprennent et
reconstituent dans leurs textes les E9léments de base du
Christianisme, comme la croix, le sang, la lumière comme
symbole de Dieu, ils glissent sur beaucoup d'autres, comme les
stigmates, l'Epoux, etc.. Le cassage de nombreuses références
cause la perte de l'atmosphère mystique du recueil, pourtant
très E9vidente dans le texte original. On donne un exemple:
la lettre majuscule qui distingue l'amour en sens générique
de l'Amour de Dieu pose un problème de traduction en chinois,
motivé non seulement par l'absence de familiarité
du monde culturel chinois avec le Christianisme, mais encore par
le manque, d'un moyen graphique comparable dans l'écriture
chinoise. On regarde l'exemple (8): si la référence
E0 "Amour" avec A majuscule est tout E0 fait opaque
dans la traduction de Liu Ruting, elle donne lieu E0 un contresens
dans celle de Qian Hongjia, qui traduit par "Dieu de l'amour".
(8)
L'anguilla
L'anguilla, la sirena
dei mari freddi (...)
l'anguilla, torcia, frusta,
freccia d'Amore in terra (...)
E. Montale, 1956
|
L'anguille
L'anguille: sirène
des mers froides (...)
l'anguille, torche, cravache,
flèche d'Amour sur terre (...)
P. Angelini, 1991
|
|

Qian Hongjia, 1988
|
L'anguille
Anguille,
sifflement de sirE8ne sur la mer froide (85)
toi, poisson annulaire
comme un fouet; tu es la flE8che du dieu
de l'amour sur terre (85) |
|

Liu Ruting, 1992
|
L'anguille
Anguille, sirE8ne de l'ocE9an arctique (85)
anguille, torche d'amour sur terre
fouet d'amour sur terre, flE8che d'amour sur terre (85) |
Des fautes témoignant une connaissance superficielle
du milieu concernent aussi la culture matérielle: dans
l'exemple suivant, finto gallo est une girouette et sûrement
pas un vrai coq comme l'écrit la traduction(23).
(9)
Upupa, ilare uccello calunniato...
Upupa, ilare uccello calunniato
dai poeti, che roti la tua cresta
sopra l'aereo stollo del pollaio
e come un finto gallo giri al vento.
(...)
E. Montale, 1925
|
Huppe, joyeux oiseau calomnié...
Huppe, joyeux oiseaux calomnié
par les poètes, qui roule ta crête
sur l'aérien perchoir du poulailler
et, feignant d'être un coq, tournes au vent;
(...)
P. Angelini, 1991
|
|

Lü Tongliu, 1992 |
Huppe
Huppe, tu est encore libre et heureuse
même si t'es tombée sur les imprécations
des poètes,
tu sur le poteau d'une meule de paille
tournes ta crête
que tu ressemble à un coq qui traîne à l'encontre
du vent. (...) |
Dans le poème L'anguilla, sirena indique
l'être mythique mi-femme mi-poisson, ainsi que l'interprète
Liu Ruting, et non pas le son aigu du sifflement d'une sirène
ainsi que l'entend Qian Hongjia.(24);
dernier exemple de cette liste non-exhaustive, les vers "la
storia non E8 magistra/ di niente che ci riguardi"(25) (l'histoire ne nous enseigne/ rien qui nous concerne)
veulent clairement réfuter le proverbe latin historia
magistra vitae, et la traduction de magistra par shenpan
guan  (magistrat) est presque ridicule,
d'autant plus si l'on considère que la valeur de l'histoire
comme guide pour l'action dans le futur n'est pas du tout E9trangère
E0 la pensée chinoise, au contraire. On a l'impression
que le traducteur, n'ayant pas trouvé le terme magistra
dans le dictionnaire italien-chinois, ait choisi celui figurant
en dessous, magistrato (magistrat).
(magistrat) est presque ridicule,
d'autant plus si l'on considère que la valeur de l'histoire
comme guide pour l'action dans le futur n'est pas du tout E9trangère
E0 la pensée chinoise, au contraire. On a l'impression
que le traducteur, n'ayant pas trouvé le terme magistra
dans le dictionnaire italien-chinois, ait choisi celui figurant
en dessous, magistrato (magistrat).
D'autre part, j'ai relève un nombre significatif de
fautes d'interprétation d'origine purement linguistique
aussi. En excluant tout problème concernant distance culturelle,
figures du discours plus ou moins figées dans la langue
source, sens deuxième ou allégorique, ironie, etc.,
ces erreurs témoignent des lacunes des traducteurs dans
leur connaissance de la langue italienne: on demeure là
au niveau brut de la compréhension d'un texte. On trouve
deux types de fautes, les erreurs d'interprétation de la
structure grammaticale et les erreurs d'interprétation
des mots polysémiques. La majorité des fautes d'interprétation
de la structure grammaticale dérivent d'une manque de familiarité
avec les prépositions italiennes et leur usage. Un seul
exemple, dans le syntagme la zia di Pietrasanta(26) (la tante de Pietrasanta), Pietrasanta est le
lieu d'origine, et non pas le prénom de la tante ainsi
que l'entend le traducteur. Si l'on s'attend que le traducteur
ne connaisse pas Pietrasanta, petit village de Ligurie, la préposition
di aurait dû lui suggérer que ce n'était
sûrement pas un prénom, mais plutôt un toponyme:
la construction di + prénom n'est pas attesté
en italien. Je donne un dernier exemple d'erreur sur les mots
polysémiques: le mot italien riccio, en fonction
nominale, signifie soit hérisson, soit boucle. Le traducteur
Liu Ruting se tient au milieu entre les deux sens de riccio,
d'où le syntagme 'hérisson frisé' (juanmao
haozhu  )(27).
)(27).
Il n'est plus question alors de partage entre explication bienvenue,
superflue ou manquante; on demeure ici sur le niveau premier de
la compréhension du poème dans l'ensemble de ses
évocations.
Je reviens, pour conclure, à ce que je disais au début
sur l'histoire trop courte des études italianistes en Chine.
Des erreurs, parfois grossières, témoignent d'une
préparation insuffisante de certains traducteurs. Cela
n'exclut pas la présence de quelques traducteurs ayant
une culture plus raffinée, ayant produit des textes qui
peuvent être lus avec plaisir. Cependant, dans la
perspective de la rencontre des civilisations, c´est un
cas particulièrement encourageant: on a deux pays éloignés,
deux langues relativement différentes, un poète
italien particulièrement difficile, des traducteurs chinois
qui ne bénéficient d´aucune tradition ancienne
de lecture de l´italien et pourtant, le résultat,
sans être toujours satisfaisant, offre au lecteur chinois
une première entrée dans un des sommets de la culture
et de la littérature italienne moderne.
© Barbara
Leonesi ( Torino/Italia)
CITES
(1) Pour
une bibliographie des traductions chinoises de Montale, voir Barbara
Leonesi, "Il poeta del male di vivere". Montale in
Cina, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000, p. 82 - 95.
(2) Voir
à ce sujet Barbara Leonesi, "Le letterature come strumenti
del dibattito politico: una tradizione dura a morire. Il caso
Montale", in Clara Bulfoni, éd., Tradizione e innovazione
nella civiltà cinese, Milano, FrancoAngeli, 2002 et,
du même auteur, "Il poeta del male di vivere".
Montale in Cina, op. cit., p. 13 - 20.
(3) Dans
l'article Xingfu. Wai sans shou  (Bonheur
et trois autres poèmes) publié dans le premier numéro
de la revue Waiguo wenyi
(Bonheur
et trois autres poèmes) publié dans le premier numéro
de la revue Waiguo wenyi  (Culture E9trangère) en 1978, Lü Tongliu, un des italianistes
chinois les plus réputés présente la biographie
et l'oeuvre de Montale, et traduit quatre poèmes, notamment
Felicità raggiunta, si cammina..., Cigola la
carrucola del pozzo.., Corno inglese et Meriggiare
pallido e assorto.... C'est la première parution de
traductions de poèmes de Montale en Chine populaire.
(Culture E9trangère) en 1978, Lü Tongliu, un des italianistes
chinois les plus réputés présente la biographie
et l'oeuvre de Montale, et traduit quatre poèmes, notamment
Felicità raggiunta, si cammina..., Cigola la
carrucola del pozzo.., Corno inglese et Meriggiare
pallido e assorto.... C'est la première parution de
traductions de poèmes de Montale en Chine populaire.
(4) Les
traductions françaises des poèmes de Montale sont
tirées de E. Montale (Patrice D. Angelini trad.), Poèmes
choisis 1916 - 1980, Paris, Gallimard, 1991.
(5) Dans
tout le texte, les verbes chinois n'ont pas de marques de mode,
de temps ou de personne. J'ai choisi de traduire cette forme normative
du verbe chinois par le présent de l'indicatif, pour la
valeur déictique et en même temps non déictique
de ce temps, qui représente la forme non marquée
du français.
(6) Toutes
les versions en français des traductions chinoises de Montale
sont effectuées par l'auteur; étant des «
traduction de service » ou de travail, ayant pour but d'aider
le lecteur à suivre le texte chinois, j'ai choisi de rester
le plus proche possible du chinois. Il n'y a pas d'effort pour
la restitution du niveau esthétique.
(7) Date
de la fin des années Cinquante la grande campagne pour
la normalisation de la langue dans l'ensemble du pays selon les
normes fixés pour le putonghuab  ou langue commune.
ou langue commune.
(8) Les
critiques italiens ont forgé l'expression poetica dell'oggetto
(poétique des choses) pour indiquer cette tournure
de style particulière, prenant l'essor de sa réflexion
sur le sens du monde et de la vie. Voir Angelo Jacomuzzi, La
poesia di Montale. Dagli Ossi ai Diari, Torino, Einaudi,
1978, p. 5.
(9) Eugenio
Montale, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1976, p. 565.
(10) Pour
" nom de chose " j'entends les substantifs avec référant
concrète inanimé.
(11) Voir
Eugene Chen Eoyang E., The Transparent Eye, Honolulu, University
of Hawaii Press, 1993 et Yip Wai-lim, Diffusion of distances,
Berkeley - Los Angeles - Oxford, University of California Press,
1993.
(12) Les
critiques occidentaux de Montale ont eu recours à la notion
de "correlatif objectif" ainsi qu'elle a été
définie par T.S. Eliot: in The Sacred Wood: Essays on
Poetry and Criticism, London, Methuen, 1920: "A set of
objects, a situation, a chain of events which shall be the formula
of that particular emotion; such that when the external facts,
which must terminate in sensory experience, are given, the emotion
is immediately evoked". Montale, par ailleurs, a été
traducteur et critique de Eliot.
(13) A
propos d' "obscurité", on rappelle le débat
enflammé qui s'ouvrît en Chine à la fin des
années 70, lors de la naissance du courant de poésie
nommé "obscure" (menglong shi  ):
le poE8te Ai Qing (
):
le poE8te Ai Qing ( 1910 - 1996), alignE9 sur le pouvoir, dE9fendEEt la valeur incontournable
pour toute 9Cuvre d'art de la clartE9 d'expression, afin que le
plus grand nombre de gens puisse en bE9nE9ficier. Voir Stefania
Stafutti, "Montale e la Cina", in Sigma, XX,
n. 3, 1995, p. 161 - 178.
1910 - 1996), alignE9 sur le pouvoir, dE9fendEEt la valeur incontournable
pour toute 9Cuvre d'art de la clartE9 d'expression, afin que le
plus grand nombre de gens puisse en bE9nE9ficier. Voir Stefania
Stafutti, "Montale e la Cina", in Sigma, XX,
n. 3, 1995, p. 161 - 178.
(14) Voir
Antoine Berman, La traduction et la lettre, ou l'auberge du
lointain, Paris, Seuil, p. 70 (première édition
pour Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1985).
(15) Eugenio
Montale, Dora Markus, 1939. Traductions chinoises: Yip
Wai-lim, Tangna  , 1974;
Lü Tongliu, Duola Maerkushen
, 1974;
Lü Tongliu, Duola Maerkushen  ,
1992; Qian Hongjia, Duola Magusi
,
1992; Qian Hongjia, Duola Magusi  ,
1988.
,
1988.
(16) Eugenio
Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli..., 1939. Traduction
chinoise: Lü Tongliu, Wo wei ni shi qu e shang de bingshuang
 (Je t'essuie la glace sur la front),
1989.
(Je t'essuie la glace sur la front),
1989.
(17) Eugenio
Montale, Al mare (o quasi), 1977. Traduction chinoise:
Lü Tongliu, Zai haitan (huozhe jihu zai haitan)  (A la plage (ou presque E0 la
plage)), 1989.
(A la plage (ou presque E0 la
plage)), 1989.
(18) Eugenio
Montale, Meriggiare pallido e assorto..., 1925. Traductions
chinoises: voir p. 3, exemple (2).
(19) Eugenio
Montale Forse non era inutile..., 1981. Traduction chinoise:
Lü Tongliu, Yexu bingfei tulao wuyi  (Peut-être ce n'était pas inutil), 1992.
(Peut-être ce n'était pas inutil), 1992.
(20) Eugenio
Montale, Gli uccelli parlanti, 1977. Traduction chinoise:
Liu Ruting, Hui shuuohua de niao  ( Les oiseaux parlants), 1992.
( Les oiseaux parlants), 1992.
(21)
Eugenio Montal e , I limoni, 1925. Traduction chinoise:
Lu Tongliu, Ningmeng  (Les
citrons), 1986.
(Les
citrons), 1986.
(22) Eugenio
Montale, Brina sui vetri; uniti..., 1939. Traduction chinoise:
Liu Ruting, Boli chuang yingchu yin si  ( La fenêtre vitrée reflète des fils argentés),
1992.
( La fenêtre vitrée reflète des fils argentés),
1992.
(23) Mais
le traducteur français tombe dans la même erreur!
(24) Voir
exemple (8), p. 11.
(25) Eugenio
Montale, La storia, 1971. Traduction chinoise: Liu Ruting,
Lishi  (L'histoire), 1992.
(L'histoire), 1992.
(26) Eugenio
Montale, Una visitatrice, 1981. Traduction chinoise: Liu
Ruting, Yi ge nü lai fangzhe  (Une visitatrice), 1992.
(Une visitatrice), 1992.
(27) Eugenio
Montale, A pianterreno, 1971. Traduction chinoise: Liu
Ruting, Loufang de diceng  (Le
bas E9tage de la maison), 1992.
(Le
bas E9tage de la maison), 1992.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
Montale Eugenio, Ossi di seppia, Torino,
Gobetti, 1925
--- Le occasioni, Torino, Einaudi, 1939
--- La bufera e altro, Venezia, Neri
Pozza, 1956
--- Satura, Milano, Mondadori, 1971
--- Diario del '71 e del '72, Milano,
Mondadori, 1973
--- Quaderno di quattro anni, Milano,
Mondatori, 1977
--- Altri versi, Milano, Mondatori,
1981
--- Poèmes choisis 1916 - 1980,
Paris, Gallimard, 1991 (Angelini Patrice Dyerval trad.)
Gu Zhengkun,  , E9d.,
Shijie ming shi jianshang cidian
, E9d.,
Shijie ming shi jianshang cidian  (Dictionnaire de poE8mes cE9lE8bres du monde), Beijing, Beijing
daxue, 1990
(Dictionnaire de poE8mes cE9lE8bres du monde), Beijing, Beijing
daxue, 1990
Lü Tongliu  ,
éd., Tianmi de shenghuo
,
éd., Tianmi de shenghuo  (La dolce vita), Guilin, Lijiang, 1986
(La dolce vita), Guilin, Lijiang, 1986
Lü Tongliu, , trad., Mengtalai shixuan
 (Montale. Poèmes choisis),
Changsha, Hunan wenyi, 1989
(Montale. Poèmes choisis),
Changsha, Hunan wenyi, 1989
Lü Tongliu, Liu Ruting  ,
trad., Shenghuo zhi e
,
trad., Shenghuo zhi e  (Le
mal de vivre), Guilin, Lijiang, 1992
(Le
mal de vivre), Guilin, Lijiang, 1992
Qian Hongjia,  , trad.,
Kuaqimoduo, Mengtalai, Wengjialeidi shixuan
, trad.,
Kuaqimoduo, Mengtalai, Wengjialeidi shixuan  (Montale, Quasimodo et Ungaretti. Poèmes choisis), Beijing,
Waiguo wenxue, 1988
(Montale, Quasimodo et Ungaretti. Poèmes choisis), Beijing,
Waiguo wenxue, 1988
Shen Emei  , Liu
Xirong
, Liu
Xirong  , Yidali dangdai wenxue shi
, Yidali dangdai wenxue shi
 (Histoire de la littérature
italienne contemporaine), Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu, 1996
(Histoire de la littérature
italienne contemporaine), Beijing, Waiyu jiaoxue yu yanjiu, 1996
Yip Wailim  , trad.,
Zhongshu changge
, trad.,
Zhongshu changge  (Le
chant de la foret), Taipei, Yangguotai, 1974
(Le
chant de la foret), Taipei, Yangguotai, 1974
7.2. Translation and Culture
Sektionsgruppen
| Section Groups
| Groupes de sections
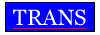 Inhalt | Table of Contents | Contenu 15 Nr.
Inhalt | Table of Contents | Contenu 15 Nr.
For quotation purposes:
Barbara Leonesi ( Torino/Italia): Traduire la poésie italienne
contemporaine : Montale en chinois. In: TRANS. Internet-Zeitschrift
für Kulturwissenschaften. No. 15/2003. WWW: http://www.inst.at/trans/15Nr/07_2/leonesi15.htm
Webmeister: Peter
R. Horn last change: 13.8.2004